-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:39
Vincent Mariette, cinéaste français
«Un moment hors temps et hors réalité»
Jeune réalisateur français, Vincent Mariette présente son dernier court-métrage, « Les Lézards », au 11es Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Dans ce film qui met à l’écran le duo virtuose Vincent Macaigne et Benoît Forgeard, on est plongé dans une atmosphère éthérée, onirique, où deux copains attendent dans un hammam l’arrivée d’une femme. On les écoutera deviser sur des dialogues étranges, remplissant l’espace du film tant par la présence imposante, bien que nuancée, de leurs corps, que par la densité de leurs échanges. Un court-métrage à l’esthétique vaporeuse et tout à fait captivante, d’où l’on sort avec le tournis, mais surtout avec la certitude d’avoir assisté à un beau moment de cinéma. Vincent Mariette a également réalisé deux autres courts-métrages : « Double Mixte » (2011) et « Le Meilleur ami de l’homme » (2010). Il prépare actuellement son premier long-métrage, « Tristesse Club ».
Propos recueillis par Sarah Haidar
Algérie News : L’idée de filmer ces deux personnages (dans « Les Lézards ») en noir et blanc s’est-elle imposée à vous du fait de l’atmosphère pesante du hammam ? Ou relève-t-elle d’un pur choix esthétique ?
Vincent Mariette : Disons qu’il s’agit d’un tout et surtout, pour moi, d’une évidence. Pour la première fois, je voyais un film en noir et blanc alors que je l’écrivais. Mais je crois qu’il y a deux raisons principales. Il me semblait d’une part, que cela conviendrait assez bien à l’atmosphère doucement onirique que je voulais faire ressentir, cette espèce de moment hors temps et, aussi un peu hors réalité, et d’autre part, cela tient au fait que je ne voulais pas rendre compte de la crudité des corps. Ça n’allait pas dans le sens du film et il me semblait que le noir et blanc permettait « d’adoucir » ce rapport aux corps du film.Justement, alors que Léon et Bruno sont quasiment nus, le spectateur (moi en tout cas) ne ressent pas cette rencontre frontale avec la chair. On se demande alors s’il s’agit là d’une pudeur ou d’un désir d’instaurer le paradoxe entre la recherche de l’amour (le rendez-vous donné à la femme) et la « non-nécessité » du corps ?
Je voulais plutôt installer le film ailleurs, plus du côté du « Buddy Movie » que de la rencontre amoureuse, plus du côté de la rêverie aussi (l’apparition du varan, les personnages étranges). Disons que j’étais parti d’un vague postulat à la « En attendant Godot » : deux types qui attendent quelque chose qui met du temps à advenir. Qu’en font-ils ? Que se passe-t-il ? En plaçant cette histoire dans un hammam et son esthétique attenante (la vapeur, la chaleur), je me suis dit que je pouvais me permettre un peu ce que je voulais (une jolie femme aux seins nus, un type bizarre, un reptile), que je pourrais le justifier par l’incongruité du postulat et l’attente si longue dans cet endroit si chaud… Bref, je pouvais me permettre des mirages ; comme si l’attente et la parole (le fantasme de la rencontre) permettaient cette parenthèse, jusqu’à ce que la fille, finalement, et alors qu’ils ne l’attendent presque plus, arrive.Les quelques attouchements entre Bruno et Léon (d’une rare tendresse), nous laissaient penser qu’ils découvriront une homosexualité refoulée (voire un amour refoulé). On était un peu surpris (peut-être frustré) de voir le contraire…
Je comprends mais, pour moi, ce n’était pas le propos. Je pense même que cette direction aurait été un cliché : les deux garçons désœuvrés qui finissent par se tourner l’un vers l’autre. A ce moment-là, quand ils ont « la peau toute douce », ils s’aperçoivent dès lors qu’ils sont en train d’affleurer ledit cliché : des caresses entre hommes dans un espace moite. Si j’avais voulu mener mes personnages vers le désir homo, je pense que j’aurais fait le film autrement… Disons que je vois dans cette caresse entre potes un pendant à la scène de fin de «Superbad» (Un film de Greg Mottola, ndlr).
Vous avez également joué (sciemment, je pense) sur une certaine opposition physique entre les deux : Léon, rondelet, un peu velu et la calvitie manifeste ; tandis que Bruno est plus proche de l’archétype du séducteur (svelte, un peu musclé, chevelu et le regard charmeur)… Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
Toujours dans l’idée d’aller vers le Buddy Movie. Un duo fonctionne toujours mieux quand les personnages sont physiquement et moralement à deux endroits différents. Néanmoins, je ne voyais pas le personnage de Bruno comme un séducteur, sinon il serait allé plus facilement vers la jolie fille aux seins nus…Comment s’est faite votre rencontre avec Vincent Macaigne, comédien célèbre après sa collaboration avec Guillaume Brac ?
On se connaissait vaguement avant de passer du temps ensemble au Festival de Clermont Ferrant 2012 où nous avons sympathisé… J’écrivais le scénario à ce moment-là et ai pensé à lui assez naturellement ; assez simplement donc. Depuis nous sommes potes. Et il va jouer dans mon long-métrage…Pouvez-vous nous en parler ?
Ça s’appelle « Tristesse Club », c’est une sorte de comédie amère. Il est plutôt dans le ton des lézards. Ça se déroule dans une ville thermale désertée suite à la tempête de l’an 2000 en France, où trois personnages (deux frères et une fille se prétendant être leur demi-sœur) cherchent à savoir pourquoi on leur a dit de se rendre à la crémation de leur père alors qu’il n’y a pas de cérémonie funéraire et que personne ne sait ce qu’est devenu ledit père.S. H.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:32
Sofia Djama, réalisatrice algérienne
«Mon film n’est pas sur le viol, mais sur le ratage symbolique du viol »
Après avoir décroché deux prix au festival de Clermont-Ferrand, la réalisatrice algérienne s’est vue attribuée le prix du meilleur court métrage lors des journées cinématographiques d’Alger, pour son film «Mollement un samedi matin». Entre mollesse ambiante et audace cinématographique, la jeune cinéaste porte un regard sans concession sur la «débandaison» intellectuelle de toute une société.
Algérie News : Vous avez reçu le prix du meilleur court-métrage aux journées cinématographiques d’Alger. C’est une première consécration pour votre film dans votre pays…
Sofia Djama : Dans la mesure où il y a peu de festivals et de manifestations dédiés au cinéma, je ne perçois pas ce prix dans un enjeu de compétition. Même si j’ai été étonnée au départ par cette distinction, je suis tout de même heureuse, car cette consécration signe à mes yeux le droit d’exister dans mon pays. Depuis la projection de ce film en début d’année par l’association Chrysalide, je n’ai plus reçu d’écho.
Même si aux journées cinématographiques de Béjaïa, mon film n’a pas été retenu par le jury, je ne peux qu’encourager ce type d’initiative qui constitue de véritables espaces de diffusion. Il faut créer un nouveau public, ancrer la culture cinématographique dès le plus jeune âge avec des sorties scolaires dans des salles de cinéma, ou au théâtre par exemple.
Les festivals cinématographiques en Algérie sont à l’image de la presse indépendante. Leur critique du pouvoir reste indolore et incolore. Ce que je regrette par contre c’est que le public qui se déplace pour voir ces films, soit toujours le même, c’est-à-dire composé majoritairement de professionnels du cinéma. Le jour où l’on verra des festivals sur la place Kittani, et des sorties scolaires dans des salles de cinéma, ce jour-là je pense que l’on aura réussi notre objectif. Il faut sortir des espaces intérieurs et vulgariser toute forme d’art.Dans votre film, il n’y a ni victime, ni bourreaux. Les personnages sont comme happés par quelque chose qui les dépasse, embarqués dans une seule et même galère…
Tout le monde peut être sa propre victime ou son propre bourreau. Lorsqu’on est pris dans un engrenage malsain, on ne peut qu’engendrer de la violence. Mon idée de base était de mettre en lumière la banalisation de cette même violence dans l’espace urbain. C’est une violence sourde qui s’installe petit à petit dans les rapports homme-femme. Voilà pourquoi j’ai choisi un jeune violeur, à la gueule d’ange. Le message que je voulais véhiculer à travers mon film est celui-là : l’histoire ne nous appartient pas, nous ne faisons que la subir.Que répondez-vous à ceux qui estiment que votre film est une condamnation sans appel de la gent masculine ?
Il y a au contraire beaucoup de tendresse pour les hommes. Si on a une lecture superficielle du film on peut croire effectivement que je mets la gent masculine sur la sellette. Mais le viol que j’évoque dans mon court métrage est un viol avant tout intellectuel que subissent les hommes et les femmes sans distinction aucune.
Paradoxalement, les meilleurs critiques que j’ai reçues concernant le film, viennent d’un public totalement étranger au monde du cinéma. Le plus beau message que j’ai reçu vient d’un jeune homme que j’ai rencontré dans la rue qui me disait que mon film était bien. Après, c’est vrai, je reste une femme qui ne peut que s’indigner contre le sort qui leur est réservé. Mais je veux avant tout explorer les rapports des deux sexes dans la ville. Pour moi, le vrai chapitre de ce film est celui du commissariat, et non celui du viol. Lorsqu’on ne rêve plus, et lorsqu’on est dépourvu de toute tendresse, il est là le foyer de la violence. C’est valable pour les hommes comme pour les femmes.Vous deviez au départ travailler avec une actrice algérienne, mais c’est finalement la comédienne française Laetitia Eïdo qui incarnera brillamment le rôle de Myassa. Comment s’est faite son immersion dans un environnement qui lui était jusque-là étranger, et comment avait-elle pu dépasser ses incohérences linguistiques ?
Au départ, c’était Adila Bendimerad qui devait camper ce rôle. Et puis pour des questions de timing, cela n’a pas pu se faire. Le rapport du corps féminin à la ville me semblait l’enjeu essentiel que l’actrice devait relever en jouant le rôle de Myassa. Suite à ce fâcheux changement de programme, je me suis rabattue sur des actrices algériennes. L’une d’entre elles a été très honnête d’ailleurs en me disant qu’elle n’aimait pas mon scénario. D’autres au contraire, me disaient qu’elles l’aiment bien mais n’assumaient pas le regard de la société, parce qu’elles étaient mariées ou je ne sais quoi d’autre. Je suis finalement tombée sur Laetitia Eïdo qui est française et qui n’a pu venir en Algérie qu’à la veille du tournage. Contrairement aux acteurs algériens qui se sont appropriés les dialogues et les personnages, me faisant même des suggestions que j’ai prises en compte dans mon scénario, Laetitia, j’ai pris presque possession d’elle, et de son corps. Les difficultés linguistiques ont été particulièrement pénibles, puisqu’elle ne parle pas arabe, mais l’équipe l’a aidée et soutenue jusqu’au bout. J’ai donc adopté une façon de manager mes acteurs.Pensez-vous que l’émancipation de notre société, gangrénée par les tabous de tous genres soit conditionnée par notre rapport à la sexualité ?
Je pense que c’est notre rapport au rêve et au désir qui nous permettra de nous affranchir de l’archaïsme et d’ainsi de nous émanciper. Beaucoup de jeunes ne peuvent s’empêcher d’éprouver de la culpabilité lorsqu’ils ont des relations sexuelles. Il y a un profond problème de légitimité du désir et du rêve. Mais cette frustration ne peut se dissiper aussi qu’en créant des conditions économiques et sociales favorables à l’épanouissement. L’évolution culturelle et sociale, l’ouverture d’espaces d’expression procureront aux jeunes une liberté intellectuelle d’abord, avant d’envisager une liberté sexuelle, car celle-ci suivra naturellement par la suite. Prenez l’exemple de la Tunisie, où sous l’ère Bourguiba, le statut de la femme était presque sacralisé. Le fait d’imposer une liberté telle qu’elle soit par le haut, c’est-à-dire par des lois, n’engendre pas pour autant des êtres émancipés.La scène du viol est jugée cru et choquante par certains. Peut-être aurait-il fallu la présenter de manière suggestive, et éviter ainsi tout voyeurisme…
Même si le viol est un acte de violence abominable, il est présenté dans mon film comme un acte ridicule, voire pathétique. J’ai voulu mettre l’accent sur « l’échec de la bandaison ». C’est un ratage ! Ce viol est à la mesure du ratage de notre système. Mais je tiens à rappeler que ce n’est pas une histoire de viol, mais une tentative de comprendre le ratage du viol. De plus cette jeune femme s’est faite violée dans la cage d’escalier, parce que l’ascenseur était en panne. Mais au fond c’est tout un système qui ne fonctionne pas.On n’a pas l’habitude de voir des scènes de viol dans des films réalisés par des cinéastes algériens, comment le public algérien a réagi face à cette scène lorsque vous avez présenté votre film ?
J’ai eu des échos mitigés. Une femme dans la salle m’a dit que le fait de se faire harcelée moralement et physiquement presque quotidiennement c’était tout aussi violent qu’un viol. Il est clair que personne n’a envie de voir un viol sur écran à moins d’être sadique. Les gens pensent que lorsqu’un cinéaste réalise une fiction il doit obligatoirement raconter leur réalité. Or, ce n’est pas le cas ! Si on multipliait les images et les productions cinématographiques, le public ne serait plus dans cette attente ou dans l’idéalisation de ce qu’il voit à l’écran.Vous êtes-vous autocensurée dans l’écriture de votre scénario ?
Pas une seconde, et j’espère avoir le courage et la chance de ne jamais m’autocensurer. Mais je donnerais quand même une copie à l’ENTV même si je sais qu’il n’y a aucune chance que mon film soit diffusé sur la chaîne nationale. Si tel est le cas, je demanderais que mon court métrage apparaisse en entier je refuse qu’il soit censuré.Entretien réalisé par : Meriem Benslama
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:30
Hany Abu-Assad parle de son film
La confiance
- « Le thème principal du film est la confiance, son importance dans les relations humaines et sa versatilité. La confiance est la pierre angulaire de l’amour, de l’amitié et de la loyauté. Elle est intangible et peut être à la fois solide et fragile. Mon désir de percer le mystère de la complexité des émotions humaines est sans borne. Dans les relations humaines, la confiance est le plus grand mirage qui soit, elle procure des émotions très complexes à chacun. »
Attribuer les rôles à de jeunes acteurs
- « Les quatre personnages principaux sont interprétés par de jeunes acteurs, qui jouent ici dans leur premier film. Pendant la phase de casting, la directrice de casting et moi-même avons rencontré de nombreux acteurs palestiniens. Le plus important pour nous, était leur vraisemblance, leur capacité à exprimer des émotions profondes et la dynamique qui se créait entre eux. Adam Bakri, qui interprète Omar, est une véritable découverte. Non seulement, c’est un grand acteur qui a travaillé très dur pour s’approprier le personnage, mais en plus, il crève l’écran. Leem Loubany, qui joue Nadia, dégage beaucoup de force tout en véhiculant une certaine tristesse dans son regard, ce qui pousse à vouloir en savoir plus sur elle. Samer Bisharat, qui interprète Amjad, est le comique de la troupe ; nous avons d’ailleurs intégré certaines des blagues qu’il racontait hors caméra dans le film.
Eyad Hourani m’a fait découvrir une toute autre facette de Tarek, quelqu’un qui peut être au même moment dur et vulnérable ou sérieux et drôle. Ils ont tous énormément apporté au film. »
Waleed F. Zuaiter dans le rôle de l’agent Rami
- « Waleed F. Zuaiter est le seul acteur à avoir l’expérience de la caméra. Travailler avec des acteurs professionnels est toujours intéressant et motivant car ce sont, eux, qui posent les questions les plus difficiles sur leur personnage et ses motivations. Travailler avec Waleed était comme sculpter dans un bloc de marbre et le résultat est époustouflant. »
La face humaine des combattants de la liberté
- « Je ne réaliserai jamais un film qui condamne ou défend des êtres humains de manière univoque. Je laisse cela aux cours de justice du monde entier. Je suis intéressé par la face humaine des combattants de la liberté, comme par celle de tous les personnages, car c’est souvent notre talon d’Achille qui nous rend humain. De l’extérieur, nombre de gens (ou de personnages) paraissent parfaits, que ce soit un combattant de la liberté ou un homme amoureux, mais leur faiblesse cachée fait que cette perfection n’est qu’une perception. Ils cachent en eux une imperfection. Mon travail en tant que réalisateur est de montrer cet aspect des choses avec honnêteté et sans manichéisme. »
Donner une voix aux Palestiniens
- « Mon but est de réaliser des films forts et intéressants, et mon travail est d’étudier ce qui fait une bonne histoire. Selon moi, les bons films mettent en scène des personnages dont les motivations sont intemporelles et universelles. La question de savoir si mon travail influe sur la compréhension de certains sujets par des spectateurs, est annexe. Comme tous les artistes, j’ai dû défendre mes choix artistiques. Cela ne m’a jamais posé de problème et cela n’a rien d’exceptionnel. Explorer la part humaine de personnages qui agissent violemment, n’a rien d’exceptionnel non plus ; c’est ce qui occupe la plupart des auteurs. Mais on m’a encensé et/ou critiqué pour avoir donné une voix aux Palestiniens. Dans ce cas, ce n’est ni un commentaire artistique ni une critique. C’est un commentaire politique et une critique, ce qui est très différent. »
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:29
Je recherchais l’authenticité
Algérie News : Comment vous sentez-vous après la projection de votre film ?
Bahia Allouache : C’est la première fois que je présente mon film en Algérie et plus particulièrement à Béjaïa. Pendant la projection, j’étais assez tendue, enfoncée dans mon siège. Je craignais des soucis techniques, la réaction du public, d’entendre des soupirs, des gloussements sur le film, des commentaires ironiques mais au final, cela s’était bien passé. Surtout que j’en ai un peu marre de voir mon film en projection, entre les copies que je dois faire, que je dois vérifier, les projections, je ne le connais plus que par cœur, mais le fait de sentir que ce public était captivé par ce que je lui proposais, ça m’a rassurée. Je suis vraiment heureuse que le film soit montré en Algérie, que ce soient des Algériens qui le voient, qu’ils n’aient pas besoin de lire les sous-titres, qu’ils le comprennent automatiquement.La langue est un élément de mise en scène assez présent dans votre processus créatif…
C’est très important pour moi. J’ai beaucoup travaillé avec mes acteurs afin qu’ils restituent ce que je voulais, et surtout dans la langue d’aujourd’hui. Je suis née en Algérie, j’y aie grandi et aie vécu mon adolescence dans ce pays, et aujourd’hui, force est de constater que la langue n’est plus la même. Les expressions sont différentes, et c’est cela que je voulais montrer dans mon film. Je suis persuadée que cette langue sera différente dans une dizaine d’années.Ce matin, vous évoquiez dans le ciné-café, votre rapport passionnel avec le hip-hop, le rap, et après coup, on constate que vos personnages sont emportés par le flow, donc par la langue.
Mon film est très bavard. C’est du non-stop. Et quand on lit les textes de rap, on s’aperçoit que tout est condensé, ardu parfois, que les lignes de texte sont nombreuses. Et j’avais envie que mes acteurs trouvent leur rythme, qu’ils parlent différemment, comme si l’on se trouvait dans un groupe de rap.Il existe aussi un autre aspect assez visible dans votre film. Le fait que votre caméra reste soit sur la terrasse, soit dans l’appartement, qu’elle n’aille pas se balader dans les ruelles algéroises, à l’extérieur.
C’est agréable d’être dans une sorte de cocon. D’avoir cette impression de ne pas être agressé par des éléments extérieurs. Mais après, quand nous avons cette contrainte de lieux, il faut se poser et bien réfléchir à comment questionner un pays, un événement politique (les élections législatives), des personnages de fiction dans ce lieu. L’appartement est dépouillé et j’aimais cet aspect, vu que j’avais déjà repéré des endroits assez surchargés, et cela ne collait pas avec mon film. Tout cela m’aidait aussi à bien me concentrer sur le corps de mes personnages, leur désir, quelque chose de primordial pour moi.Est-ce que vous désiriez vos personnages ?
Je prenais plaisir au moment du casting. Ensuite, ce qui me faisait peur, c’est que la caméra les fasse paniquer et surtout qu’entre eux, il n’y ait pas d’alchimie. Je recherchais l’authenticité. Et c’est en cela, que je me suis montrée bienveillante, attentive, complice, car je les aimais ces personnages, mes acteurs et actrices. Je pense que tout cela m’a aidée à dessiner un groupe de personnages qui se connaissaient depuis longtemps. Au final, mes acteurs me faisaient confiance. C’est ce que je recherchais.Est-ce qu’à un moment, votre film vous a échappé ?
Le tournage s’est avéré difficile, mais le fait que mes acteurs me faisaient confiance, j’avais la possibilité de surpasser tout cela. Après le montage est arrivé et là, ce fut une autre paire de manches. La première version était détestable. Je ne retrouvais rien de ce que j’avais écrit dans mon scénario. Puis j’aère tout cela, je le laisse se reposer, et j’y reviens. Au final, mes intentions se retrouvaient dans ce film. Et puis, je reste encore et toujours intéressée et intriguée par la réceptivité des spectateurs. Leurs interprétations, leurs rires, leurs contradictions, leurs critiques aussi… je suis preneuse. Maintenant, ça me manque un tournage. Donc j’écris. Quasiment terminé. Un court qui se déroulera sur Alger. J’ai envie qu’il prenne vie. Que ce film existe.Propos recueillis par Samir Ardjoum
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:28
Projection de «Demande à ton ombre»
La montre affiche 22h45 quand Lamine Ammar-Khodja, cinéaste, sort de la salle de la Cinémathèque algérienne. Son dernier film, « Demande à ton ombre » vient d’y être projeté. Un débat eut lieu. Et l’émotion prit place au sein de la 11e édition des Rencontres Cinématographiques de Béjaïa. Récit.
Il était prévu, on le dit, que Lamine aurait quelques soucis avec l’administration. Passeport à renouveler. Lenteur de la situation. Paperasse toujours présente. Règle du jeu pour n’importe quel festival qui se respecte. Et puis, deux jours avant le début des festivités bougiottes, la nouvelle tombe. Lamine vient. Pourquoi s’y attarder ? Car le film n’a jamais épousé une salle algérienne, car il ne sera jamais diffusé sur la télévision algérienne (comme l’aime à le rappeler Omar Zélig, venu d’Alger pour modérer le débat), car il tutoie le spectateur, car il utilise le « je » pour mieux comprendre le « nous » ambiant. Lamine est là, bien présent, son film derrière, avec une certaine avance sur ses contemporains. Qu’on n’aime ou pas, on peut, il est certain que le film intrigue plus qu’il énerve, questionne plus qu’il réponde et doute plus qu’il rassure. Un cinéma qui interpelle ?
Ça tombe bien, c’est devenu le sacerdoce du président de cette manifestation cinoche, Abdenour Hochiche, qui prend plaisir à le signaler depuis le début de ces Rencontres, depuis toujours. 20h. Zélig prend le micro. Il valse avec les mots, ne reste pas sur place, et regarde Lamine. Très vite, il évoque le parcours de ce personnage atypique, son retour en Algérie après une huitaine d’années d’études, ses animations au sein du ciné-club de l’association Chrysalide, ses livres et disques ramenés et partagés avec son entourage, le fait qu’il ait voulu, à tout prix, (re)voir Alger, son quartier, ses potes, d’autres images associées à son passé, sans s’apitoyer sur la nostalgie. Prendre la mélancolie du présent, le sien, lui rajouter des bases artistiques et culturelles, et nous offrir une part de son intimité. C’est un peu ça « Demande à ton ombre ». Zélig termine son pitch.
Lamine n’a pas placé un mot. Tant mieux. Le film le fera à sa place. Il n’était que l’ombre de son égo, non surdimensionné, mais suffisamment palpable pour qu’aille ouvrir le grenier de ses souvenirs. 74 minutes plus tard, les lumières se rallument. Ovation. La première de ces Rencontres qui dure. D’emblée les questions du public fusent. Lamine : « Je suis conscient de ce journal intime, de certaines zones assez naïves comme le fait de souligner les révolutions tunisiennes et égyptiennes, de me montrer dans le plan, heureux que Ben Ali et Moubarak aient été dégagés. Mais je ne suis pas dupe, je savais que les choses étaient plus complexes que ça, je le sais, mais je voulais aussi partager avec le public ma part de naïveté. Je pense que c’est important. Puis je rends des comptes uniquement au cinéma. C’est ce qui m’intéresse. Comment parler de moi, avec le langage cinématographique, sans sombrer dans la thérapie, sans imposer mes points de vue, laisser suffisamment d’aération pour que le spectateur puisse se réapproprier mes plans, et se confronter à ma réflexion. Qu’il y ait un échange. »
« Demande à ton ombre », c’est le carnet du retour en pays natal d’Aimé Césaire, revu et réadapté par Lamine Ammar-Khodja. C’est de l’écrit sur des plans, c’est une forme de littérature qui épouse convenablement la configuration actuelle de fabrication de films. Toujours Lamine : « Kiarostami disait qu’avec la pluralité des caméras actuelles, avec le numérique, il est probable que la littérature – l’écrit – devienne un maillon important dans la fabrication du cinéma ». Voir « Demande à ton ombre », c’est ouvrir bel et bien un journal intime, avec des maladresses, des fautes d’orthographe, des pages blanches, des ratures, des envolées lyriques, et surtout, surtout, des annotations que l’on voit avec une distance naviguant entre bouleversement et incompréhension. Et c’est aussi ça qui donne au film sa dimension poétique. Exemple : quand Lamine entretient le parallèle avec les manifestations de janvier 2011 aux révolutions tunisienne et égyptienne, sa caméra prend possession des foules, qu’elles soient sentimentales ou surréalistes, et ce n’est pas chose aisée surtout que le mouvement peut donner une certaine redondance dans la réceptivité du spectateur.
Mais là où Lamine peut étonner autant qu’irriter, c’est dans la voix, la sienne, dans ses mots joliment choisis, et qui étoffent ce que l’on voit. Ça passe ou ça casse, et parfois le sentiment d’être en retard face à un film qui avance terriblement vite, rend cette même réceptivité assez gênante. Cette sensation d’être moins intelligent que le film, de croire que le réalisateur a toujours le dernier mot, qu’il est peut-être plus intelligent que son spectateur. On peut le croire en fonction des images, en non en fonction d’un jugement de valeur. « Demande à ton ombre », dans ce sens, intrigue. A ce sujet, Lamine est clair : « A aucun moment, je veux paraître plus ou moins, je montre un point de vue, le mien, et j’écris ce point de vue d’où le texte. Dire que j’ai une longueur d’avance, ce n’est pas forcément ça, le spectateur se réapproprie mes plans, mais j’ai le droit aussi, de lui faire partager mes doutes, et cela se retranscrit sur les plans que je réalise. »
Plus tard, après 45 minutes de débat, Zélig clôt le débat. Lamine est ému, ravi, ne s’y attendait pas. Plus loin, une spectatrice nous avoue : « Ce film me renvoie à mon quotidien algérois, à cette envie que je n’ai pas choisie, de regarder la ville, ma vie, de chez moi, ou avec mes amis, de ne pas être curieuse, car j’ai le sentiment d’étouffer, de perdre pied. Et quand je vois ce film, je suis comme Lamine, je pense au retour même si le départ est toujours dans mon esprit… » CQFD !
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien





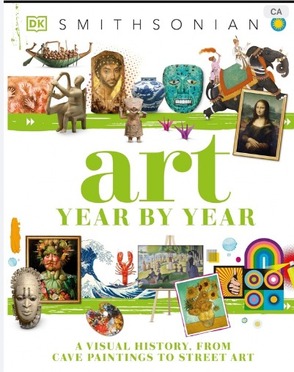




















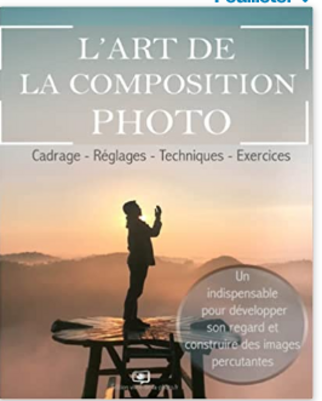







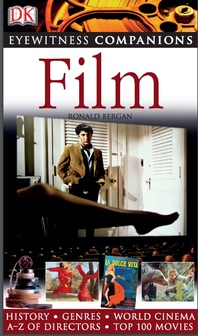





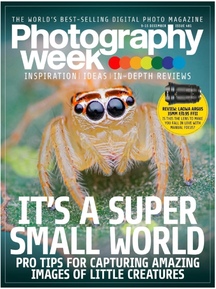



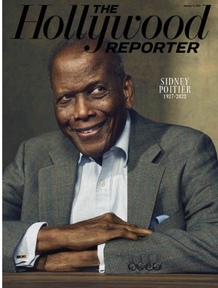








































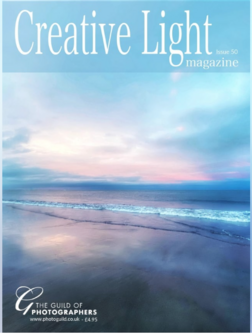

















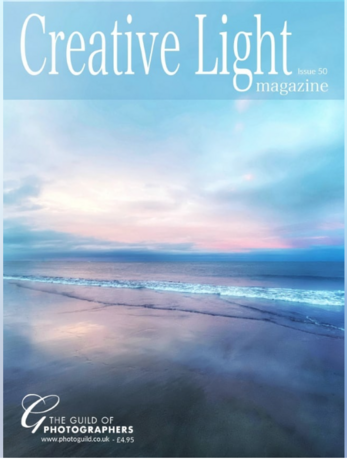


















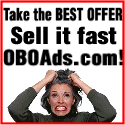
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot












