-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:26Culture - 16 juin 2013 à 00:21Pas de commentaires11es Rencontres cinématographiques de Béjaïa
Un cinéma meurtri
Ultime jour de cette 11e édition. Au menu ? Un film sur le Cinéma, sur un cinéma détruit de l’intérieur, sur le Cambodge et sur le massacre des Khmers rouges. Rencontre avec son auteur, l’érudit Davy Chou.
Il s’appelle Davy Chou. Français d’origine cambodgienne, venu spécialement de l’ancien pays de Pol Pot, pour échanger avec le public bougiotte, Chou, du haut de ses trente balais se pose devant moi. « Désolé monsieur, pas de thé maison, juste du lipton », lui assène le charmant serveur, déjà reparti à l’intérieur du café, pour y ramener un « lipton ». Chou regarde ses mails via son iPhone, respire l’air de la place Gueydon et d’emblée, me questionne sur des bonnes tables qu’il pourrait trouver sur Alger : « Je compte y aller, deux jours avec mon ami, l’écrivain Sabri Louatah, voir un peu ce qui s’y passe. Et j’ai très envie de découvrir la gastronomie de la ville. Ne connaissant pas la capitale, ça m’intrigue. » Qu’il se rassure, cela fait un bail que cette «capitale des douleurs» intrigue les Algérois… Pourquoi Davy Chou ? Parce que le Cambodge, le cinéma, le retour aux sources, la vitalité d’un cinéma revenu de pas mal de choses. Terribles et effrayantes à la fois. Comment faire pour décrypter un pan du cinéma cambodgien sans utiliser la base, les images ?
Rithy Pahn, en mai dernier, nous livrait une belle réponse dans son très beau dernier opus, «L’Image manquante», en reconstituant des scènes à partir de tableau où se retrouvaient des personnages, des poupées en terre d’argile, et ça fonctionnait. Surtout que le texte pensé et écrit par le sieur Pahn avait ce mélange de délicatesse et de transparence qui donnait à son cinéma, une certaine idée de sa propre fonction, être témoin coûte que coûte d’une période donnée, d’une histoire, voire de son récit personnel. Bon, Davy Chou. Qui est-il réellement ? Officiellement, on peut lire sur le Net ces lignes suivantes : « Il est le petit-fils de Van Chann, un des principaux producteurs du Cambodge dans les années 1960-1970. En 2009, création à Phnom Penh d’un atelier de cinéma avec 6 universités et 60 étudiants. En 2010-2011, il part au Cambodge à la recherche des témoins survivants (professionnels, spectateurs, bâtiments) de l’âge d’or du cinéma cambodgien, entre 1960 et 1975 (près de 400 films, dont beaucoup ont été détruits ou perdus sous les Khmers rouges). Il interviewe, entre autres, l’actrice Dy Saveth et les cinéastes Ly Bun Yim, Yvon Hem (décédé le 10 août 2012) et Ly You Sreang ». Sympa et très propre sur lui-même.
Officieusement, c’est une autre paire de manches
Avalant d’une traite son thé « Lipton », Davy me raconte son enfance, ce pays qu’on citait rarement dans le domicile familial, ses questions aux réponses parfois évasives et ses envies d’aller voir cette Terre aux origines mystérieuses. « Pour l’instant, ce n’est pas encore le moment, on verra plus tard », aimait à répéter son père, qui n’a jamais réellement offert au fiston la passion du cinéma. «Je le dois à mon oncle, qui m’emmenait voir des films de Van Damme, Willis, Schwarzie, des trucs que je ne regarde plus aujourd’hui, éloignés de ma cinéphilie, mais tout cela est drôle. » Très vite, on discute de sa première entrée en territoire khmer, lors de vacances d’été, durant l’année 2008. Trois semaines et la possibilité pour Davy d’épouser enfin son désir. L’année suivante, il repartira, cette fois-ci pour y vivre. L’expérience lui prendra 1an et demi de sa vie. Il ne le regrette pas surtout qu’aujourd’hui, il effectue maints voyages entre Phnom Penh et Paris, qu’il s’occupe de la restauration de classiques du cinéma cambodgien, qu’il participe à la mise en place d’un festival consacré à la mémoire, et initié par Rithy Pahn (Memory Festival) et enfin, qu’il ait pu réaliser ce très beau docu, sobrement intitulé « Le Sommeil d’or ».« Pourrais-je avoir un jus ? ». Davy a soif, le serveur est content et moi, j’en remets une couche, le questionnant. Davy : « Quand je me suis installé au Cambodge, il était hors de question pour moi d’y aller en pensant que ce serait ma quête initiatique, je voulais juste découvrir ce pays qui m’appartenait, que je ne connaissais pas. J’ai appris la langue, je me suis fait des amis, et j’ai proposé mes services dans des écoles afin d’y créer des ateliers. Et puis quand j’ai su que j’étais le petit-fils d’un producteur ciné de l’âge d’or, j’ai commencé à m’intéresser à ce cinéma. A comprendre aussi ce qui s’y était passé, et comment un régime totalitaire pouvait prendre le cinéma comme une arme mortelle, au point de l’éradiquer complètement de la carte. Et c’est comme cela, que le Sommeil d’or est né » Deux heures plus tard, Davy terminera son débat avec le public des « Rencontres », heureux, satisfait et rassuré. « Je suis content de n’avoir pas à poursuivre le débat le lendemain matin, au Café-ciné… suis complètement épuisé. » CQFD.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:25
Faouzi Bensaïdi, cinéaste marocain
«Exister comme des individus et non pas comme une tribu !»
Faouzi Bensaïdi est un chorégraphe de l’image, un musicien aux partitions enchevêtrées, mais surtout un cinéaste hors pair qui, au fil de six films (trois courts et trois longs), est aujourd’hui considéré comme l’un des réalisateurs les plus modernes et les plus créatifs du Maroc et de l’Afrique du Nord. Son dernier long-métrage, « Mort à vendre » (projeté en ouverture des 11es Rencontres cinématographiques de Béjaïa) est une perle cinématographique dont on sort à la fois troublés et heureux. Violent, triste et déroutant, il produit le même effet qu’une succession de morsures et de baisers, de bastonnades et de caresses. De bout en bout, « Mort à vendre » nous tient par le ventre, non pas dans la recette classique du thriller ou du film noir, mais bien par un enjeu esthétique et philosophique puissant. Allal, Malik, Sofiane, Dounia et les autres deviennent une partie de nous ; leur destin tragique (mais jamais misérabiliste) nous colle à la peau. Et c’est Faouzi Bensaïdi, le cinéaste-orchestre, qui nous a magistralement construit cette symphonie infernale, dont il nous parle dans cet entretien…
Algérie News : « Mort à vendre » est votre troisième long-métrage. Il contraste assez avec le précédent, « What a wonderful world », où il s’agissait plutôt d’un cinéma « expérimental ». Or, ce qui est admis généralement c’est de commencer par une forme plus ou moins linéaire pour aller vers des écritures éclatées ou déconstruites. Dans votre cas, c’est le contraire…
Faouzi Bensaïdi : J’ai toujours fait les choses à l’envers, peut-être par pur plaisir de contradiction. Il y a aussi une profonde peur de se répéter, d’ennuyer, de s’asseoir sur des semblants d’acquis, d’expérience, de savoir-faire. Je conçois chaque film comme un premier, une aventure à part ; j’ai envie d’explorer des choses, d’essayer, c’est ce qui me pousse à me réveiller à 5h du matin et aller au plateau de tournage avec plaisir et enthousiasme. Et puis faire du classique est quelque part, une expérimentation pour moi car je n’en ai jamais fait, donc c’est une première fois avec ses hésitations, ses inconnus, ses terrains glissants…Justement, lorsque je vois que « Mort à vendre » est communément classé dans le genre « polar », je ne suis pas trop d’accord, car vous y insufflez une telle fantaisie artistique et poétique, que cela devient un film d’auteur ! Qu’en pensez-vous ?
Absolument, c’est un film à la frontière des choses, du genre dans le cinéma. Il frôle le polar, le film noir, mais il est transplanté dans une réalité qui ne les a pas créés, donc différente, complexe et multiple, qui est la nôtre. Le genre est «contaminé», détourné… Il y a à la fois le respect et la révision des codes. J’aime bien me donner des règles, des directions, même des contraintes, mais permettre à l’imagination et sa liberté de les déjouer ou de les interpréter de manière personnelle…La manière dont vous filmez vos personnages, donne l’impression que vous les cherchez encore (physiquement j’entends). Expliquez-nous votre passion pour cette chorégraphie des corps, de la caméra et même du lieu…
Un des chocs esthétiques pour moi, dans mon adolescence, était la comédie musicale. Quand j’ai découvert cette forme au cinéma, pour moi c’était de l’art total. Je pense que quelque part, je chorégraphie tout dans mes films, évidemment les scènes de foule, les poursuites, mais aussi un homme qui ouvre une porte, rentre chez lui et fait les gestes les plus anodins… Il y a une précision du geste et du déplacement qui relève de la chorégraphie. Tout est histoire de musique et de rythme. Quand je faisais du théâtre, un de mes plaisirs était de régler les entrées et les sorties de scène des comédiens. Il y a toujours quelque chose de magique, de carrément miraculeux à trouver. Cela parait simple mais c’est beaucoup de travail pour que ça apparaisse comme ça. Quand la caméra fait un mouvement toute seule, et se détache de l’ensemble, c’est comme un solo de violon dans une formation orchestrale. Et si ce désir et ce défi n’existent pas dans un film, ça ne m’intéresse pas.Le père alcoolique de Allal, Malik qui couvre sa sœur amoureuse d’un homme marié… Il y a comme une volonté de contrecarrer l’image classique de l’homme (ou de l’autorité masculine) marocain ou maghrébin, en proposant ces anti-clichés par excellence…
Oui il y a presque un « commerce » dans l’art qui a trop duré, l’image du Sud « acheté » par le Nord et dès qu’on sort de ce schéma préétabli (la femme victime, l’homme fruste et violent, les personnages n’ont pas des têtes modernes, on croirait que les villes n’existent pas…), on est rejeté… Les hommes peuvent aussi être sensibles, compréhensifs, ouverts et les femmes peuvent être violentes, destructrices. C’est reconnaître l’humanité des uns et des autres que de les sortir de ces clichés. Il est temps que nous existions comme des individus et non pas comme une tribu… Ces clichés ont longtemps rendu les personnages simplistes sans relief et sans complexité, et du coup, pas crédibles à l’écran…Dans un cinéma maghrébin (et même mondial) qui n’arrive toujours pas à se débarrasser des clivages « méchants vs gentils », comment avez-vous réussi à éviter le manichéisme en empêchant le spectateur de juger vos personnages bien qu’ils soient antagoniques avec toutes les « valeurs » morales admises dans nos sociétés ?
J’aime tous mes personnages et je les aime aussi pour leur faiblesse, leurs conneries, leur aveuglement… Je cherche à les comprendre et non pas à les juger… Il y a toujours une raison derrière les comportements des gens… un abîme… un gouffre… une ambition… une illusion… un amour. L’être humain a une complexité si extraordinaire que réduire sa vie au bien et au mal, au noir et au blanc, est très réducteur. C’est cette richesse de l’âme humaine qui fait que l’art, la littérature continuent toujours à l’explorer, indéfiniment.Les scènes érotiques, les jurons et même quelques réflexions antireligieuses… Quand on sait que le film a été partiellement financé par le Centre cinématographique marocain, on s’étonne de cette liberté de ton à l’heure où ceux qui ne connaissent pas bien le cinéma marocain, croient que l’arrivée des islamistes au gouvernement, a tendance à limiter la liberté de création…
La liberté ne se donne pas, elle s’arrache et même quand on l’a, il faut la défendre, elle n’est jamais totalement acquise… Nous avons réussi, tous, artistes, journalistes, intellectuels, société civile, à élargir depuis des années la marge de liberté d’expression. Nous passons, comme d’autres pays arabes, par l’expérience démocratique qui a mené les islamistes au pouvoir. Il faut rester vigilant. Ce film était produit avant, il faut que les prochains, les miens ou ceux des autres, continuent à jouir de cette liberté d’expression.Il y a une certaine malice (voire de la cruauté) dans la fin de votre film. Je m’attendais à ce que Dounia s’enfuit réellement avec Malik, et c’est le contraire qui se produit… Considérez-vous que les «happy-end» sont surannées ?
Il y a une vision réaliste et sans illusions à la fin du film, c’est un film noir et la tragédie guette au bout du chemin périlleux de mes personnages. Ils évoluent dans un monde sans merci, et une fin heureuse aurait été difficile. Il y a aussi un deuxième niveau qui est le récit et le plaisir des rebondissements et du retournement des situations. Cela permet aussi de finir le film sur une multitude de possibilités et d’interrogations. L’art, à la différence de la télévision, ne rassure pas, heureusement ! votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:21Culture - 20 juin 2013 à 00:24«Manhattan» et «Demande à ton ombre» à la Filmothèque Zinet
RDV cinéphiles
Parfois, le calendrier est sympa avec le public. Deux dates, deux rendez-vous, deux ciné-clubs, et une même salle de cinéma. Jeudi 20 et vendredi 21 juin, il est possible de se faire une toile à la Filmothèque Zinet.
On l’avait déjà évoqué dans les colonnes d’Algérie News, on les avait déjà repérés. Qui ? Les lascars du ciné-club « Ciné Qua Non Zinet », qui après les projections de « Paris, je t’aime » et « Lost in Translation » (Sofia Coppola), reviennent hanter les lieux de la Filmothèque Zinet. Sont-ils épuisés ? Pas vraiment, surtout qu’ils adorent remettre des couches sur le bitume de l’Office Riad El Feth. Leur public, des artistes, des fous, des branquignols, des paumés, des amoureux d’un soir, des couples qui le temps d’un film refusent de s’accoupler, juste voir un film, est un mélange entre passionnés assaisonnés à l’adrénaline et « Inglorious bastards », qui ne se prennent aucunement au sérieux. Et tout en conservant cet état d’esprit, les organisateurs arrivent par, je ne sais quel truchement, à donner au lieu de projection, une vie meilleure, plus intéressante que celle qu’on entr’aperçoit dans d’autres manifestations pseudo-cinématographiques. Ils ont compris, ces « jeunes » de l’association Popium, initiatrice de ce beau concept, que les lamentations devenaient à la longue désuètes, qu’il fallait se perdre ailleurs, quitte à prendre des nationales, des routes de campagne au lieu des autoroutes sans surprises. En cela, le soutien des « gens normaux » leur sera toujours indéfectible.
Donc quid du film ? « Manhattan ». Classique réalisé par Woody Allen, légendaire ouverture du film sur fond de Gershwin, accompagnant les contours architecturaux de la ville de New-York, véritable protagoniste de ce film en noir et blanc, de ce chef-d’œuvre intemporel dont un critique de cinéma US écrira ce long monologue : « Manhattan est digne de sa réputation et peut-être le plus grand film de Woody Allen. Certainement son film le plus raffiné, alliant perfectionnement de la mise en scène et maturité visuelle. Mais le vrai triomphe du film réside dans la façon terriblement honnête de se créer. Même ses mensonges ne semblent exister que pour mettre en évidence l’éloignement de la vérité. Manhattan est peut-être son film le plus sombre, mais c’est la même obscurité trouvée chez Renoir et dans les comédies d’Ernst Lubitsch. » La suite ? Jeudi 20 juin à 20h à la Filmothèque Zinet.
Le lendemain, toujours dans la même salle, il faudra revenir squatter le lieu pour, cette fois-ci, découvrir la « première » algéroise du dernier film en date de Lamine Ammar-Khodja,
« Demande à ton ombre ».Beaucoup de choses ont été écrites ici et là, surtout dans ces toujours mêmes colonnes d’Algérie News. Le film est important, arrive à point nommé dans un paysage cinématographique sclérosé par le dénigrement créatif et le je-m’en-foutisme hallucinatoire. Entre complaintes d’un côté, et financements illogiques pour des œuvres sans queue ni tête, le sieur Khodja se pointe avec un film bricolé avec « rien » et de ce « vide », crée une œuvre changeante, maladroite, gênante, sensuelle, bouleversante, du vrai cinéma que l’on peut voir ailleurs, chez Djamel Beloucif, Amal Kateb, Nazim Djemaï, Hassen Ferhani, Yanis Koussim, Nabil Djedouani, Sami Tarik et Lucie Dèche, Omar Belkacemi, Mohamed Lakhdar Tati, tous ces visages qu’il ne faut aucunement regrouper dans la case d’une « nouvelle génération », juste des gens arrivés au bon moment et au parcours suffisamment différent pour qu’ils deviennent intéressants. Et Lamine Ammar-Khodja ? Voici ce qu’il dit à la critique de cinéma française, Marion Pasquier, lors d’un entretien : « Ce film m’a fait prendre conscience que je ne retournerai pas tout de suite vivre à Alger.
C’est vraiment le film de quelqu’un qui ne trouve pas sa place en revenant. J’ai pris conscience de la distance que j’avais. Sans rien renier à la proximité non plus. Mon film se tient dans cette distance-là. Je comprenais très bien le terrain et sa complexité sans jamais trouver ma place dans le jeu. Cette position ambiguë m’est apparue clairement un jour où j’étais à Alger : je n’avais pas trop envie de sortir, le moral à plat, et j’étais justement en train de lire un livre sur la ville. J’étais très content de lire ce livre sur Alger. Je trouvais cette ville fantastique et intrigante. C’était bizarre, j’étais plus content de découvrir des choses sur la ville en lisant le livre qu’en sortant tout simplement dans les rues. Je me suis dit que pour mes films j’allais faire la même chose. Recréer un espace pour me réapproprier cette ville et me réconcilier avec elle. Finalement, y vivre ou pas n’a pas tant d’importance. D’ailleurs, quand on me pose la question pour me demander si je suis retourné en France ou si je suis resté à Alger, je dis que j’habite mon imaginaire. C’est le privilège de la création. » Magnifique !
Avant de plier bagage, rappelons que cette initiative est due à l’association Chrysalide que nous avions perdue de vue depuis un certain temps. Bonne nouvelle de les revoir. Espérons que ces projections ne soient pas occasionnelles… Donc, RDV vendredi 21 juin à 20h à la Filmothèque Zinet.
Samir Ardjoum votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:16
«Comme tu assumes ta vie, tu assumes tes films»
Vendredi 21 juin 2013. Filmothèque Zinet. Le ciné-club de l’association Chrysalide organisait une projection du dernier film de Lamine Ammar-Khodja, « Demande à ton ombre ». Une conversation, enfin, s’imposait.
Algérie News : Tu as montré ton film, récemment, aux Rencontres cinématographiques de Béjaïa. C’était réellement la première fois que tu montrais ton film en Algérie ?
Lamine Ammar-Khodja : C’est la première projection en Algérie. J’avais montré mon film en juillet 2012 dans le cadre du FID Marseille, il y a de cela bientôt un an. Puis, j’avais discuté de l’éventualité de le présenter à Alger, avec les membres de l’association Chrysalide. On voulait faire cela en octobre dernier. Pour des histoires de calendrier, nous avions dû reporter. Il y avait aussi l’Institut français d’Alger avec qui nous avions prévu de le projeter. Mais là-aussi, ça n’a pas pu se faire. Après, je ne connais que ces deux endroits pour présenter le film. C’étaient les seules possibilités que j’avais. Du coup, la « première » s’est faite à Béjaïa.Si demain, la direction artistique du Festival du film arabe d’Oran te contacte…
J’y vais. Pourquoi refuserais-je ? Je ne vois aucune raison à cela. J’irais à Oran montrer le film. Un film c’est fait pour être vu. Je te raconte une anecdote. Je me trouvais récemment à Tétouan. Etait présente une délégation algérienne. Parmi elle, une dame qui avait des connexions avec le festival d’Oran. On s’est rencontré le premier jour. Je lui ai dit que je présentais un film. Elle n’est pas venue le voir. Cela ne l’intéressait pas. Puis le film a obtenu une mention. À ce moment-là, elle vient vers moi et me dit : « On va montrer le film ». Alors qu’elle ne l’avait même pas vu ! Difficile de la prendre au sérieux. Ce n’est pas mon travail de démarcher. C’est à eux de le faire. Personnellement, je trouve très bizarre que le film mette autant de temps à être montré en Algérie. Malheureusement, nous dépendons d’un système de production où la reconnaissance vient de l’étranger. Tu peux être un « Antonioni » si tu veux, si tu n’es pas reconnu à l’étranger, tu n’as aucune chance de faire quoique ce soit dans ton propre pays. Tu passes inaperçu. Regarde Tariq Teguia. Il montre d’abord son film à Venise, il assure ses arrières, et donc un véritable coup de projecteur, puis le film est montré en Algérie. Il n’y a pas de gens qui s’intéressent aux films, pas assez curieux. Ou alors il faut les connaître, ce qui n’est pas mon cas. C’est vraiment schizophrène. C’est pour cela que je soutiens le projet de Chrysalide de montrer les films des jeunes réalisateurs. C’est primordial.J’ai l’impression qu’il existe un microcosme de cinéastes dont tu fais partie, qui peinent à montrer leurs films et, de ce fait, on les case en marge du cinéma algérien, alors qu’ils n’ont rien fait pour tomber dans ce travers. Je pense notamment à Djamil Beloucif, Mohamed Lakhdar Tati, Nabil Djedouani, Hassen Ferhani, Nazim Djemaï, Amal Kateb…
Oui, Amal par exemple, dont le film «On ne mourra pas » se déroulait à Oran et qui n’a jamais été montré à ce festival. Je suis d’accord avec toi concernant la marge. Je fais des films, je veux les montrer, je ne me considère pas comme un cinéaste de la marge. Il n’y a pas cette volonté. On se trouve marginalisé sans vraiment le vouloir.Parlons du film. « Demande à ton ombre » n’est pas ton premier opus…
Pour moi, c’est mon premier film.Ah bon ?
C’est clair. Les choses que j’ai faites avant m’ont servi à construire ce film. Des premiers pas en quelque sorte. J’essayais des choses, j’expérimentais. Et tout cela a donné « Demande à ton ombre ».Il y a tout de même de l’expérimentation dans ce film ?
Oui, mais il y a quelque chose qui se met en place à partir de ce film, quelque chose de plus tangible. Le fait de construire un film à la première personne, de se mettre en scène, devenait à la longue une possibilité importante pour moi de faire le film. Et puis de par ce procédé, j’aspirais à ne rien cacher, d’être dans la subjectivité, la mienne. Pour moi, c’est un véritable engagement de donner son avis dans un contexte politique assez chaud. C’est un acte citoyen en quelque sorte.Et c’est rare de voir cela dans le paysage algérien
Oui, mais c’est dur d’assumer son choix. Peut-être la chose plus difficile pour un jeune cinéaste. Par exemple pour « Demande à ton ombre », c’est une biographie de sentiments entassés les uns à côté des autres pendant une période. Quand je le revois, je trouve qu’il y a des choses un peu dures. Sur certains aspects, je me suis un peu trop emporté ou alors telle séquence est peut-être trop triste. Et pourquoi je vois ça avec du recul ? Parce que ce sont des sentiments qui datent de deux ans. Et c’est le procédé de l’autobiographie avec son lot de doutes, de joies, de colères, un parcours qui n’est pas si simple, car il faut assumer ses sentiments, accepter de s’être trompé, d’avoir été excessif, d’avoir eu des sentiments humains.Tu n’as pas peur que tes films vieillissent mal ?
Non, car on vit des choses durant une période, on fait un film et ça reste. C’est comme si tu me disais t’être battu avec ton frère il y a dix ans de cela et que tu regrettais. Que tu regrettes ou pas n’a pas tant d’importance, c’est arrivé c’est tout. C’est la vie. Comme tu assumes ta vie, tu assumes tes films.Tu peux changer d’avis, mais pas tes films
Ce n’est pas grave. Heureusement que la vie avance. De toutes les façons, un film, c’est un sentiment qu’on prend à un moment donné.Si un spectateur quinquagénaire te disait, après avoir vu ton film, que rien n’a changé depuis sa jeunesse, comment réagirais-tu ?
Cela me ferait peur, surtout pour l’Algérie (rire).Ton film est un journal intime. Tu nous dévoiles des pans de ta personnalité. Mais on ne voit pas ton rapport aux femmes, à ta femme. D’ailleurs, quand on regarde les films réalisés par des cinéastes qui ont le même rapport que toi au cinéma, on constate aussi l’absence de femmes et notamment de leur propension à ne pas trouver la distance pour la filmer.
C’est la preuve que c’est une construction et que ce n’est pas totalement autobiographique (rire). Sérieusement, pour « Demande à ton ombre », j’ai filmé ce que j’ai trouvé devant moi. Et si tu n’y vois pas de femmes, c’est que ça raconte quelque chose. Regarde Amel, elle fait des films et elle filme des hommes.D’ailleurs, la séquence est assez belle quand elle se filme avec son « homme ».
Oui très belle !C’est vrai qu’on te voit faire la vaisselle, danser, attraper un cafard, dans ton quotidien. Par contre, je me souviens que dans ton web-donc (Un été à Alger), il y a des moments où tu te demandes pour quelles raisons ne trouve-t-on pas de femmes dans ton film ?
Oui, c’est vrai et dans le prochain, les choses changeront aussi. Il y aura cette question de savoir pourquoi c’est compliqué de filmer des femmes. Il y a toujours cette distance particulière et émouvante à la fois. Mais, de toutes les façons, le personnage, le mien, est une construction. A partir du moment où tu choisis les sentiments que tu veux faire partager, c’est que tu construis quelque chose, en l’occurrence mon personnage. Ma mère en regardant le film me disait que le côté autobiographique ne la gênait pas, car au fond, je ne parlais que de moi. Pas de ma famille, juste de moi. On en revient là-encore à la construction. Je raconte des choses liées à l’actualité.D’ailleurs, avec le format du journal intime, j’ai parfois l’impression que ta caméra juge ceux qu’elle filme. Deux séquences me reviennent à l’esprit et qui se déroulent durant la même manifestation. D’une part, on y voit des gens manifester, d’autre part, tu nous montres un homme sur sa terrasse observant ces gens, puis revenant sur ses pas pour rentrer chez lui, tout penaud. D’un côté, tu as une manière de filmer comme si ta caméra se trouvait au-dessus des gens, comme si tu les taquinais, d’un autre côté, tu montres cet homme en contre-plongée, avec une distance qui crée une réflexion, un état des lieux. Je trouve cette séquence beaucoup plus forte que la première.
Je ne pense pas qu’il y ait un problème de distance. A partir du moment où tu filmes cette manifestation, tu as le droit de dire ce que tu as vu. C’est ce que faisait Chris Marker. Il filme les manifs, il a le temps du recul puis décrit ce qu’il voit. Il te fait le hors-champs, t’explique ce que tu ne vois pas dans les images pour ce que cela devient intelligible pour toi, étranger à la scène. Dans mon film, les manifs sont récupérées de cette manière. Après, peut-être que c’est parfois taquin…Mais…. Par exemple, dans la manifestation du 12 février, tu sais, celle où je parle de calvitie…Oui, mais chez Marker, il n’y a pas comme on voit dans ton film, des parallèles entre les manifs et des choses qui seraient de l’ordre de la taquinerie. Je pense notamment à la « boite à meuh », à ton texte. Parfois, cela devient énervant. J’aurais pu être dans cette manifestation avec mes doutes et mes convictions et en voyant ton film, je pourrais me dire : « il se fiche de moi ».
Regarde Nanni Moretti quand il filme une manif’ de la Gauche. Il dit : « Je vois des parapluies ». Il le fait et pourtant il se trouve dans la manif’.Oui mais parce qu’ils ont des parapluies.
Dans mon film, c’est la même chose, mais au lieu de parapluies, je vois des calvities. Après, c’est vrai que c’est taquin. Il ne faut pas oublier une chose. Je me trouvais parmi eux et ce sont mes images. Après, je prends le recul pour prendre position. Et c’est filmé du côté du groupe où je me suis senti enfermé. Avec le recul, je dis que je me suis trompé de trottoir.Un moment, dans ton film, tu te retrouves chez toi, face à une page blanche, et tu essaies d’écrire.
C’était un pied de nez contre cette «loi» qui dit en gros qu’il faut écrire avant d’aller tourner. Je préfère prendre ma caméra avec ce sous-titre qui dit : « j’écrirais mon film avec la caméra ».A ce moment-là, tu ne sais pas où tu vas avec ton film.
Oui, je découvre le film en le faisant. J’ai compris de quoi il s’agissait très tardivement. Récemment, j’ai rajouté un épilogue où je parle de la mort d’Edouard Glissant et de sa pensée archipélique. Car je me suis rendu compte que j’avais filmé des petits ilots fragmentés et isolés les uns des autres. Je voulais raccommoder tous ces ilots pour construire un archipel. Raccommoder quelque chose qui n’est pas réparable. Le film, c’est un peu ça. Il y a aussi autre chose. Quand je suis revenu en Algérie, j’étais très étonné du manque d’intérêt des gens qui m’entouraient pour la vie politique de notre société. Il y avait des émeutes qui surgissaient et je constatais qu’on n’y prêtait aucune attention. Je n’arrive pas à comprendre comment c’est possible. Toute cette actualité brûlante…tu ne peux pas me dire que cela ne te touche pas, à moins d’être aliéné de ta société. La rue était grouillante et ce qui m’a toujours intéressé, c’est de réfléchir à la manière de ramener la rue au cinéma. Comment l’extérieur influence-t-il l’intérieur. D’où cet aller-retour permanent entre les deux dans le film. Et puis le retour n’a pas été si simple pour moi. Il y avait ce sentiment d’isolement me concernant. C’était douloureux. Mais faire un film, c’est essayer de dépasser sa douleur. Ne pas être trop énervé. La colère est un sentiment éphémère. Il faut construire de la beauté à partir de ta douleur. Sinon, cela devient du pathos. C’est un peu ça faire un film. Dire : « Qu’est-ce que j’ai compris de ma douleur ?». Quand on travaille sur l’actualité, il faut faire attention à ne pas trop rester figé dans le présent. C’est Godard qui disait, les mauvais films sont au présent. Il faut être dans le présent et avoir le recul nécessaire pour garder un oeil vers l’horizon.Propos recueillis par Samir Ardjoum
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Août 2013 à 17:10
Béatrice Sprunger, comédienne suisse
«Il ne faut pas niveler la langue par le bas»
Comédienne suisse d’origine roumaine, Béatrice Sprunger vient pour la première fois en Algérie, invitée par le Festival “Raconte-arts” dont la dixième édition se clôture mardi prochain. Son monologue “Je suis debout”, écrit par Alice Zeniter, a été joué devant un public nombreux à l’école primaire d’Aggouni-Ahmed à Ath Yenni.
Algérie News: Votre monologue est marqué par une densité et une complexité littéraires assez soutenues. N’aviez-vous pas peur que cette prose foisonnante n’empiète sur le jeu proprement théâtral?
B. Sprunger: Non, bien au contraire. Plus le texte est riche, plus on peut s’amuser dans le jeu et chercher la meilleure manière de le faire entendre. Si le texte est plat, je trouve qu’il est plus difficile à jouer. Avec “Je suis debout”, il y a quelque chose d’assez jouissif, il y a également de l’humour… En fait, c’est écrit comme une espèce de puzzle et c’est sur la fin qu’on comprend vraiment ce qui se passe. Je ne m’estime pas particulièrement douée en écriture ; par contre, j’adore me mettre en vecteur, m’approprier l’écriture de quelqu’un d’autre, essayer de palper l’âme de l’auteur. C’est un mariage entre tout cela et ce qu’on est. Par la suite, on essaie de le faire le plus ouvertement possible pour que chacun puisse prendre ce qu’il veut.Au-delà du traumatisme de cette femme, il y a dans votre monologue une critique acerbe de la société moderne. Y dénoncez-vous la dépersonnalisation de l’individu?
C’est une horreur ! Je trouve qu’effectivement, on se désensibilise d’une manière très violente. Contrairement à votre pays où l’on parle beaucoup de solidarité, chez-nous, ce n’est pas toujours évident. Il est vrai que cela existe, qu’on s’organise entre groupuscules, mais disons que devant quelqu’un qui se fait agresser, la majorité des gens vont sortir un téléphone portable pour filmer au lieu d’appeler les secours! Pour moi, c’est ce petit truc là qui ressort quand Alice écrit “Nos artères sont des kits mains-libres et le coeur est un petit I-Pod Shuffle”… C’est la division. Et certains se prennent vraiment pour des machines. Cependant, je refuse de croire que l’avenir appartiendra à des machines car je pense qu’on est quand même nombreux à lutter contre cela. D’ailleurs, un des rôles de la culture consiste à réveiller l’humanité chez les gens, de rappeler que d’où qu’on vienne et quelles que soient nos histoires, on a des choses qui nous relient, sans avoir besoin de parler la même langue puisque nous avons tous des tripes, un coeur, une âme et que cela est absolument universel…La dramaturgie et la force littéraire du texte ont été quelque peu déteriorées par le dénouement du monologue puisqu’il résoud le mystère du récit. Ne pensez-vous pas que l’explication porte atteinte à l’art?
On découvrira, certes, ce qui est arrivé à cette femme mais on ne saura pas ce qui s’est réellement passé. Le mystère reste quand même présent. Par ailleurs, je pense que pour Alice, ce n’était pas facile de me diriger en tant que comédienne. On a fait plusieurs essais et on est resté au début sur quelque chose de plus distant. Le seul moment où l’on comprend un peu ce qui s’est passé, c’est à partir d’une seule phrase que je prononce…Beaucoup pensent ici que le théâtre doit être “lavé” de sa réputation d’art élitiste et qu’il doit aller vers le peuple avec le langage de ce dernier. De ce fait, ils sont opposés à ce théâtre littéraire et complexe dans lequel semble s’inscrire votre monologue. Qu’en pensez-vous?
Je pense que ce débat a déjà existé en France également mais aujourd’hui, il y en a vraiment pour tous les goûts: autant de pièces qui usent de vocabulaire de rue, autant il y a de jeunes auteurs qui écrivent dans un langage soutenu. Personnellement, j’estime que la langue est riche et que c’est dommage de la niveler par le bas, qu’il ne faut pas prendre les gens pour des bœufs. Quand on voit le désastre de ces jeunes qui ne savent plus écrire correctement à cause de l’écriture texto, c’est déjà assez regrettable comme ça ! Je pense que le théâtre peut se vulgariser aisément mais pas en coupant forcément dans la langue; cet art a toujours puisé dans la culture du peuple. Vous avez Kateb Yacine dont le théâtre parle de la rue avec un langage de théâtre et ça ne veut pas dire que l’homme de la rue ne peut pas le comprendre. Nous avons fait des tests dans le sillage de cette question: nous avons organisé des ateliers avec des ados, animés par des auteurs comme Xavier Duringer dont l’écriture est populaire, mais nous avons également pris du Shakespeare traduit dans un français assez soutenu… En fin de compte, nous avions eu une réaction très étrange : les jeunes préféraient se tourner vers Shakespeare… Certes, Duringer parle des problèmes des jeunes; chose par laquelle nous sommes tous passés quand on a commencé le théâtre. Mais en fin de compte, on s’aperçoit que ça ne va pas très loin… Il faut dire que le français est une langue plate et linéaire et, donc, plus difficile à jouer, comparée à l’allemand, au russe ou aux langues africaines, lesquelles portent en elles-mêmes des mouvements et des oscillations. Avec le français, il faut trouver l’accroche qui vous aide à jouer, où le corps se réveille. Et si vous n’avez pas cette accroche, on le voit avec certains comédiens: ils ont un corps mort… Si on veut ramener la rue sur scène, il faut le faire d’une manière intelligente, et dans ce cas-là, je suis pour cette démarche qui consiste à parler aux gens de ce qui se passe ici et maintenant et non pas des problèmes des rois d’antan ! On doit cependant le faire d’une manière poétique, car ça touche beaucoup plus que le réalisme cru ; il faut que ce soit de la création et non pas de la transposition… Prenons l’exemple des SDF: je trouve indécent et horrible qu’un comédien fasse semblant d’être un sans-abri sur scène…Vous avez participé à la création “Beckett Hikmet” à Istanbul. Quelles affinités trouvez-vous entre le dramaturge irlandais et le poète turc ?
En fait, ce qui me touche beaucoup en général c’est la rencontre d’un auteur et d’un pays et de voir à quel point le poète est important dans la pensée populaire. En Turquie, j’ai vu que tout le monde connait Nazim Hikmet, ses chansons et ses poèmes. C’est quelqu’un qui symbolise tout un pays et c’est cela qui me fascine car nous n’avons pas l’équivalent de cela en France, où les productions sont très riches, les auteurs intéressants tellement nombreux que nous n’avons pas de symbole. C’est donc ce rapport là au poète populaire et à une parole du peuple, qui m’a captivée. Le lien entre Hikmet et Beckett n’est pas forcément littéraire. Ce sont, tous les deux, des contestataires : Pour Beckett, on a choisi deux textes dont l’un parle de la manipulation du pouvoir et traite des dictatures avec beaucoup d’humour mais aussi de cruauté. On retrouve ce même ton chez Hikmet.Vous avez également joué dans “Baal”, le premier texte de Berthold Brecht… Comment était cette expérience de revenir vers un texte de jeunesse d’un des plus grands dramaturges de notre histoire?
Brecht était le premier qui m’a donné envie de faire du théâtre, et c’est toujours pour les mêmes raisons que je le fais aujourd’hui. Il m’a appris à utiliser un langage différent dans mon rapport au monde, à taper là où ça fait mal mais avec distance. En ce qui concerne “Baal”, nous avons travaillé sur plusieurs traductions et on a fini par choisir celle qui nous paraissait la plus juste, en l’occurrence celle de la première version de Brecht qui est beaucoup plus percutante que celles qui suivront (retravaillées par Brecht). c’est sa première pièce vraiment anarchiste où l’on retrouve l’idée de l’abolition du pouvoir mais surtout l’énergie de la jeunesse: ce n’était pas le Brecht qui donne la leçon, ni le Brecht communiste. C’est celui que j’ai toujours aimé : qui expose le problème et te laisse en décider, sans jamais donner la solution. Je pense que c’est cela la vocation du théâtre : poser les questions qu’il faut sans pour autant prodiguer les réponses.Propos recueillis par Sarah H.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien





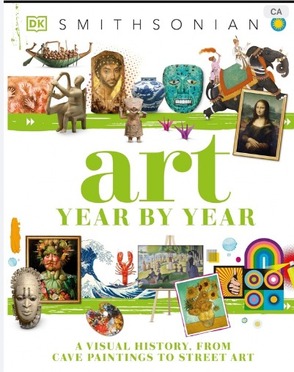




















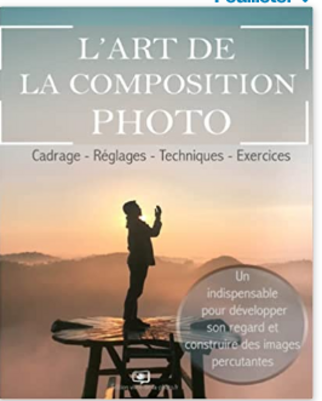







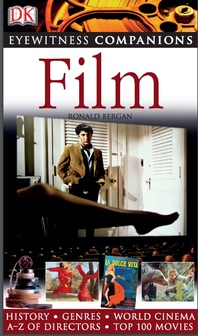





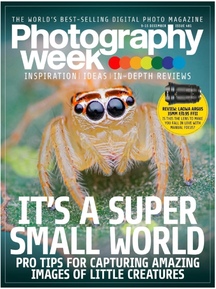



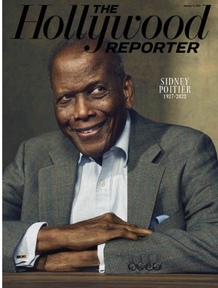








































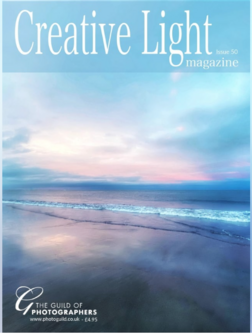

















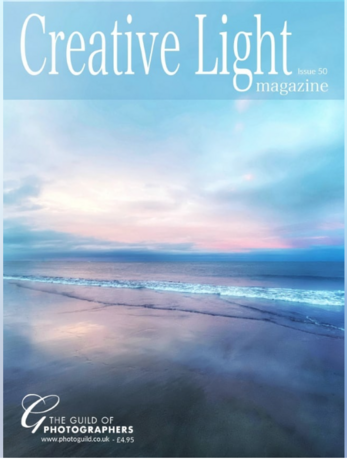


















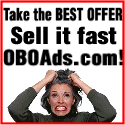
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot














