-
Par hechache2 le 24 Août 2013 à 17:06
Répertoire des fonds d'archives
A
ABEILLÉ, JEAN
 Fonds : Jean Abeillé
Fonds : Jean Abeillé
ACADÉMIE DU CINÉMA (PARIS)
 Fonds : Georges Franju
Fonds : Georges Franju
AGUETTAND, LUCIEN
 Fonds : Lucien Aguettand
Fonds : Lucien Aguettand
AITKEN, HARRY
 Fonds : Triangle Film Corporation - Harry E. Aitken
Fonds : Triangle Film Corporation - Harry E. Aitken
ALEKAN, HENRI
 Fonds : Henri Alekan
Fonds : Henri Alekan
ALEXANDRE, ALEXANDRE
 Fonds : Alexandre Alexandre
Fonds : Alexandre Alexandre
ALLÉGRET, MARC
 Fonds : Marc Allégret
Fonds : Marc Allégret
ALLÉGRET, YVES
 Fonds : Guy Meunier ou Yves Allégret
Fonds : Guy Meunier ou Yves Allégret
ANDREÏ, LUCETTE
 Fonds : Lucette Andreï
Fonds : Lucette Andreï
ANDREU, ANNE
 Fonds : Francis GIROD et Anne ANDREU
Fonds : Francis GIROD et Anne ANDREU
ARONOVICH, RICARDO
 Fonds : Ricardo Aronovich
Fonds : Ricardo Aronovich
AUDRAN, STÉPHANE
 Fonds : Stéphane AUDRAN
Fonds : Stéphane AUDRAN
AUMONT, JEAN-PIERRE
 Fonds : Jean-Pierre Aumont
Fonds : Jean-Pierre Aumont
AUTRÉ, PIERRE
 Fonds : Pierre Autré
Fonds : Pierre AutréB
BARONCELLI JACQUES (DE)
 Fonds : Jacques de Baroncelli
Fonds : Jacques de Baroncelli
BAUDROT, SYLVETTE
 Fonds : Sylvette Baudrot-Guilbaud
Fonds : Sylvette Baudrot-Guilbaud
BÉRAUD, LUC
 Fonds : Luc Béraud
Fonds : Luc Béraud
BERCHOLZ, JOSEPH
 Fonds : Joseph et Lydia Bercholz
Fonds : Joseph et Lydia Bercholz
BERCHOLZ, LYDIA
 Fonds : Joseph et Lydia Bercholz
Fonds : Joseph et Lydia Bercholz
BERGMAN, INGMAR
 Fonds : Ingmar Bergman
Fonds : Ingmar Bergman
BERLEY, ANDRÉ
 Fonds : André BERLEY
Fonds : André BERLEY
BERTIN, JEAN
 Fonds : Jean Bertin
Fonds : Jean Bertin
BIETTE, JEAN-CLAUDE
 Fonds : Jean-Claude Biette
Fonds : Jean-Claude Biette
BILLARD, GINETTE
 Fonds : Pierre Billard
Fonds : Pierre Billard
BILLARD, PIERRE
 Fonds : Pierre Billard
Fonds : Pierre Billard
BOROWCZYK, WALERIAN
 Fonds : Walerian Borowczyk
Fonds : Walerian Borowczyk
BOURGEOIS, GÉRARD
 Fonds : Gérard Bourgeois
Fonds : Gérard Bourgeois
BOURGOIN, JEAN
 Fonds : Jean Bourgoin
Fonds : Jean Bourgoin
BRUNIUS, JACQUES BERNARD
 Fonds : Jacques-Bernard Brunius
Fonds : Jacques-Bernard BruniusC
C.F.C.E. - CENTRE DE FORMATION DU COMÉDIEN D'ECRAN (PARIS)
 Fonds : Centre de Formation du Comédien d'Ecran
Fonds : Centre de Formation du Comédien d'Ecran
CARDINALE, CLAUDIA
 Fonds : Claudia CARDINALE
Fonds : Claudia CARDINALE
CARNÉ, MARCEL
 Fonds : Marcel CARNE et Roland LESAFFRE
Fonds : Marcel CARNE et Roland LESAFFRE
CARON, PIERRE
 Fonds : Pierre Caron
Fonds : Pierre Caron
CAVALCANTI, ALBERTO
 Fonds : Aberto Cavalcanti
Fonds : Aberto Cavalcanti
CHABROL, CLAUDE
 Fonds : Claude Chabrol
Fonds : Claude Chabrol
CHARBONNIER, PIERRE
 Fonds : Pierre Charbonnier
Fonds : Pierre Charbonnier
CHAVANCE, LOUIS
 Fonds : Louis Chavance
Fonds : Louis Chavance
CHÉREAU, PATRICE
 Fonds : Patrice Chéreau
Fonds : Patrice Chéreau
COMMISSION DE RECHERCHE HISTORIQUE
 Fonds : Commission de Recherche Historique
Fonds : Commission de Recherche Historique
CORNAZ, OSCAR
 Fonds : Louis Delluc (fonds forgé)
Fonds : Louis Delluc (fonds forgé)
COSTA-GAVRAS
 Fonds : Costa-Gavras
Fonds : Costa-Gavras
COUTURIER, LAURENCE
 Fonds : Laurence Couturier
Fonds : Laurence Couturier
CRÉDIT NATIONAL
 Fonds : Crédit National
Fonds : Crédit NationalD
DAY, WILFRED ERNEST LYTTON
 Fonds : Wilfred Ernest Lytton Day
Fonds : Wilfred Ernest Lytton Day
DE LUCA, JOSÉE
 Fonds : Josée De Luca
Fonds : Josée De Luca
DELLUC, LOUIS
 Fonds : Louis Delluc (fonds forgé)
Fonds : Louis Delluc (fonds forgé)
DELORME, DANIÈLE
 Fonds : Danièle Delorme
Fonds : Danièle Delorme
DEMENŸ, GEORGES
 Fonds : Georges Demenÿ
Fonds : Georges Demenÿ
DOUARINOU, JEAN
 Fonds : Jean Douarinou
Fonds : Jean Douarinou
DUHAMEL, ANTOINE
 Fonds : Antoine Duhamel
Fonds : Antoine Duhamel
DULAC, GERMAINE
 Fonds : Germaine Dulac
Fonds : Germaine DulacE
EISENSCHITZ, BERNARD
 Fonds : Bernard EISENSCHITZ
Fonds : Bernard EISENSCHITZ
EMMER, LUCIANO
 Fonds : Luciano Emmer
Fonds : Luciano Emmer
EPSTEIN, JEAN
 Fonds : Jean et Marie Epstein
Fonds : Jean et Marie Epstein
EPSTEIN, MARIE
 Fonds : Jean et Marie Epstein
Fonds : Jean et Marie Epstein
ESNAULT, PHILIPPE
 Fonds : Philippe Esnault
Fonds : Philippe Esnault
ÉTIÉVANT, HENRI
 Fonds : Yvette et Henry Etiévant
Fonds : Yvette et Henry Etiévant
ÉTIÉVANT, YVETTE
 Fonds : Yvette et Henry Etiévant
Fonds : Yvette et Henry Etiévant
EVEIN, BERNARD
 Fonds : Jacqueline Moreau-Bernard Evein
Fonds : Jacqueline Moreau-Bernard EveinF
FESCOURT, HENRI
 Fonds : Henri Fescourt
Fonds : Henri Fescourt
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (CANNES)
 Fonds : Festival International du Film de Cannes : Service Administration
Fonds : Festival International du Film de Cannes : Service Administration Fonds : Festival International du Film de Cannes : Service Presse
Fonds : Festival International du Film de Cannes : Service Presse Fonds : Festival international du film de Cannes : Service Régie
Fonds : Festival international du film de Cannes : Service Régie
FEUILLADE, LOUIS
 Fonds : Louis Feuillade
Fonds : Louis Feuillade
FEYDER, JACQUES
 Fonds : Irène Moeller/Jacques Feyder
Fonds : Irène Moeller/Jacques Feyder
FIESCHI, JACQUES
 Fonds : Jacques Fieschi
Fonds : Jacques Fieschi
FONTERAY, JACQUES
 Fonds : Jacques FONTERAY
Fonds : Jacques FONTERAY
FRANCESCHI, RENATA
 Fonds : Renata Franceschi
Fonds : Renata Franceschi
FRANCIS, ÈVE
 Fonds : Louis Delluc (fonds forgé)
Fonds : Louis Delluc (fonds forgé)
FRANJU, GEORGES
 Fonds : Georges Franju
Fonds : Georges FranjuG
GANCE, ABEL
 Fonds : Abel Gance
Fonds : Abel Gance
GAUMONT, LOUIS
 Fonds : Louis Gaumont
Fonds : Louis Gaumont
GAUT, PIERRE
 Fonds : Pierre Gaut
Fonds : Pierre Gaut
GERGELY, FRANÇOIS
 Fonds : François Gergely
Fonds : François Gergely
GIROD, FRANCIS
 Fonds : Francis GIROD et Anne ANDREU
Fonds : Francis GIROD et Anne ANDREU
GITAI, AMOS
 Fonds : Amos GITAI
Fonds : Amos GITAI
GOURGUET, JEAN
 Fonds : Jean Gourguet
Fonds : Jean Gourguet
GUILBAUD, PIERRE
 Fonds : Sylvette Baudrot-Guilbaud
Fonds : Sylvette Baudrot-Guilbaud
GUYCHARD, RENÉ
 Fonds : René Guychard
Fonds : René GuychardL
L'EQUIPE
 Fonds : L'Equipe
Fonds : L'Equipe
L'HERBIER, MARCEL
 Fonds : Marcel L'Herbier
Fonds : Marcel L'Herbier
LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE (PARIS)
 Fonds : Programmes CF
Fonds : Programmes CF
LACHENAY, ROBERT
 Fonds : Robert LACHENAY
Fonds : Robert LACHENAY
LANG, FRITZ
 Fonds : Fritz Lang
Fonds : Fritz Lang
LANGMANN, ARLETTE
 Fonds : Arlette Langmann
Fonds : Arlette Langmann
LE CERCLE DU CINÉMA (PARIS)
 Fonds : Le Cercle du cinéma
Fonds : Le Cercle du cinéma
LE CHANOIS, JEAN-PAUL
 Fonds : Jean-Paul Le Chanois
Fonds : Jean-Paul Le Chanois
LECONTE, PATRICE
 Fonds : Patrice Leconte
Fonds : Patrice Leconte
LES FILMS DU CARROSSE (PARIS)
 Fonds : François Truffaut
Fonds : François Truffaut
LES FILMS DU DIMANCHE (ROUEN)
 Fonds : Les Films du Dimanche
Fonds : Les Films du Dimanche
LESAFFRE, ROLAND
 Fonds : Marcel CARNE et Roland LESAFFRE
Fonds : Marcel CARNE et Roland LESAFFRE
LÉVESQUE, MARCEL
 Fonds : Marcel Lévesque
Fonds : Marcel Lévesque
LICHTIG, JOSÉ
 Fonds : Lucie Renée José Lichtig
Fonds : Lucie Renée José Lichtig
LICHTIG, LUCIE
 Fonds : Lucie Renée José Lichtig
Fonds : Lucie Renée José Lichtig
LICHTIG, RENÉE
 Fonds : Lucie Renée José Lichtig
Fonds : Lucie Renée José Lichtig
LONSDALE, MICHAEL
 Fonds : Michael Lonsdale
Fonds : Michael Lonsdale
LOSEY, JOSEPH
 Fonds : Joseph Losey
Fonds : Joseph LoseyM
MALLE, LOUIS
 Fonds : Louis Malle
Fonds : Louis Malle
MEERSON, LAZARE
 Fonds : Lazare Meerson
Fonds : Lazare Meerson
MÉLIÈS, GEORGES
 Fonds : Georges Méliès
Fonds : Georges Méliès
MIZRAHI, SIMON
 Fonds : Simon MIZRAHI
Fonds : Simon MIZRAHI
MOGUY, LÉONIDE
 Fonds : Léonide Moguy
Fonds : Léonide Moguy
MONCA, GEORGES
 Fonds : Georges Monca
Fonds : Georges Monca
MORDILLAT, GÉRARD
 Fonds : Gérard Mordillat
Fonds : Gérard Mordillat
MOREAU, JACQUELINE
 Fonds : Jacqueline Moreau-Bernard Evein
Fonds : Jacqueline Moreau-Bernard Evein
MORLHON CAMILLE (DE)
 Fonds : Camille de Morlhon
Fonds : Camille de Morlhon
MURNAU, F.W.
 Fonds : Friedrich Wilhelm Murnau
Fonds : Friedrich Wilhelm Murnau
MUSIDORA
 Fonds : Musidora
Fonds : MusidoraP
PANTHÉON DISTRIBUTION
 Fonds : Panthéon distribution
Fonds : Panthéon distribution
PASCAZIO, GLADYS
 Fonds : Gladys PASCAZIO
Fonds : Gladys PASCAZIO
PERLADO, MAGGIE
 Fonds : Maggie Perlado
Fonds : Maggie Perlado
PHILIPE, ANNE
 Fonds : Anne et Gérard Philipe
Fonds : Anne et Gérard Philipe
PHILIPE, GÉRARD
 Fonds : Anne et Gérard Philipe
Fonds : Anne et Gérard Philipe
PIALAT, MAURICE
 Fonds : Maurice Pialat
Fonds : Maurice Pialat
PINOTEAU, CLAUDE
 Fonds : Claude Pinoteau
Fonds : Claude Pinoteau
PORCILE, FRANÇOIS
 Fonds : François PORCILE
Fonds : François PORCILE
PRÉVERT, CATHERINE
 Fonds : Catherine Prévert-Daniel Vogel
Fonds : Catherine Prévert-Daniel VogelS
SADOUL, GEORGES
 Fonds : Georges Sadoul
Fonds : Georges Sadoul
SADOUL, RUTHA
 Fonds : Georges Sadoul
Fonds : Georges Sadoul
SANDRY, GÉO
 Fonds : Géo SANDRY
Fonds : Géo SANDRY
SAUTET, CLAUDE
 Fonds : Claude Sautet
Fonds : Claude Sautet
SCHIFFMAN, SUZANNE
 Fonds : Suzanne Schiffman
Fonds : Suzanne Schiffman
SOCIÉTÉ DES FILMS ALBATROS
 Fonds : Société des Films Albatros
Fonds : Société des Films Albatros
SPAAK, CHARLES
 Fonds : Charles Spaak
Fonds : Charles Spaak
STORA, BERNARD
 Fonds : Bernard STORA
Fonds : Bernard STORA
STROHEIM ERICH (VON)
 Fonds : Erich von Stroheim
Fonds : Erich von StroheimT
TACCHELLA, JEAN-CHARLES
 Fonds : Jean-Charles TACCHELLA
Fonds : Jean-Charles TACCHELLA
TATI, JACQUES
 Fonds : Jacques TATI
Fonds : Jacques TATI
TATI, PIERRE
 Fonds : Jacques TATI
Fonds : Jacques TATI
TAVERNIER, BERTRAND
 Fonds : Bertrand Tavernier
Fonds : Bertrand Tavernier
THOMPSON, DANIÈLE
 Fonds : Danièle Thompson
Fonds : Danièle Thompson
TRAUNER, ALEXANDRE
 Fonds : Alexandre Trauner
Fonds : Alexandre Trauner
TRIANGLE FILM CORPORATION (CULVER CITY)
 Fonds : Triangle Film Corporation - Harry E. Aitken
Fonds : Triangle Film Corporation - Harry E. Aitken
TRUFFAUT, FRANÇOIS
 Fonds : François Truffaut
Fonds : François TruffautZ
ZASTUPNEVICH, PAUL
 Fonds : Paul Zastupnevich
Fonds : Paul Zastupnevich
ZAVATTINI, CESARE
 Fonds : Cesare Zavattini
Fonds : Cesare Zavattini
ZUCCA, PIERRE
 Fonds : Pierre Zucca
Fonds : Pierre Zucca
ZURSTRASSEN ZOÉ ()
 Fonds : Zoé Zurstrassen
Fonds : Zoé Zurstrassen votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 14 Août 2013 à 14:30
DOSSIER Février 2013 
Le Petit Balthus et l’inquiétante étrangeté
des hasards objectifs. Sur quelques films
de François Truffaut
Par Sylvie Taussig, CNRS (UPR 76)La présence est célèbre et chère au cœur des cinéphiles, d’un tableau de Balthus qui n’a aucune place narrative dans un film qui ne parle pas particulièrement de la représentation et du miroir. Pourtant il fait mémoire, dans la scène la plus connue de Domicile conjugal, reprise dans L’amour en fuite, c’est-à-dire la récapitulation du cycle Doinel (1). Rappelons que Antoine Doinel est un personnage cinématographique de fiction, qui apparaît dans cinq films écrits et réalisés par François Truffaut et tous interprétés par Jean-Pierre Léaud : l’enfance dans Les Quatre Cents Coups (1959), la rencontre amoureuse dans Antoine et Colette (1962), fragment du film à sketch L’Amour à vingt ans, l’amour entre Antoine et Christine (Claude Jade) dansBaisers volés (1968), le mariage d’Antoine et Christine dans Domicile conjugal (1970) et les escapades d’Antoine et le divorce de Christine dans l’Amour en fuite (1979) (2).
Il fait mémoire, dans ce que la mémoire peut avoir de fantasmatique et de capable de troubler la rationalité, puisqu’on lit dans Wikipedia, à la page Balthus (3) « Anecdote cinématographique. Dans le film de François Truffaut Domicile conjugal (1970) […] les deux personnages principaux, Antoine Doinel (interprété par Jean-Pierre Léaud) et sa femme Christine (Claude Jade), se sont quelque peu disputés et vivent séparément. À un moment donné, Christine décroche du mur un petit dessin (4) d’environ 25 x 25 cm et le tend à son mari qui est venu voir leur enfant Alphonse : Christine : – Tiens, prends le petit Balthus.
Antoine : – Ah, le petit Balthus, je te l’ai offert, il est à toi, garde-le.
Ce dessin présente au premier plan un personnage sombre (de dos ?), dans une allée avec des arbres sur la gauche. Il ne ressemble à rien de ce que Balthus aurait dessiné et n’est pas illustré dans le catalogue raisonné (cf. Bibliographie), mais les recherches continuent pour l’identifier. »
Naturellement un tableau ressemblant fort à ce qui est ici filmé se trouve dans le catalogue raisonné, et j’y reviendrai.
Quand la mémoire se trouble, il est naturel de chercher les causes de cette étrangeté, et j’ai débord enquêté sur la présence de ce tableau dans les archives Truffaut (5), qui se sont révélées paradoxalement éclairantes. Mais une recherche génétique, ou archéologique ne pouvait suffire, ni même celle-là, biographique, qui est son corollaire. Comme un tableau figuratif, un film est à la fois une forme et un sens, un signifiant et un signifié, dont l’unité se saisit ici, comme à chacune fois qu’est donnée à voir une représentation dans la représentation, dans cette vignette qui ne peut se partager quand le couple se sépare. Le petit Balthus qui a signifié le couple est, comme le petit Alphonse, le reste d’un amour disloqué que l’on ne cesse de vouloir rattraper. Telle est l’opération de recouvrement de l’AF en fuite, entièrement placé sous le signe de la dialectique de l’image et de la mémoire, de l’image disloquée et recomposée, de la projection et de la distorsion.
Que tout film soit un montage, que la mémoire soit un montage, et que l’un et l’autre soient la vérité à condition qu’elle ne soit pas entendue comme une exactitude factuelle et historique, voilà ce que Truffaut démontre dans l’ultime exercice des Aventures de Doinel, où il réussit à prendre son indépendance par rapport à une dimension morale de l’art, énoncée par Christine dans la suite de la scène du petit Balthus, quand elle dit à Antoine « je n’aime pas tellement cette… cette idée de raconter sa jeunesse, de critiquer ses parents, de les salir. Je suis assez ignorante, mais je suis certaine d’une chose : une œuvre d’art ne peut pas être un règlement de comptes, ou alors ce n’est pas une œuvre d’art ».
Mon regard sur le cycle Doinel s’inscrit tout à fait dans la proposition de Guigue (6) : « la spécificité des œuvres de Truffaut, c’est qu’il est organique au sens où il y a une interdépendance des œuvres entre elles. […] Il reste à trouver un fil conducteur qui permette de se frayer un chemin à travers ce réseau. » Pour Guigue, le fil conducteur est « la culture » (p.13) « FT n’avait qu’une seule vraie passion en dehors du cinéma et des femmes : la littérature ». Il me paraît que ce découpage en trois passions ne rend pas bien compte de l’unité profonde qui les organise, unité dynamique, comme toute trinité, et que l’Amour en fuite révèle, par son travail sur la spécularité non pas de l’image, en une mise en abyme plus banale, qui se réaliserait pas l’insertion de miroir comme dans la tradition picturale (7), mais bien de la mémoire et du montage. Pour ce faire je décrirai d’abord l’aventure singulière du tableau, puis j’essayerai de mettre en perspective la spécularité du jeu des références qu’il implique, et la volonté de Truffaut de faire du cinéma réellement le septième art, et donc de renouveler la tradition du paragone (8). Le dernier moment de la réflexion semble fâcheusement séparer la forme du fond, puisque je vais plonger dans le tableau pour réfléchir sur la position du réel et de la fiction par le truchement d’un regard sur les femmes et les films du cycle, sans prétendre cependant faire la psychanalyse de Truffaut (9).
Le tableau est d’évidence un objet un peu fantasmatique, dans une scène qui est centrale dans l’ensemble du cycle, puisque Truffaut est censé y définir son éthique artistique par la voix de Claude Jade (« ne pas régler ses comptes »), ou si ce n’est pas son éthique artistique, c’est en tout cas celle qu’il se recommande et qui paraît entrer en vive contradiction avec l’apparente élaboration de ce cycle, dont on sait ce qu’il a d’autobiographique (10).
En effet, c’est le moment où l’identification avec Doinel est peut-être la plus forte, dans la mesure où Truffaut a toujours rêvé d’écrire un livre, qu’il n’écrira jamais, et sa passion pour les livres est peut-être ce qu’il y a de plus spectaculairement affiché dans ces films, notamment dans le cycle Doinel, où il n’y a pas un intérieur qui ne soit truffé de livres, sauf peut-être le magasin de disques de Sabine (dans AF), laquelle représente peut-être l’amour enfin possible, déjouant toutes les déclarations de chasteté et de théorie d’Antoine.
Antoine recevant un conseil de son épouse Christine, au moment où ils se séparent, sur ce que doit être la littérature est dans la position de Truffaut recevant potentiellement le même conseil de la part d’une femme par rapport à ses propres films, une femme qui, devenant sa conseillère artistique et son mentor moral, pourra être, comme Christine dans les yeux de Antoine, sa frangine, son amie, sa mère, etc. Rappelons ce fragment qui suit la scène du petit Balthus : « Tu es ma frangine, mon amie, ma mère, ma douceur. » – « J’aurais tellement voulu être ta femme. » Antoine du reste ne règle pas exactement ses comptes dans Les Salades de l’amour, son roman qui est en difficile gestation du temps de sa vie maritale, et que l’on voit enfin paru dans l’Amour en fuite. Dans ce livre, grâce auquel il retrouve Marie-France Pisier, alias Colette, il se récrit un autre passé, où il se donne le beau rôle (11).
La mystérieuse scène du petit Balthus est sans doute l’une des plus denses du cycle, et il faut bien parler de mystère, puisque si l’ensemble de la scène est conçu très tôt dans l’esprit de Truffaut, le détail du tableau n’apparaît dans aucun des différents états du scénario, depuis les toutes premières prémisses jusqu’à ses versions les plus définitives, comme s’il avait jailli du moment même de l’action du tournage, un hasard et une grâce.
Pour commencer par quelques considérations factuelles, le « petit Balthus » ne figure pas dans les squelettes, ni dans les notes de travail, ni dans les scénarios, ni dans la scénaristique, ni dans le scénario de tournage, bref dans aucun des documents antérieurs à la fabrication de DC. Il n’apparaît que dans le film. Nouvel étonnement, sa reprise n’est pas d’abord prévue dans l’AF, alors que des fragments de la scène où il prend place, laquelle scène a mis un certain temps à trouver sa place définitive. De fait ce n’est qu’en décembre 1978 que la scène du Balthus, avec enfin le Balthus lui-même, se retrouve à sa place définitive – auparavant il se trouvait vers la fin du film et coupé en deux, ne restituant que la moitié de la scène, ce qui implique une interprétation toute différente. Dans l’idée originelle de Truffaut, ce « souvenir » intervenait quand Antoine demande à Christine de l’aider dans son histoire d’amour avec Sabine, alors que dans le film que nous connaissons, il s’insère dans le train, avec les retrouvailles d’Antoine et de Colette, placées sous les auspices de la lecture des Salades de l’amour ; dans le premier cas, c’était un souvenir intime de Antoine et de Christine, suscité par les deux mémoires conjointes, dans le second c’est un récit assumé par Antoine, et qui peut assumer toutes les fonctions d’un message dans la pragmatique du discours : dans ce cas, le fait qu’Antoine ne reprenne pas le petit Balthus peut désigner sa générosité…
Ajoutons que dans le dépouillement du tournage de DC, qui ne mentionne pas non plus le tableau, mais où il est bien question de l’image de Noureev, qui est de fait très présente dans l’intérieur du couple, et remarquable dans la scène étonnante des lunettes, où Christine accepte de ne pas les retirer pour faire l’amour et où Antoine se rend compte qu’elle pourrait être une femme avec un érotisme et une sexualité autres que celle de Noureev, image ambiguë s’il en est d’homme, danseur, homosexuel, évoqué rétrospectivement par Christine qui fait des dessins pour Perceval le gallois (film de Rohmer, 1979), en une sorte de clin d’œil en même temps qu’un renvoi à l’imaginaire dit féminin : un chevalier, un homme sans sexualité – du reste Christine ne refait pas sa vie. L’épisode des lunettes est peut-être le moment unique où elle prend la place de « femme » pour Antoine.
Le petit Balthus est également un mystère non pas dans la production de Balthus, mais dans son œuvre raisonnée (12). Il s’agit bien d’un dessin (ou tableau) copiant après coup ou esquissant comme une étude préparatoire la « jeune fille à la fenêtre », que Raymond Mason décrit ainsi : « au cadre virgilien d’une campagne qui se réveille s’ajoute la grâce de la jeunesse, et je vois dans le tableau de la fille à la fenêtre, extatique devant la nature ensoleillée, l’éclosion finale du message du tant aimé Piero della Francesca. Le printemps du Quattrocento entre dans Balthus » (13), dont le catalogue donne une autre description : « la fenêtre du salon de Chassy au rez-de-chaussée est largement ouverte sur les deux cours successives. Un soleil printanier les inonde et joue dans le jeune feuillage de l’arbre. La jeune fille pose les deux mains sur l’appui de la fenêtre dont elle se tient légèrement écartée. Plutôt que de sortir, elle semble vouloir absorber le soleil qui blondit sa chevelure, inviter le printemps et ses odeurs légères à pénétrer dans le salon » (14). Et une lecture attentive du catalogue invite à conclure qu’il existerait deux tableaux semblables, un à New York (Metropolitain Museum of Art, Jacques and Natasha Gelman collection, p. 130) et un autre dans une collection particulière. Naturellement c’est la même peinture, et c’est la collection Gelman qui a été donnée au MET. La question n’est pas ici de repérer une incohérence de ce catalogue, mais d’essayer d’imaginer pourquoi le Balthus est apparu soudain dans le film, alors qu’il n’était pas prévu par Truffaut. Les Gelman étaient, outre des collectionneurs, eux-mêmes producteurs de cinéma. Est-ce à penser que le film a été tourné chez eux ? S’il est difficile de comprendre ce que ce tableau fait là, mais puisqu’il n’est pas dans les notes de la régie, on comprend que toutes les scènes où il apparaît ont été tournées dans la foulée – ce qui est évident, quand on connaît l’organisation d’un tournage de cinéma, qui ne suit jamais l’ordre définitif du film, mais les exigences logistiques ; il n’en est pas moins étonnant de le voir aussi clairement dans un film.
Si l’hypothèse se confirme que la scène a été tournée dans les appartements de Gelman, et que le tableau se trouvait là, nous sommes invités à rapprocher sa présence de la théorie du hasard objectif cher à Truffaut héritier du surréalisme (15), un hasard contre lequel il lutte cependant, ce dont je veux pour preuve sa décision initiale de ne pas mettre l’intégralité de la scène dans l’AF, mais auquel il obéit finalement.
Cette histoire anecdotique de la présence du tableau semble militer entièrement contre ma surinterprétation de la photo de Noureev, et aussi contre la tentation d’extrapoler à partir de l’œuvre de Balthus dont le critique ajoute que « l’artiste tire en réalité sa force de sa capacité d’introduire le trouble, de susciter le bizarre. Il a le chic pour dépeindre l’éveil des sens, les ambiguïtés de la puberté. » Alors qu’on aurait envie de donner une signification de fond aux images, et en particulier à celle-là, on est ramené au hasard de la vie des acteurs… Mais ce hasard paraît surdéterminé, si l’on regarde la série de gravures de Balthus sur les Hauts de Hurlevent (16), où force est de constater la ressemblance étonnante entre Doinel et Heathcliff auquel Balthus a donné ses traits (il y a toute une richesse de rapport mimétique, puisque la famille Klossowski sert de modèle aux Enfants terribles de Cocteau, sorti en 1929, que les gravures de Balthus « illustrent » tout autant qu’elles le font pour l’œuvre de Brontë) et de méditer sur l’assimilation fantasmatique de Truffaut à une enfance bourgeoise et artistique qu’il n’a pas connue, ce qui est aussi le sujet en filigrane et en douleur des Quatre cents coups.
Au titre de l’inquiétante étrangeté (17) qui circule autour de ce tableau, j’ai cité la suggestive analyse du rédacteur de Wikipedia sur laquelle renchérit Jérôme Attal dans son Journal : « En fait François Truffaut et Balthus se sont rencontrés pour travailler ensemble sur un projet de film adapté de Wuthering Heights, mais au final Balthus raconte qu’ils ne s’étaient pas entendu sur leur vision respective du livre d’ Emily Brontë. En fait l’anecdote du “petit Balthus” n’est en aucun cas une allusion à un vrai tableau, que d’ailleurs le jeune couple n’aurait pas eu les moyens de s’offrir, mais une allusion à cette ébauche de collaboration avortée ». Quant à la symbolique de l’échec de la collaboration entre Balthus et Truffaut (18), de fait on trouve dans les papiers de Truffaut l’idée d’une collaboration, et Jean-Pierre Martineau la justifie a posteriori (19), dans son article qui décrit la commune « passagèreté féline » des deux artistes, au titre de leur obsession pour l’adolescence, la fugitivité, la crise et l’ambiguïté…
Il convient donc, me semble-t-il de replacer cette curieuse alliance de motifs de fond et des contingences de l’existence sont bien ces hasards objectifs qui s’accumulent dans le cycle Doinel et qui signent la victoire du cinéma dans le paragone mis en place au fur et à mesure qu’Antoine devient écrivain et que « François » le filmant devient cinéaste ou plutôt renonce à l’écriture.
Le paragone entre les arts, avant de faire rivaliser cinéma et littérature, concerne, autour de la rencontre ratée (d’un point de vue biographique) entre Balthus et Truffaut, le rapport entre le cinéma et la peinture (20). On pourrait mettre dans la bouche du cinéaste la célèbre phrase du Corrège devant un tableau de Raphaël (21): « et moi aussi je suis peintre ». Les archives Truffaut ne nous permettent pas de reconstituer des faits précis. On trouve seulement une Lettre du 3 juin 1962 de Helen Scott (22) à Lucette de Givray (23) : « Pour le Balthus catalogue, le Museum of Modern Art est notoirement difficile, et j’essaierai une nouvelle tactique cet après-midi ». Puis, le 27 décembre 1962 à Mme Gomès : « Je vous prie de m’excuser et de demander à Balthus de m’excuser également de ne plus vous avoir donné de nouvelles depuis notre rencontre. Mon désir de tourner un court-métrage sur les toiles de Balthus est toujours aussi vif. Malheureusement j’ai rencontré beaucoup de retard dans mon travail […]. C’est pourquoi je dois reporter ce projet sans aucunement l’abandonner. Mon meilleur souvenir à Balthus. » (24)
Quoi qu’il en soit de la collaboration « réelle » projetée entre les deux hommes, Balthus est bien présent dans le film par l’irruption de la japonaise qui est la véritable cause de la désintégration du couple d’Antoine et de Christine dans DC et qui inspire à Truffaut des scènes qui tranchent parfaitement, dans l’atmosphère et dans l’esthétique, avec le reste du film qui correspond plutôt à l’image sobre de la Nouvelle, et je pense en particulier à la scène où Christine se déguise en japonaise, renvoyant peut-être au tableau de femme nue dans une maison rouge qui habite l’intérieur de ladite japonaise. La présence de la japonaise semble une sorte de revanche contre le refus de Balthus d’entrer dans ses scénarios. En même temps l’épisode avec la Japonaise ressemble fort à une tentative d’Antoine d’accéder à la « normalité bourgeoise de l’époux qui trompe sa femme, situation conventionnellement équilibrée qu’il est incapable de vivre, d’où le fait qu’il prenne Christine comme confident. Cette normalité est mise en abyme dans le petit Balthus, cadeau invraisemblable d’Antoine à Christine, alors qu’il eût été par exemple plus réaliste que les parents de Christine l’eussent offert au couple, d’autant que l’on sait qu’Antoine, quand il aime une femme, a le désir d’épouser avec elle toute sa famille. « J’aime les parents gentils », dit-il (25). Dans Baisers volés comme dans DC, chez les parents de Christine, il y a des tableaux qui désignent une bourgeoisie opulente. Le petit Balthus signe un certain embourgeoisement d’Antoine, qui est nié en même temps par la dislocation de l’intérieur du foyer, révélée par la scène du matelas.
Comment résister à la tentation d’énumérer tous les hasards objectifs dont les différentes réminiscences, plus ou moins subconscientes, parentes de la madeleine de Proust, dont on sait qu’il était l’écrivain préféré de Truffaut (26), et qu’il faut interpréter dans le contexte inévitable de l’identification complexe de Truffaut et de Doinel, sur laquelle tant d’encre a coulé que je serai importune d’en ébaucher le commentaire (27), sinon pour indiquer que, Jacques Richard, un assistant de Langlois, fait en 2003 un film sur Léaud dont le titre estLéaud de Hurle-dents…
Commençons par Julien Bertheau, l’amant de sa mère, entraperçu, place de Clichy, dans Les Quatre Cents Coups, sous les traits de… Jean Douchet. On peut se demander pourquoi Truffaut, qui pour le reste retrouve tous ses acteurs, Léaud naturellement, mais aussi Claude Jade (28)ou Marie-France Pisier, ne retrouve pas Douchet. Joue-t-il avec la mémoire du spectateur, voulant indiquer par là qu’Antoine lui-même a un souvenir incertain de cette fameuse rencontre, quand il était enfant ? Le spectateur ne sait pas ce qui se passe au moment où Antoine le reconnaît, et il a une sorte de stupeur à découvrir qu’il « est » littéralement un autre. On ne sait pas comment Antoine le reconnaît, mais il a en quelque sorte besoin pour son roman personnel d’effacer sa fondation : dans ce qui est peut-être une lointaine évocation de la scène séminale de Baisers volés, où Antoine, devant une femme qu’il désire, Fabienne Tabard (Delphine Seyrig), laisse échapper un « Monsieur », ce qui provoque sa déroute et sa confusion, sa mère est un petit oiseau, symbole masculin, par excellence – le petit oiseau, pénis, organe mâle de la copulation chez l’homme, dans un langage enfantin – ce qui place la formule de la prise de photographie « le petit oiseau va sortir » dans un registre décalé. D’autant que Fabienne, qui a interprété ce « lapsus » pour une marque de tact, vient lui rendre visite dans sa chambre de bonne, où soudain s’affiche un autre « petit Balthus », l’énigmatique Passage du Commerce Saint-André, qui renvoie aux premières expériences de la guillotine et à la décapitation (29). Comme dans Antoine et Colette où Antoine figure sans tête, sa chambre de Baisers volés contient cette même représentation de soi-même, qui évoque l’impossibilité pour le cinéma de se mettre en abyme, à la différence des autres arts.
Avec le glissement d’un acteur à l’autre, on peut parler de représentation du flou de la mémoire, déformée par les représentations psychiques ou psychanalytiques du petit oiseau, mais il faut ajouter que Jean Douchet qui tournait en même temps « En répétant Perceval » (1978, 0h30) un reportage sur le tournage de Perceval le Gallois, est, quand on considère cette actualité, présent dans l’AF avec les dessins de Christine que j’ai cités (30). Ajoutons que Julien Bertheau quant à lui est un acteur fétiche de Buñuel, lequel précisément tourne la même année une adaptation mexicaine des Hauts de Hurlevent, sous le titre Cumbres Borrascosas ou Abismos de Pasion dans un projet qu’il poursuit depuis 1932 et qui fut aussi inspiré par le cycle de Balthus, ce que confirme une interview de Rivette (31). « Ces dessins, en fait, était plus ou moins contemporains du premier désir de Buñuel de tourner la nouvelle … je crois qu’il en avait déjà écrit le scénario… VH : qu’il tournera seulement vingt ans plus tard… JR : Oui, mais tout de même, il avait écrit son scénario à l’époque en question. Il était donc d’actualité pour ce petit groupe, et Buñuel, Balthus et les autres se connaissaient. Ils fréquentaient régulièrement les surréalistes, tout en conservant leur indépendance. » Mais Buñuel emprunte à son tour l’univers seyrigien de Truffaut, en faisant jouer « Fabienne Tabard » dans le Charme discret de la bourgeoisie, basculant à nouveau l’interprétation du petit Balthus vers l’univers chargé de violence et d’érotisme du peintre et du surréalisme en général.
Rivalité amicale entre les cinéastes de la nouvelle vague ? Si Rohmer tourne Perceval, c’est bien Rivette qui décide à son tour de tourner les Hauts de Hurlevent, qui sortira sous le titreHurlevent, dont Suzanne Schiffman, la scénariste de l’Amour en fuite, est aussi la scénariste, et cela nommément après une exposition de Balthus en 1984, qui le saisit. Or Jacques Rivette rend compte de ces circonstances (32): « Je me suis donc rendu à cette exposition. Tout en considérant qu’il est un peu excentrique et tout ça, j’aime beaucoup Balthus. J’ai donc visité cette exposition qui était de fait superbe. Je connaissais déjà les dessins créés par Balthus pour le livre que les éditions Gallimard avaient eu l’intention de publier au début des années 1930 – autour de 1932 ou 1933, je crois. » Rivalité ou bien communion profonde, d’autant plus forte que « pour faire comble mesure, la chose qui, bien entendu, pesait considérablement sur le tournage, était que Suzanne […] savait que François Truffaut était mourant. Et il mourut quelques jours après la fin du tournage. Donc, pendant toute la durée du tournage, chaque jour sans exception, nous nous attendions à recevoir un appel téléphonique qui nous dirait “François est mort…” C’était une situation véritablement atroce. » (33)
Le désir de manipuler Balthus n’a pas abouti, débouchant sur la minimisation de Balthus (la réduction du Commerce Saint-André à une petite dimension) sinon par à sa miniaturisation telle qu’il devient le petit Balthus, où l’hypocoristique devient paradoxal, déni d’une intention affectueuse. Mais il y a comme un retour du refoulé de Balthus à Truffaut, et l’entrecroisement cinématographique des deux vies persiste jusqu’à la fin, avec la mort de Truffaut qui coïncide avec la fin du tournage du film de Rivette sur Les Hauts de Hurlevent inspirés de Balthus en passant par Buñuel, non pas le film mexicain de 1963, mais celui des années 30.
Ajoutons que chronologiquement, entre DC et AF prend place un autre film de Luis Buñuel, Le Fantôme de la liberté où joue Marie-France Pisier, et puisque Buñuel fait revenir son nom, c’est autour d’elle que je continue ma liste de coïncidences, que je n’épuise sans doute pas, de hasards objectifs. Marie-France Pisier, révélée par Antoine et Colette, a joué Charlotte, l’auteur de Jane Eyre (et non pas Emily) dans Les Soeurs Brontë de André Téchiné (1978) ; j’ai évoqué l’apparition de M. Hulot, mais il faut ajouter que c’est à un certain Jean Eustache qu’Antoine téléphone pour annoncer la naissance de son fils, alors que la carrière cinématographique de Léaud trouve en quelque sorte son aboutissement avec le film dudit Jean Eustache intitulé La Maman et la Putain (1972), où l’on retrouve Jean Douchet…
D’une certaine manière, on peut dire que le « petit Balthus » n’existe pas avant d’exister dans cette scène où il s’invite sans être prévu : il est le fruit du couple, un fruit qui se révèle au moment où le couple se brise, un fruit de la séparation du couple. Dans une analyse plus psychanalytique de Truffaut, on pourrait identifier un trouble autour de la fonction symbolique chez Truffaut, due à l’ignorance de l’identité de son père, trouble confirmé par une scène de l’AF où Doinel retrouve l’amant de sa mère, Monsieur Lucien, faisant écho à la séquence séminale des Quatre cents coups ; et là, au cimetière Montmartre, sur la tombe de la mère d’Antoine, Monsieur Lucien dit : « Ta mère était un petit oiseau, au fond c’était une anarchiste… – Une anarchiste ? Je n’ai jamais pensé à ma mère comme à une anarchiste, Monsieur Lucien. » Or Antoine ne relève que la mention « anarchiste » et n’est pas choqué d’être le fils d’un oiseau. La même incertitude génétique se retrouve avec son propre fils, Alphonse, que l’on voit enfant le soir de la scène du petit Balthus et qui, cinématographiquement parlant, a été conçu par le truchement d’une image, dans le métro, dans une séquence hallucinante où Antoine, qui vient de croiser M. Hulot, voit une affiche de publicité qui lui montre un bébé joufflu. (34)
De fait, on approche ici au plus proche d’une certaine description de la sexualité qu’incarnent à la fois l’adolescente de Balthus et Claude Jade, « fille clandestine de Grace Kelly » (35). Outre le détail que Jade fut en 1968 le rôle féminin de l’Étau d’Hitchcock (36), le dialogue entre les deux réalisateurs est des plus suggestifs. Hitchcock précise à Truffaut (p. 188-189) : « Quand j’aborde les questions de sexe à l’écran je n’oublie pas que là encore le suspense commande tout. Si le sexe est trop criard et trop évident, il n’y a plus de suspense » ; mais Truffaut sort de la perspective narratologique pour répondre : « c’est-à-dire que vous tenez avant tout à préserver un certain paradoxe : beaucoup de réserve apparente et beaucoup de tempérament dans l’intimité ». Et de poursuivre en une phrase qui en dit long sur son propre projet : « Je crois quand même que cette théorie du sexe glacé est une chose que vous réussissez à imposer malgré le penchant naturel du public qui aime voir des filles faciles d’emblée », avant de conclure par « cet aspect de vos films satisfait peut-être davantage le public féminin que masculin », confirmant cette idée avancée par de nombreux critiques que Truffaut filmait pour les femmes.
Claude Jade, voulant lui rendre le petit Balthus, lui rend une image d’elle à laquelle elle voudrait bien ne pas ressembler et qui est peut-être celle à laquelle il l’a assignée (et à laquelle, à la fin du cycle, Sabine – Dorothée refusera de coller) : image du sexe glacé qui ne se brouille que dans la seule scène érotique, celle des lunettes, en un fantasme qui se reglace immanquablement, puisqu’il évoque le double spectre de la vieillesse et de la presbytie, et aussi la tentation de faire l’amour avec une femme en train de lire, si ce n’est le thème du voyeurisme qui est continuel chez Truffaut. Car il est temps d’entrer un peu dans la représentation du tableau : il s’agit d’une jeune fille qui est dans l’encadrement d’une fenêtre et qui regarde dehors vers le jardin et ne regarde pas celui qui la regarde. Si elle est de dos, c’est-à-dire qu’elle ne montre pas son visage, étant prise par derrière. Peut-être n’est-elle même pas consciente d’être ainsi observée et que le peintre lui vole ce moment de contemplation, d’évasion, d’intimité, de subjectivité. Elle est absente, et elle est n’importe quelle femme, et dans le fond on ne sait pas si elle est une adolescente quoique le titre l’indique. Mais c’est par son regard que le peintre a accès à ce dehors de la maison. Elle fait également entrer dans le registre plus balthusien du trouble érotique. Le cycle ne présente d’Antoine que cette « tête coupée » d’Antoine et Colette, impliquant une irrémédiable opacité, sinon une castration symbolique, qu’il dépasse par les images : il croit entrer dans le monde par la littérature, mais le seul véritable accès est par les yeux (37), sans qu’il s’en rende vraiment compte : il découvre le monde par les images, se voit père par les images, et les images sont comme la parole autoréalisatrice : Christine a son destin tracé par le tableau.
Elle ne peut que lui rendre l’image et non pas retourner cette figure, cette chevelure ; ces deux-là restent des inconnus, ce qui fait contraste avec la rencontre avec Sabine qui passe également par une image, photographique celle-là, puisque Antoine tombe amoureux d’une photo réduite en mille morceaux, qu’il parvient à reconstituer, comme un démiurge réussirait à rassembler des éléments dispersés. Christine lui rend avec le petit Balthus l’image de celle qu’il l’a assignée à être, et qu’elle continuera à être, et en même temps elle lui rend une image d’un lui qu’il ne veut pas être. C’est tout l’enjeu du dernier film, que de savoir s’il pourra sortir de cette personnalité habitée par la littérature et non par l’image.
Il s’agit bien de manipulation. Depuis le début, Truffaut, peut-être dépité de l’expérience échouée avec Balthus, manipule le peintre pour qu’il entre malgré lui dans son imaginaire et y joue la place fondamentale qu’on sait. Et la densité du tableau, bien mise en évidence dans l’analyse de Jean Clair citée ci-dessus met bien en abyme l’art cinématographique de Truffaut, pour qui « Le rectangle de l’écran doit être chargé d’émotion »(38). Or, quelle que soit l’image de la femme qu’Antoine enclot dans ce tableau, et qu’il faut écouter en la remettant dans le contexte d’une soirée où Christine fournit les bases d’une esthétique littéraire, la scène se retrouve dans un autre moment important dans sa vie de « romancier », où il doit constater l’échec de son roman devant Colette qu’il vient retrouver dans le train. Cette fois-ci la déconfiture est totale : non seulement elle critique son projet vertement, au titre que sa mémoire est infidèle ou plutôt que sa littérature est un mensonge, mais en plus les pages de son récit ne serve à rien dans son désir rené de séduire Colette, qui a bien lu les Saladescomme une déclaration. Dès lors c’est comme s’il réussissait enfin à faire son deuil de la littérature, alors que l’ambition d’écrivain le taraude depuis son enfance. Explosion de la lecture dans Baisers volés, puisque le film qui commence par un plan sur le Lys dans la valléede Balzac, second écrivain préféré de Truffaut, dont il y a un portrait dans la chambre d’Antoine enfant, dans Les 400 coups, et se poursuit par la déclaration d’Antoine aux parents de Christine qui le reçoivent après son éviction de l’armée : « j’avais lu Servitudes et grandeur militaires », mais il le dit dans un demi éclat de rire, dont on ne sait pas s’il est ironique ou s’il cache sa timidité, ou son ambition véritable. Puis Fabienne Tabard, en qui il reconnaît l’héroïne du roman, mais qui le rappelle à la réalité : « Moi aussi, dit-elle, j’ai lu Le Lys dans la vallée, mais je ne suis pas Madame de Mortsauf et vous n’êtes pas Félix de Vandenesse. » Il en faudra davantage pour faire renoncer Antoine, qui se met lui-même à l’écriture dans DC, en même temps qu’il peint des fleurs dans la cour de son immeuble. Puis AF s’ouvre par le cadeau, par Sabine à Antoine, après une nuit d’amour, des œuvres complètes de Léautaud, dont en quelque sorte elle se débarrasse. Il faut rappeler l’importance de cet auteur pour la Nouvelle vague, notamment Truffaut et Rivette, jeunes rédacteurs des Cahiers du cinéma, qui vont s’abreuver de cet événement radiophonique (39) que furent, entre décembre 1950 et juillet 1951, les trente-huit émissions d’une quinzaine de minutes chacune où Léautaud s’entretient avec Robert Mallet : ils voueront un véritable culte à l’octogénaire et calqueront leur célèbres entretiens au magnétophone sur ce modèle. Mais comment ne pas entendre dans le nom de Léautaud celui de Léaud ?
Quant à ce dernier, le retournement a lieu après la scène du train, où il s’opère une sorte de glissement, qui seul permet l’happy end ultime, l’amour qui enfin ne fuit pas. Il me paraît que ce retournement est celui de Truffaut assumant, dans le paragone, la supériorité du cinéma par rapport à la littérature, et cela en tant qu’objet esthétique de même que dans la vie. En effet, dans un glissement d’Antoine à Truffaut, alors qu’Antoine connaît l’échec, Truffaut affirme sa réussite : Antoine ayant perdu Sabine sait coaliser « ses » femmes contre son malheur et dès lors elles s’allient avec lui, contre le destin, pour faire triompher l’amour. Le dernier titre du cycle, le seul à porter un titre de mauvais augure, est en fait le seul qui finit bien, par cette prise de conscience de la supériorité du cinéma. On connaît le désir profond de Truffaut, de devenir écrivain (40), et c’est dans cet ensemble comme s’il exorcisait ce fantasme, la littérature devenant des « salades », titre parfaitement dérisoire qui désigne tout le ridicule de l’entreprise.
Sabine ne revient cependant pas par la coalition des femmes, mais par le récit de l’énergie créatrice de Truffaut, à savoir comment il surmonte l’éparpillement de l’existence en faisant une seule image à partir d’un puzzle. La scène de la cabine téléphonique, dont la représentation ponctue chaque film du cycle, où s’énonce de la triangulation amoureuse (il est épris d’une femme qui est celle d’un autre) et dont Sabine ignore tout est assumée par le récit et devient l’artisan d’une véritable intégration des souvenirs éclatés d’Antoine que l’AF, avec son dispositif de fragments de film dans le film, avec les distorsions de la mémoire que cela implique, montre à la fois dans leur réalité douloureuse et dans leur synthèse victorieuse, Sabine peut ainsi vivre avec Antoine les amours qui précèdent Antoine. On retrouve ainsi le désir profond de Truffaut, de « se recréer une famille à l’intérieur du cinéma, une famille qu’il n’avait probablement pas eue ». (41)
De fait on voit bien que ce ne sont pas les souvenirs qui font vivre, mais la créativité : autrement dit la capacité à faire de la vie un film, de manipuler les personnages, au présent et au futur, mais pas dans le passé, symbolisé par les Salades de l’amour, dont la réécriture ne change rien. Un film – une œuvre d’art - n’est donc pas un règlement de compte, mais bien une réorganisation. Le dernier Doinel affirme la supériorité du cinéma comme œuvre collective, où le réalisateur peut entraîner des tas de gens pour qu’ils entrent dans son « roman », le roman de sa vie – entre son histoire personnelle avec Claude Jade, et ce détail fabuleux que Marie-France Pisier, qu’Antoine et Colette a donnée au cinéma, cosigne le scénario. Le choix semble être fait, comme dans le mur de Breton, de coller bout à bout l’ensemble des choses qui font réseau de façon à vivre dans le cinéma pour mettre fin au hasard et à la contingence : le cycle de Doinel est comme cet écrin où viennent se coucher – se créer des hasards objectifs, dont le petit Balthus est l’emblème mystérieux.
Le triomphe du cinéma était déjà annoncé dans Les Quatre-cents coups : Antoine Doinel et ses parents viennent passer une soirée au cinéma Gaumont Palace , et c’est le seul moment où toute la famille est heureuse et rit aux éclats (42). La singularité du cinéma cependant c’est qu’il ne peut se montrer lui-même (43) à la différence des autres arts où la mise en abyme est toujours possible. Du reste Truffaut souligne souvent la matérialité du travail de l’art, en ce qu’il montre Antoine fabriquant des disques, Antoine correcteur d’épreuves, ou la matérialité du message, comme dans le pneumatique qu’Antoine envoie à Fabienne Tabard et qui est, pour le spectateur, son premier passage à l’acte d’écriture, mais le cinéma est cet art synthétique qui ne peut se montrer qu’en se cachant. Dès lors les autres arts sont convoqués pour être les serviteurs d’une spécularité impossible, par un travail de métaphorisation, présent notamment dans le personnage de Liliane (jouée par Dani), dont la liaison avec Antoine fut la cause déclenchante du divorce. On remarquera donc la suprême habileté de l’AF qui, comme chacun sait, incorpore des scènes des cycles précédents de la série, mais inclut aussi des scènes qui sont des retours en arrière mais renvoient soit à un film qui n’existe pas – c’est-à-dire soit des passages qui ont été coupés au montage de films du cycle, soit à un autre film : le flash-back où Antoine et Liliane se disputent ne fait pas partie du cycle Doinel, mais est extrait de La Nuit américaine (1973), qui montraient les deux mêmes amants, dans de toutes autres circonstances, à ceci près que si Dani s’appelait bien Liliane, Jean-Pierre Léaud quant à lui s’y prénommait Alphonse, ce qui est le nom de son fils dans le cycle Doinel. Le spectateur est bien invité à entrer dans la « famille » de Truffaut, dans le brouillage des générations et des souvenirs. Il y a donc une sorte de dédoublement des retours en arrière, avec un jeu entre les scènes « collées » et les scènes rapportées, et cet enrichissement permanent désigne dans le film la doineléaudisation du spectateur : cet univers devient le sien, dès lors qu’il peut imaginer d’autres scènes, par exemple celle où Antoine achète le Balthus pour Christine, et ce n’est plus l’imagination qui œuvre, mais bien le travail du fantasme, pour une scène proprement inimaginable, car, comme les commentateurs le soulignent, Antoine, peintre en fleurs dans la cour de son immeuble, ne pourrait pas se payer un Balthus. « Flash back ne veut pas forcément dire vérité », précise Truffaut à Simon Mizrahi, où il explicite son travail de mosaïque et de puzzle. (44)
Le petit Balthus fait exploser le cadre de la vraisemblance, en une de ces ruptures surréalistes récurrentes chez Truffaut. Le petit Balthus ne désigne-t-il pas finalement le rapport de Truffaut à Balthus, dont il suffit de regarder les portraits pour mesurer l’étonnante ressemblance avec le Janus qu’est déjà Truffaut / Léaud, en ajoutant qu’il existe une photo célèbre de Balthus peintre devant cette même fenêtre où figure la jeune fille… De là la tentation surinterprétative, avec l’idée que Truffaut connaissait cette photo. Dans ce cas, comment ne pas comprendre le refus de Balthus d’être doinelisé ? Doinelisation qui touche Léaud le premier, et dont les Hauts de Hurle-dents offrent la mise en perspective.
Doinelisation qui attend certainement le critique des films du cycle de Truffaut, puisque je me retrouve ici un enquêteur à la manière d’Antoine dans Baisers volés, couchant avec l’épouse de Tabard, le marchand de chaussure, et lui procurant ainsi l’amant sur lequel il enquête, en une évocation du thème cinématographique séminal de l’arroseur arrosé, repris sur le mode burlesque : détective partant à la trace des indices que le réalisateur veut bien lui donner, je dois bien avouer que le « vrai » tableau de Balthus mesure 160 x 162 cm, alors que l’image du film, qu’elle ait ou non des couleurs, est clairement une réduction de 25x25 cm, comme l’autre « petit Balthus » du Commerce Saint-André, passant quant à lui de 294 / 330 cm à ce même format carré 25x25. Faut-il vraiment conclure sur le poncif de la valeur métonymique du tableau et sa sémantique multiple, l’enfant du couple séparé, la mise en garde contre les règlements de compte, l’introduction de l’adultère et la signature indirecte de l’embourgeoisement… En tout cas ce « petit Balthus » est dédimensionné pour occuper une place minuscule sur le grand écran, dans une affirmation triomphante du cinéma.
Pour conclure, cette phrase de Truffaut, qui nous ramène à l’esthétique, c’est-à-dire au domptage, par l’art du travail de sape de la névrose (ou de la psychose) (45): « Mon peintre favori est Balthus » car « je me sens dans la situation d’un peintre figuratif qui continuerait résolument à être figuratif en espérant que cette peinture-là ne disparaîtra pas complètement. » (46)
NOTES
(1) Abrégés dans la suite du présent article respectivement par DC et AF.
(2) Pour l’ensemble, François Truffaut, Les Aventures d’Antoine Doinel, Ramsay Poche Cinéma, 1987. Le livre rassemble les dialogues, scénarios, synopsis et notes de travail des différents films de la série Doinel, et s’achève par une interview de Truffaut à propos de L’Amour en fuite.
(3) Le recours à Wikipedia exige une certaine vigilance ; le propos est d’autant plus intéressant ici qu’il y a l’évidence d’un esprit de sérieux et comme une recherche, laquelle cependant ressemble à un canular.
(4) Ou un tableautin ? La chose n’est pas claire, de fait, car l’image est peu contrastée. Je n’arrive pas à voir s’il y a ou non des couleurs.
(5) Cinémathèque française, Paris. J’ai consulté les dossiers suivants : Domicile conjugal : TRUFFAUT 18 B 17 ; TRUFFAUT 73 B 63 ; TRUFFAUT 96 B 72 ; TRUFFAUT 272 B 157 ; TRUFFAUT 445 B 218. L’Amour en fuite : TRUFFAUT 48 B 47 ; TRUFFAUT 49 B 48; TRUFFAUT 50 B 49; TRUFFAUT 81 B 64.
(6) Arnaud Guigue, François Truffaut : la culture et la vie (Paris : L’Harmattan, 2002), p. 11.
(7) Voir exemplairement Jurgis Baltrusaitis, Le Miroir, essai sur une légende scientifique, révélations, science fiction (Paris, Le Seuil, 1978).
Voir cependant Carol S. Altman, Enfance : inspiration littéraire et cinématographique(Birmingham, Alabama, Summa Publications, Inc., 2006), en particulier le chapitre « Subjectivité de la narration et de la focalisation », où elle étudie toutes les scènes de reflet et de miroir dans Les Quatre cents coups, attirant l’attention notamment sur l’ombre d’Antoine sur la place dans la scène finale.
(8) Ou parallèle des arts.
Je n’étudierai pas ici le rapport de du cycle avec la musique, qui est considérable, entre la rencontre d’Antoine et de Colette aux Jeunesses musicales, le fait que dans un de ses nombreux emplois Antoine fabrique des disques, que Sabine soit disquaire après que Fabienne Tabard a mené une scène de séduction catastrophique avec un disque, etc. pour ne rien dire de la présence de la musique : Charles Trenet dans Baisers volés ou Souchon dans l’Amour en fuite.
(9) Développée particulièrement au Japon, voir Laurence Alfonsi, Lectures asiatiques de l’œuvre de François Truffaut (Paris, L’Harmattan, 2000), notamment p. 94 sqq.
(10) On peut se reporter au documentaire fait sur Truffaut, soit un volet de la série documentaire de Serge July et Marie Genin « Il était une fois… », de Serge Tripod « Il était une fois… Jules et Jim » (2008) (TV).
(11) Par exemple la scène de DC où Antoine s’installe en face de chez Colette est enjolivée dans son roman puisqu’il prétend que ce sont eux qui viennent par hasard s’installer en face de chez lui. Notons que l’effet spéculaire est à l’œuvre dans cette scène puisque dans sa chambre il a collé au mur une image qui le représente dans Les 400 coups – on reconnaît clairement son pull-over à col roulé, si significatif, mais on ne voit pas son visage.
(12) Balthus : catalogue raisonné de l’œuvre complet, par Virginie Monnier ; sous la dir. scientifique de Jean Clair, Paris, Gallimard, 2000.
(13) Ibid., p. 131
(14) Ibid., p. 352.
(15) André Breton : « […] le hasard serait la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se fraie un chemin dans l’inconscient humain (pour tenter hardiment d’interpréter et de concilier sur ce point Engels et Freud) ». (L’Amour fou, II, p. 690-691).
(16) Illustrations pour les Hauts de Hurlevent, 1932-35, in Balthus, op. cit., p. 204 sqq. , commentée encore comme une réminiscence de Piero della Francesca.
(17) Sigmund Freud, L’Inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, Folio, 1985, notamment p. 241.
(18) On ne trouve rien de plus dans, Correspondance diverse, TRUFFAUT 466 B 232, Court métrage sur Balthus (1962) ; Projet de film (Balthus 06/1962) Chrono 1962 TRUFFAUT 516 B 280; TRUFFAUT 517 B 281; Correspondance reçue et secrétariat 1962, TRUFFAUT 524 B 288 ; TRUFFAUT 306 B 173.
(19) Jean-Pierre Martineau, « Il était une fois… le filmique », in Le Filmique (Toulouse, Presses Univ. du Mirail, 1993), p. 101-143, ici p. 132.
(20) On lit dans le Questionnaire de Proust au quel Truffaut répond dans I filmi di François Truffaut, d’ Oreste De Fornari (Rome, Gremese Editore, 1990), p. 42 au titre de ses peintres préférés, Bonnard, Dali et Balthus.
(21) Repris par un autre précurseur reconnu des surréalistes, Guillaume Apollinaire, Et moi aussi je suis peintre, album d’idéogrammes lyriques coloriés, resté à l’état d’épreuve, inCalligrammes, Paris, Le temps qu’il fait, 2006. Je ne cite pas le nom d’Apollinaire par hasard, mais bien par nécessité ou coïncidence suggestive, puisque l’histoire épistolaire et érotique d’Apollinaire et de Madeleine est racontée dans Jules et Jim, quoique le nom du poète ne soit pas cité. Voir Guillaume Apollinaire, Lettres à Madeleine, édition revue et augmentée par Laurence Campa, Paris, Gallimard 2005.
(22) Cité supra : TRUFFAUT 306-B173, [6 f.] dactyl., ms
En janvier 1960, à New York, François Truffaut rencontre Helen Scott, chargée des relations avec la presse pour le French Film Office. Celle-ci devient, dès lors, sa traductrice et sa collaboratrice attitrée aux États-Unis ; c’est avec elle qu’il travaille pour ses entretiens avec Hitchcock, voir Hitchcock / Truffaut, Entretiens, édition définitive, Paris Gallimard, 1983 (édition revue et corrigée par Truffaut un an avant sa mort).
(23) Secrétaire des films du Carrosse, la société de production indépendante de Truffaut, et l’épouse de Claude de Givray, scénariste de Truffaut.
(24) J’ai interrogé la fondation Balthus qui ne m’a pas donné de précisions.
(25) Pour l’anecdote signifiante, rappelons que les Quatre cents coups a été largement financé par les beaux-parents de Truffaut qui venaient de gagner beaucoup d’argent…
(26) À côté de Balzac et de Stendhal, voir I filmi di François Truffaut, op. cit., p. 41.
(27) Sur cette identification qui entraîne aussi irrésistiblement les spectateurs des films de Truffaut, voir la « Lente doinelisation, léaudisation de tout l’individu », surhttp://jerome.attal.pagesperso-orange.fr/journal2001.html. Je remercie ici Jérôme Attal avec qui l’échange doineléaudiscontinu est toujours fécond.
(28) Malgré les tensions nées autour de leur affaire de mariage raté. Car en 1968, Truffaut fait une demande en mariage à la famille de son actrice préférée et sa cadette de seize ans, Claude Jade, « la petite fiancée du cinéma », encore mineure, mais il ne se présente pas à la cérémonie. Sur Truffaut amoureux de toutes ses actrices, voir outre le témoignage extraordinaire de Jeanne Moreau dans le documentaire cité ci-dessus, les passages deAntoine de Baecque et Serge Toubiana, François Truffaut , Paris, Gallimard, 1996).
(29) C’est dans cette voie qui faisait partie de la Cour du Commerce construite contre le mur d’enceinte de Philippe-Auguste et ouverte en 1776 sur le terrain d’un jeu de paume que les docteurs Louis et Guillotin firent procéder à des essais de « décapitation » sur des moutons. Voir l’analyse de Jean Clair, interview au Figaro, Propos recueillis par Éric Biétry-Rivierre, 16/06/2008). « Q : Cette maîtrise complète, est-ce là la définition du chef-d’oeuvre selon Pierre-Jean Jouve ? J.C. : Parfaitement. Un tableau comme Le Passage du Commerce-Saint-André est totalement codé. Chaque objet présent y a sa place, dans une structure d’ensemble géométriquement maîtrisée. Q. : Pourtant cette rue semble onirique. J.C. : Cet effet-là est bien celui recherché. Voici une invention poétique extraordinaire. Au fond du passage, il y a une serrurerie qui fonctionnait encore quand j’étais étudiant. Son enseigne est une clef... Cette serrurerie est celle où la première lame de la guillotine fut forgée. On l’a expérimentée sur un agneau dans cette rue qui se trouvait être un des hauts lieux de la Révolution. Ainsi, il est moins étonnant que le chien peint par Balthus ressemble à un petit mouton. Comme le théâtre d’Artaud, comme les contes de Grimm, de Perrault ou de Lewis Carroll, comme la peinture du Quattrocento, du Caravage, de Poussin ou Courbet, l’oeuvre de Balthus est pleine de cette cruauté exutoire et apaisante. Même ces petites filles alanguies et rêveuses n’ont rien de doux. »
(30) Je n’irai pas jusqu’à dire que Perceval n’était pas une figure possible pour l’amant de sa mère, étant donné que Douchet intervient ici comme réalisateur. C’est bien sûr Fabrice Luchini qui joue Perceval dans le film de Rohmer.
(31) Valérie Hazette, http://www.sensesofcinema.com/2003/feature-articles/hurlevent/ sense of cinema, 59: « Hurlevent : Jacques Rivette’s Adaptation of Wuthering Heights »
(32) Interview citée.
(33) Et s’il y a rivalité entre les enfants terribles de la Nouvelle Vague, Hazette ne réussit pas à la faire paraître au grand jour, alors même qu’elle suggère à Rivette le modèle du cycle Doinel (ibid.) : « Quand j’ai rencontré Rivette en décembre dernier, le seul argument que j’étais capable de lui présenter pour une suite éventuelle à Hurlevent était l’exemple du cycle d’Antoine Doinel où François Truffaut a résolu en partie le problème de la continuité dramatique en utilisant le même acteur, Jean-Pierre Léaud, Des 400 coups en 1959 à L’Amour en fuite en 1979. » Mais Rivette répond à la lettre de la question et non pas à son esprit.
(34) Le spectateur quant à lui a compris depuis la séquence précédente, où Antoine laisse Christine devant une plaque de gynécologue. Mais ce n’est point ainsi que Doinel fait un enfant.
(35) Voir Hitchcock / Truffaut, Entretiens, op. cit., p. 282.
(36) Ajoutons, mais peut-être est-ce un ajout de trop, ajoutons que, dans le cadre de son expérience éphémère hollywoodienne, Claude Jade fut engagée par Tony Richardson pour le projet de Nijinsky’s Life, où elle devait jouer l’épouse de Nijinski interprété par Noureev.
(37) Ce dont son passage dans Baisers volés dans une entreprise de détective privé, où il rencontre un père de substitution lequel meurt d’une crise cardiaque, ouvrant à la seule solution qui lui reste : épouser enfin Christine.
(38) Hitchcock / Truffaut, Entretiens, op. cit.,p.47.
(39) Le cycle Doinel décline toute une série de comparaison des techniques modernes avec le livre, comme un Truffaut lecteur de MacLuhan ( La Galaxie Gutenberg paraît en français en 1962) : je voudrais citer l’importance du disque, dont Antoine se retrouve un ouvrier et dont Sabine est une vendeuse, qui s’entend également dans le choix des musiques, toutes très signifiantes. Le Trenet de Baisers Volés, le Souchon de l’AF.
(40) « Ce que je voudrais être : écrivain » dans I filmi di François Truffaut, d’ Oreste De Fornari (Rome, Gremese Editore, 1990, p. 41).
(41) Jean-Louis Richard, in Le Roman de François Truffaut, éd. Alain Bergala ; Marc Chevrie ; Serge Toubiana (Paris, Cahiers du cinéma-Éd. de l’Étoile, 1985), p.91.
(42) Et c’est à ce même endroit, dans l’immeuble d’angle qui lui fait face, toujours en place, que Truffaut a choisi d’installer son personnage dans Antoine et Colette. Enfin quand il est libéré de l’armée, dans Baisers volés, il traverse cette même place presque au péril de sa vie, pour monter voir une prostituée.
(43) Il le fera exceptionnellement dans Husbands de Cassavetes (1968) où une caméra perche apparaît soudain.
(44) Interview repris dans Le Cinéma selon François Truffaut, textes réunis par Anne Gillain (Paris, Flammarion, 1992) p. 386.
(45) Ce n’est pas le lieu non plus de méditer sur le psychisme de Truffaut, dont on peut simplement dire qu’il y a une faiblesse certaine de la fonction symbolique et un intérêt constant pour la psychose, dont L’Enfant sauvage est l’exemple le plus évident.
(46) In Le Roman de François Truffaut, op. cit., p. 200.Sylvie Taussig, Cadrage, Février 2013  2 commentaires
2 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien










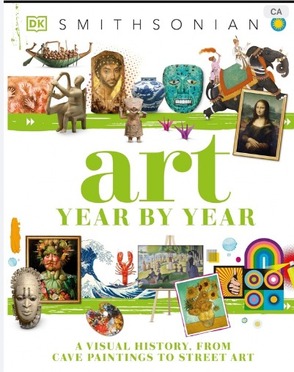




















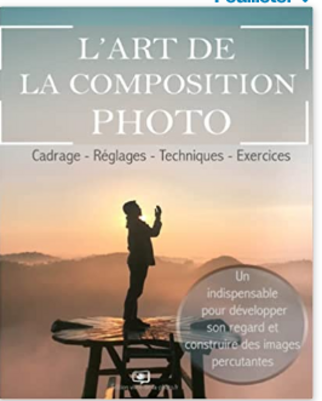







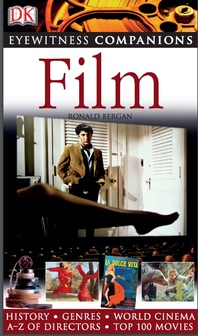





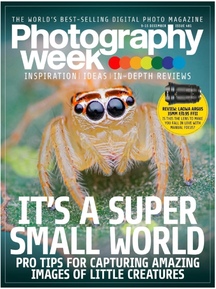



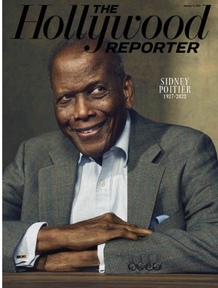



















































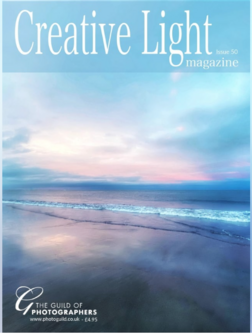

















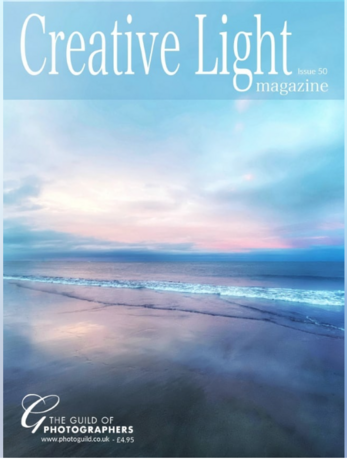


















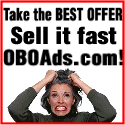
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)










 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot





