-
Par hechache2 le 8 Décembre 2013 à 10:59
Tariq Teguia, cinéaste .
ombres et Brouillard
le 06.12.13 | 10h00 Réagissez
| © D. R.Révolution Zendj, dernier opus de Tariq Teguia fut projeté au Festival International de Belfort. 5 années qu’on attend cet évènement, dont trois de tournage. Rencontre avec un cinéaste qui prend le temps de questionner et de filmer les fantômes.
-Entre ton précédent film, Inland et celui-ci, 5 années se sont écoulées dont deux consacrées au tournage…
Trois ans. Entre deux et trois ans. Il a commencé le 17 novembre 2010. J’ai encore tourné en Grèce à la toute fin du mois de mars 2013. Deux ans et demi de tournage. D’abord deux jours de tournage à Athènes en novembre 2010. Ensuite trois jours de tournage sur Alger en janvier 2011. Puis nous sommes partis à Beyrouth. 6 semaines de tournage, je crois. Nous sommes rentrés sur Alger, nous avons tourné sur le territoire. Nous sommes partis en Grèce où nous avons filmé à Athènes puis à Thessalonique. Nous pensions avoir terminé.
Malheureusement, il a fallu retourner au Liban pour refaire des scènes avec l’un des personnages, un Américain, qui nous avait lâchés. On a choisi un autre acteur. Nous étions en juin 2011. En parallèle, j’ai profité d’une invitation de Harvard qui avait organisé un cycle autour de mes films, pour repérer et tourner quelques plans qui ont servi au film. Finalement, le tournage s’est définitivement terminé fin mars 2013. Et c’est là que j’ai repris et finalisé le montage. Quelques fois, ce tournage fut douloureux, lourd, très lourd à tirer, à porter. Quand on n’a pas beaucoup de moyen, on réduit tout.
-Comment peut-on produire un film tel que Révolution Zendj ?
Je travaille avec mon frère, Yacine, qui est producteur, avec mes amis. Nous avons une méthode et il est possible de gérer un budget d’où ce travail collectif. Nos acteurs n’en sont pas. Nous fabriquons un système de production, un outil de travail. C’est une conscience professionnelle qui se démarque du système classique et omniprésent chez les professionnels de la profession. On peut nous le reprocher. Mais il faut manifester soi-même un peu de volonté, de désir. Il faut donner le sentiment, et plus que ça, qu’on a vraiment envie d’avancer et que les choses ne s’étiolent pas. Je me suis posé la question de pourquoi l’idée d’abandonner ne m’ait pas traversé l’esprit. Je n’ai pas le droit de lâcher. Parfois je ralentis la cadence, mais je ne me suis jamais arrêté de travailler sur ce film.
Fallait écrire le scénario, effectuer des repérages, seul dans un premier temps, en groupe quand je suis en Algérie, puis réécrire le scénario avec Yacine, effectuer la préparation du film. Un moment donné, tu es face à un mur financier, d’effort physique, mais on reprend tout et on se lance. Il m’arrive souvent de me tromper. Et c’est ce qui rend l’exercice excitant. Nous sommes restés dans les limites du budget, malgré tout. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres producteurs. Nous avons, Yacine et moi, une méthode basée sur une relation de confiance. Et puis, ce film, comme les autres, a été aidé par ma mère qui nous a poussés à terminer ce film. Ça suffit. C’était plus qu’une présence. C’était décisif.
-Comment as-tu connu l’histoire de cette révolte d’esclaves noirs au IXesiècle, les Zendj ?
Il y eut d’abord cette traversée de repérage dans le monde arabe, à travers les festivals de cinéma où je présentais mes films. J’ai vu des choses, pris des notes, constaté un puzzle, des éléments, des fragments qui se mettent en place. Après il faut unifier tous ces éléments. Ça donne un scénario que j’écris avec Yacine, parfois des discussions avec des amis. On évoquait souvent les anciennes révoltes dans les pays arabes telles que les Zendj. Ensuite, j’articule tout ça avec le présent, qu’il y ait une résonance avec ma société. Le film d’histoire ne m’intéressait pas. L’idée de départ était de montrer une persistance de la lutte et le refus de l’oppression dans notre monde actuel. Puis ces luttes étaient géographiquement et historiquement localisables dans un pays qui nous intéressait, en l’occurrence l’Irak.
Un pays qui a traversé de nombreuses guerres dont la dernière qui n’est pas terminé, me semble-t-il. On s’était posé la question du Proche-Orient à travers l’Irak. L’invasion américaine, le redécoupage des cartes, la question du Liban. Les branchements se font à pleins d’endroits différents. Le personnage de Nahla, vivant en Grèce, d’origine palestinienne, dotée d’une histoire qui la renvoyait au Liban où ses parents avaient combattu. Les branchements sont là, dans ce genre de situation. Tout se reconnectait. Je pars des Zendj pour arriver à notre société. Les lignes s’entrecroisent et parfois résonnent entre elles.
-Des lignes de fuite ?
Le journaliste algérien, Ibn Battuta, est envoyé au Liban pour voir comment les libanais vivent depuis 20 voire 30 ans. Très vite, il se sent pris d’une envie de partir en Irak, à la recherche d’un nom, d’un visage. Nous sommes dans une ligne de fuite. Paradoxalement, ce journaliste part à la recherche de fantômes. Son interlocuteur, sur la terrasse d’Alger, le lui dit. «Tu risques de trouver des fantômes.» C’est un journaliste qui ne sait pas ce qu’il recherche. C’est un bon point de départ. Battuta veut savoir comment les choses se transforment. C’est un sismographe. Dans Inland, le personnage principal était topographe. Dans Révolution Zendj, c’est un sismographe à la recherche de spectres.
-Dans Révolution Zendj, Ibn Battuta l’Algérien va au Liban, Nahla, la Grecque d’origine palestinienne, le rejoint, le Nord et le Sud se croisent à l’Est, au Proche-Orient.
C’est l’un des enjeux du film. Encore plus de lignes. Comment on assiste à une mondialisation du marché, du capital. De quelle manière les individus, les sociétés répondent à ce changement. Ces luttes ne se rejoignent pas ponctuellement, mais chacune de leur côté, elles disaient la même chose, confusément, isolément, de manière atomique, mais ce qui est énoncé en Egypte ou en Tunisie soit complètement différent de ce qui s’est passé en Grèce ou en Espagne. C’est le même mouvement, de manière disparate, aveugle, mais il est présent. Quand je préparais le film en Grèce, je me suis retrouvé dans un squat à Thessalonique.
Ce n’est pas facile. Tu ne tournes pas aussi facilement dans des endroits de ce genre, proches des milieux anarchiques. Il faut des longues heures de discussion. Ils me disaient : «Comment prétends-tu faire le lien entre ce qui se passe chez nous et les manifestations en Algérie ou ailleurs ?» Et je vous rappelle que nous étions en septembre 2011, bien avant la révolution du Jasmin. Plus tard, ils ont vu que tout était lié. Tout ! Les connexions se sont refaites car elles étaient potentiellement présentes. Nous sommes tous concernés par ces crises quelle que soit leur origine. Il y a une telle fatigue qu’on ne se la pose plus. Par exemple en France. Au contraire de la Grèce. En Algérie, ce sont les centaines de foyers d’émeutes qui montrent bien que la société algérienne veut autre chose qu’elle connaît aujourd’hui. Ça ne semble pas prendre les mêmes contours que ce que l’on a vu en Egypte ou en Tunisie. Il y a plusieurs raisons. Fatigue due aux 10 années de guerre civile, épuisement de la société, peu de relais de la classe politique. L’émeute, en Algérie, est gérée.
-Et comment le cinéma peut se mêler de ces affaires ?
Il s’en mêle quand il les montre, quand il les fait exister, quand il les fait entendre. Sous la forme d’une fiction, du documentaire.
-Ne crains-tu pas d’orienter ton cinéma vers quelque chose de plus militant, vers une idéologie ?
Si je pensais faire que ça, je serais journaliste, j’écrirais des articles. Pour des questions de commodité, on a tendance à séparer la forme et le fond. Dans mon film, on ne sépare pas. Les images, les acteurs, les rythmes de montage, les sons, le cadre, tout cela est entremêlé. Ça s’appelle un film et je ne veux pas y renoncer. C’est un mouvement. Je veux rendre compte du monde par un ensemble de rythme sonore, visuelle, colorimétrique. Ce sont des questions de cinéma. Et c’est ce qui fait que dans mes films, on ne bascule pas du côté du pamphlet, du tract militant ou idéologique. Ce sont des formes, des vitesses, des sensations.
-Je trouve que dans ton dernier film, le fond et la forme n’ont pas d’équité. Il y a un ralentissement de rythme. Il existe dans ce film, des séquences où cette équité crée du sublime, et d’autres, qui sont déréalisés par des dialogues qui viennent, pour des raisons inexpliquées, donner de la légitimité à cette forme que tu essaies d’installer dans ton film. En cela, il m’arrive d’être gêné, voire de m’éloigner du film.
Il y a une séquence, celle du bar, où les deux personnages américains, les néo-conservateurs, attendent quelque chose. Il y a de la crispation. Un peu d’exaspération. Tu vois le rapport avec le barman. Des choses sont dites. Je ne peux pas les refuser. Dans ce cas, dans Inland, le discours des activistes étaient de trop…
-Non ! Je les trouvais belles car en décalage, ironiques…
Pas du tout ! Elles ne sont pas ironiques.
-Il y a tout de même ce personnage, dans l’une des séquences d’Inland, qui affirme être un hermaphrodite, sous les rires de ses camarades.
Oui, mais il n’y a pas d’ironie. Citez-moi d’autres exemples dans Révolution Zendj qui t’ont gêné
-La première heure du film est symptomatique de cette absence d’équité. Je pense notamment à la séquence dans Beyrouth où tu filmes ces personnages politisaient à outrance sur leur passé et leur avenir.
Je ne trouve pas qu’elle soit moins cinématographique. Tout est filmé en contrechamp. Un travail sur l’extérieur, sur le son, alors que toute la scène se déroule en intérieur. Un jeu du dedans/dehors totalement lié à la construction de Beyrouth. Entre présent et passé. Dans cette séquence, il y a l’impossibilité de faire des choses. Au niveau du cadre, du découpage, il y a une tentative de cinéma.
-A partir du moment où tes personnages dialoguent entre eux, je me sens séparé. Prenons l’exemple d’Alger et d’une séquence que tu filmes dans une salle de rédaction. Elle va vite, très vite, mais on comprend. On accompagne Ibn Battuta. Il y a des moments politisés, mais ils sont moins frontaux car la forme rejoint le fond et ça donne une séquence belle et dynamique. Je trouve que la première heure est liée à ton envie de tout dire. Mais ça ne prend pas. Dans Inland, il y a un air politique mais ça n’est pas gênant… peut-être dû aux silences et non-dits de ton personnage principal.
Je ne voulais surtout pas faire comme Inland. Je ne voulais pas reprendre ces soi-disant ingrédients d’un film pour en faire un autre. Dans Révolution Zendj, il y a cette séquence où la mère de Nahla parle avec sa fille. Elle lui dit des choses, des choses politiques.
-C’est une très belle scène
Oui, mais c’est exactement ce que tu reproches aux autres séquences.
-Peut-être que dans la séquence dont tu parles, le fait de les filmer en gros plans, donne cette équité.Pas du tout. Il existe des cadres et des formes pour lesquels tu n’es pas sensible. Je peux le comprendre. Mais ça n’est pas en raison du flot de paroles. Le père échange avec sa fille. On entend que de la politique. Tout comme la mère. Dans celui-ci, il y a plus de dialogue que dans mes précédents films car la situation s’y prêtait. Dans Rome plutôt que vous, on filmait le désert d’une ville, la nuit sous le couvre-feu. Dans Inland, on filmait différents types de désertification. Dans Révolution Zendj, on est dans une ville bouillonnante où un journaliste pose des questions. On y voit du théâtre. On lit du Butor, c’est plus volubile mais ça dresse une autre carte plus dense. Dans Inland, on visait à la raréfaction y compris du personnage principal. Dans le dernier, ce mouvement d’intensification se trouve dans les 2/3, après on perd en volubilité, on traverse d’autres espaces. Dans cette première partie, j’ai beaucoup travaillé sur les voix, je voulais qu’elles soient spectrales. Elles disent des choses. Je voulais une coexistence musicale et politique. C’est ce qui m’a frappé par exemple à Thessalonique. Contrairement à Beyrouth. Eux, sont en période d’attente. Il y avait une séquence que j’avais enregistrée mais que je n’ai pas conservée, malheureusement, au moment de cette fameuse discussion que tu juges contestable, mais pas moi…
-Contestable dans la mise en scène
Surtout dans la mise en scène. Je pense vraiment le contraire de ce que tu dis. Entre ces corps sans visage et ces ombres, ça résonne avec tous les autres spectres. Qu’est-il arrivé à la révolution palestinienne ? C’est la question qui est posée dans ce dialogue et ce n’est pas anecdotique. Donc, une jeune femme disait : «Au Liban, on attend la prochaine guerre.» Il est évident qu’ils sont dans l’expectatif. C’est troublant et paradoxal.
-A la fin de ton précédent film, Malek dit : «Je n’étais qu’à moitié là.» Dans Révolution Zendj, toujours à la fin du film, Ibn Battuta arrive enfin sur le lieu où l’on retrouva de la monnaie Zendj. Il fait remarquer à son guide qu’il n’y a rien. Celui-ci, enlève à moitié son turban et lui répond : « Oui, mais nous sommes là ». Ces deux phrases font écho.On me l’a déjà fait remarquer. Je ne l’ai pas fait intentionnellement.
-J’ai l’impression que dans cette séquence, ce journaliste est déçu.Non même pas. Je dirais qu’il est étonné. Il cherchait un nom et un visage. Il l’avait en face de lui, et il ne l’a pas vu. Il est désemparé. La difficulté pour moi dans ce film, c’était de filmer la matière des fantômes. Dans Inland, tu le voyais déjà. Révolution Zendj, c’est un film très incarné. Il y a toujours ces spectres, cette danse de spectres. Diyanna Sabri qui joue le rôle de Nahla, n’est pas actrice. Danseuse et chorégraphe à la base. Le film est toujours dansé. Dans le squat des étudiants en Grèce, dans l’appartement libanais sur la musique des MC5, quand elle tente de fuir les policiers grecs
-Ça danse au début de ton film avec ces jeunes algériens qui encerclent Ibn Battuta.
Exactement. Merci de le rappeler. C’est chorégraphié. Je ne pouvais pas faire plus simple comme émeute. Pour faire entendre ou faire arriver ces sensations, c’est d’enlever beaucoup de choses, d’épuiser la bande-son pour que ça devienne muet. Après produire des respirations dans cette situation, une pointe, un pic. C’est à la condition d’enlever qu’on peut faire entendre. Dans mes films par exemple, la musique, les chansons originales, sont pour la plupart déjà là, bien avant le film… ce sont de vieilles connaissances. Mais il y a très peu de musique. DansInland, il y a 13 minutes de musique et l’on croit qu’il y en a plus. Car j’enlève pour mieux faire entendre. Je fais vivre mon film de cette manière.
-Depuis ton premier long-métrage, tu travailles avec Nasser Medjkane, le directeur photo…
Nasser ne lit jamais le scénario excepté la note d’intention. Il n’y a pas trop de secrets dans nos rapports. On travaille ensemble à l’instinct, sans friction. Nasser ne défend pas le pré carré de la profession. Il n’y a pas de statut entre nous. Il propose un cadre. Il le fait. Puis, ensuite, quand j’ai une idée, je lui propose autre chose. Je cadre. C’est une sorte de «battle» façon rap. C’est de la joute visuelle. Il n’y a pas d’égo. C’est pour ça qu’on arrive à travailler ensemble. Nasser sait d’instinct où je veux aller.
-Dans Révolution Zendj, on remarque le nom du réalisateur Omar Belkacemi qui occupe les fonctions d’assistant-réalisateur.
Je le connais depuis Béjaïa, depuis l’édition 2008. J’avais vu son film (Dihya). Je lui ai proposé de travailler sur mon film. Quand il a pris connaissance du titre initial, Ibn Battuta, il pensait que ce serait un film à costumes, qu’il y aurait toute une équipe avec maquilleuse, etc. (rire). Il n’avait pas encore lu le scénario. Il était affolé au début, ça a mis du temps, mais au fil des semaines, il a très vite compris. Quand on vient d’un système hiérarchisé, on met du temps à s’adapter à autre chose. Mais à partir du moment où il a compris, tout s’est très bien passé.
-Il est vrai…
Avant que j’oublie, je voudrais rebondir sur un de tes articles, où tu décrivais le tournage de Révolution Zendj, comme étant pharaonique. J’ai trouvé ça cocasse… Ça renvoie à une espèce de films avec des moyens conséquents, alors que notre budget est loin de ça. Sur le coup, ça m’a bien fait rire. Sérieusement, quand tu vois Révolution Zendj, ça reste un film à petit budget…
-J’évoquais surtout l’ampleur du tournage dans sa durée
Oui, mais «pharaonique», c’est démesuré voire comique.
-Est-ce que ce film sera projeté à Alger ?
Il le faut. Comme je dois le montrer à Beyrouth, à New-York, Athènes et Thessalonique. Là, où le film s’est baladé. Le cinéma, c’est de trouver les distances, les bonnes distances.
Bio express :
Né en 1966 à Alger, Tarik Teguia a réalisé deux courts métrages de fiction, Kech’mouvement ? (1992, co-réalisé avec Yacine Teguia), et Le Chien (1996), un essai vidéo, Ferrailles d’attente (1998) et un film en vidéo tourné à Alger, Haçla-La Clôture (2002), avant de passer au long métrage avec Rome plutôt que vous (2006, Grand prix à EntreVues), puis Gabbla (Inland) en 2008. Révolution Zendj est son troisième long métrage.
Tariq Teguia fait tomber la
foudre sur Belfort
LE MONDE | <time datetime="2013-12-05T11:32:33+01:00" itemprop="datePublished">05.12.2013 à 11h32</time> • Mis à jour le <time datetime="2013-12-05T15:21:49+01:00" itemprop="dateModified">05.12.2013 à 15h21</time> |Jacques Mandelbaum
<figure class="illustration_haut" style="margin: 0px; position: relative;"> </figure>
</figure>
Changement de mains au festival Entrevues de Belfort, bastion de la cinéphilie française, où Lili Hinstin (jeune programmatrice passée par la Villa Médicis et Cinéma du réel) prend cette année la direction artistique, après l'éviction un rien confuse de Catherine Bizern.
On craignait le pire, qui n'est pas arrivé. La réponse fut étagée. Une compétition digne de la réputation du festival, une notable série d'événements parallèles, depuis la rétrospective consacrée à Jacques Doillon en présence du cinéaste et de ses collaborateurs jusqu'à une carte blanche délivrée au maître du cinéma de genre John Carpenter.
UNE PRISE DE RISQUE
Le geste pour ainsi dire définitif aura consisté en la sélection du troisième long-métrage du réalisateur algérien Tariq Teguia, Révolution Zendj, dont les deux précédents films (Rome plutôt que vous et Inland) ont déjà été montrés à Belfort. Cette avant-première française sera comptée à Lili Hinstin comme un acte de détermination esthétique (rejetée par les festivals de Cannes et Venise, cette oeuvre qui divise a été montrée en avant-première mondiale au festival de Rome) et comme une prise de risque pour l'équilibre de sa compétition (que le film a de fait survolée).
Révolution Zendj fait partie de ces rares films qui, par leur puissance, leur beauté, leur audace...
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 8 Décembre 2013 à 10:57
Sharon Stone. Actrice américaine : «Le cinéma américain ne reflète pas la réalité du monde arabe»
le 08.12.13 | 10h00
| © D. R.Sharon Stone à Marrakech.C’est une Sharon Stone qui se défausse de la truculente image d’Epinal du film Basic Instinct que nous avons rencontrée. Nous avons découvert une star américaine se disant sexy, activiste contre le sida, entière, humaniste, passionnée, très intelligente, ayant de l’humour, parlant de son âge sans complexe. Elle critique les médias américains, elle honnit l’ancien président George Bush et le vice-président Dick Cheney, elle encense le président Barack Obama et l’ex-secrétaire d’Etat Hillary Clinton et espère que celle-ci se présentera à la prochaine élection présidentielle américaine.
-Qu’est-ce qui motive votre engagement agissant pour l’AmFar (The Foundation For Aids Research) ? Où puisez-vous cette force ?
Je pense que nous sommes tous destinés pour une vocation. La mienne n’est pas unilatérale. Et parce que j’aime le fait d’être une actrice. C’est une partie d’un tout. C’est une partie pour atteindre l’humanité. Et permettre à l’humanité de voir ô combien nous sommes les mêmes. Quand vous allez au cinéma, vous vous voyez dans le rôle à l’écran.
-Dans le bon et le mauvais rôles…
Le bon et le mauvais. Et vous aimez cela. Parce que vous êtes libre, seul dans le noir d’être le bon ou le mauvais. Et c’est excitant ! Et vous apprenez sur vous-même. Vous vous éclairez dans le sombre.
-Vous êtes la plus rapide «collectrice» de fonds dans la recherche contre le sida pour l’AmFar…
Quand je travaille sur la collecte de fonds, je permets aux gens de comprendre qu’ils se sentent bien, en abordant quelque chose de mauvais et difficile. Cela permet encore de prendre conscience, de changer à propos de choses qu’ils ignoraient, même de quelque chose de terrible, sombre et inatteignable que le sida. Vous pouvez vous amuser lors des soirées caritatives de AmFar ! Mais le faire mieux !
-Et l’activisme pacifique…
Comme j’ai fait de l’activisme dans le cadre de la lutte contre le sida à travers les voyages globaux, je ferai certainement de l’activisme de paix.
-Que ressentez-vous quand vous regardez dans le rétroviseur de votre carrière filmique ?
Oh, mon Dieu ! Vous savez, quelquefois cela ressemble lorsqu’on regarde des photos de bébés. Quand j’étais en train d’attendre dans le back-stage tout à l’heure (un clip retraçant sa filmographie a été projeté juste avant son entrée), je me suis dit : Waow ! Je fais du cinéma depuis longtemps ! Je me sens bien en regardant cela. C’est bon ! Parce que je me sens mature. Je pense que quand vous êtes une mère, vous regardez les choses avec objectivité par opposition à l’ego juvénile. Quand vous prenez de l’âge, vous regardez objectivement avec des perspectives. Et maintenant que je suis âgée, je pense : «Jésus, je suis superbe ! (Rires). Je m’aime vraiment ! C’est tout bon pour moi ! J’ai une longue carrière. Et maintenant, j’ai de la chance. N’est-ce pas super ? j’espère continuer à faire du cinéma». Je veux dire que je suis plus calme, encore plus relax à propos de toutes les choses. Et à ce moment (de la cérémonie), je me suis sentie vraiment ravie d’être honorée en recevant cet Award rendant hommage à ma carrière. J’ai dit : «Hey ! C’est mon travail, ça ! Quelle chance que j’ai». J’étais vraiment heureuse.
-Que pensez-vous des changements ayant prévalu dans le monde arabe ?
Je ne sens pas que j’ai assez de compréhension, comme Américaine, de tous les changements pour donner une réponse complète ou énoncer un bon jugement. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. J’ai une idée générale. Mais je n’ai pas été assez éclairée. Parce qu’on ne voit pas assez de cinéma du monde en Amérique.
-Le cinéma américain reflète-t-il la réalité du monde arabe ?
Christ (juron manifestant la colère ou l’indignation), que non ! Je pense qu’il y a plus d’honnêteté dans les informations d’Al Jazeera (chaîne TV d’infos continue du Qatar) que dans celles américaines. Il y a une sorte d’immaturité dans notre socialisation. Vous savez, à l’étranger, des pays sont plus engagés les uns envers les autres, parce que certains sont plus petits, d’autres parce qu’ils ne sont pas des superpuissances. Leur force mutuelle engagée fait qu’ils soient actuellement plus culturellement raffinés. L’Amérique n’est pas un environnement culturellement sophistiqué. L’Amérique est un environnement culturellement narcissique. Tout porte sur l’Amérique. Nous n’avons pas une large perspective du monde. Nous avons une sorte de perspective simpliste du monde. Bon Dieu ! Nous avions un Président qui n’est jamais sorti en dehors de l’Amérique. George Bush n’a voyagé nulle part avant d’être président. Comment cela peut arriver ? (deux fois avec colère, en tapant sur la table). C’est ridicule ! Il était président quand il a visité l’Europe. A 20h, il est parti au lit, au lieu d’aller dîner.
Comment pouvez-vous prendre des décisions d’ensemble si vous n’avez pas vu le monde. Je suis tellement excitée à propos de la possibilité de voir Hillary Clinton briguant un mandat présidentiel. Parce qu’elle a passé toutes ces années à sillonner le globe en faisant un travail sur le plan international et de la politique. Oh Dieu, j’espère qu’elle prendra John Kerry (secrétaire d’Etat US actuel) comme vice-président. Parce qu’il a passé un peu de temps à travers le monde, en exerçant de la structuralisation. Parce que nous avons besoin d’avoir une perspective globalisée dans notre nation.-Et le président Barack Obama…
Oh, j’aime Obama. Parce que je pense qu’Obama s’intéresse plus à notre futur. Je pense qu’il a une compréhension mûre et intelligente et une protection sociale (healthcare). Parce que nous vivons plus longtemps, qui va prendre soin de notre vieillesse ? Sûrement pas notre narcissique jeunesse, qui est totalement engagée dans ça : (Sharon Stone imitera les jeunes scotchés au portable qui envoient des SMS). Alors nous avons besoin d’une protection sociale qui va nous aider. A 54 ans (l’âge de Sharon Stone), ce n’est pas le moment pour moi d’avoir un Award saluant une carrière et d’être retraitée. Maintenant, on commence une nouvelle vie. Nous devons avoir une couverture sociale pour la seconde tranche de notre vie. Obama a fait revenir l’industrie automobile en Amérique ; il y a tout juste une semaine, il a ramené à une réalité globale l’esclavage sexuel, il a pris vraiment au sérieux la pornographie infantile. Il ne cherche pas à être populaire. Il cherche à opérer de réels changements dans le monde. Et il agit en interaction sur un niveau global. Et j’apprécie cela. C’est juste très loin de Dick Cheney qui nous vend un peu partout.
-N’avez-vous pas peur de vieillir ?
Laissez-moi vous dire quelque chose : «Je serais toujours sexy !» (Rires). Vous savez, j’ai trois enfants qui ont 7, 8 et 13 ans. Maintenant, je suis habituée à être mère depuis longtemps. C’est drôle de ramener la réalité dans un film (comme Lovelace). Au début de ma carrière, je ne me considérais absolument pas comme sexy. Et il a été très difficile pour moi de décrocher des rôles sexy.
-Comment avez-vous fait ?
Je devais utiliser mon intelligence pour trouver comment être sexy. J’avais une très bonne amie qui était éditrice de photos du magazine Playboy. Alors, je me suis dit que ce serait un pas intelligent pour moi. Parce que si je dis aux gens que je suis sexy, ils penseront que je le suis. J’ai juste à dire : «Hey look I’m sexy» (Eh regardez, je suis sexy !) Donc, j’ai dit à mon amie ce qu’elle pensait si je posais pour des photos en noir et blanc, à condition de faire une interview plutôt intelligente et drôle. Et elle a accepté. Et je l’ai fait. Cinq minutes plus tard, j’ai décroché le rôle dans Basic Instinct. (Rires)
-Le rôle de Catherine Tramell dans Basic Instinct vous colle-t-il à la peau ?
Cela est ma carrière. Ce n’est pas un job, un travail. Ce n’est pas une chose que tu fais, mais ce sont toutes les choses, tout le temps. Cela ne m’ennuie pas. Et ça ne me dérange pas ce que les gens pensent. Je donne le meilleur de moi-même au public, et il le prend comme il veut.
K. Smail
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 9 Novembre 2013 à 14:51
NABIL AYOUCH, RÉALISATEUR MAROCAIN, À L'EXPRESSION
"Je m'intéresse à la source de la violence"
Par Mercredi 06 Novembre 2013 - Lu 6902 fois
Son long métrage Les chevaux de dieu est en compétition au Festival du film maghrébin. Un film sensible et poignant sur la manière dont on devient terroriste. Une plongée dans les abysses du mal et de la violence. Un film qui diffère de ses autres oeuvres cinématographiques mais qui tend parfois à se lier par des fils tenus, comme Ali Zaoua prince de la rue, ou s'en éloigner comme Whatever Lola Wants, notamment puis de revenir par la tragédie humaine à nouveau par le biais du documentaire à travers l'excellent My Land... Bref, nous avons enfin rencontré à Alger ce jeune réalisateur confirmé, qui n'a cessé de nous surprendre après avoir découvert ses films primés à travers le monde...
L'Expression: Les chevaux de dieu, pourquoi un tel film au Maroc? Craignez-vous la montée de l'islamisme et du terrorisme là-bas? Bien que c'est aussi inspiré d'un attentat qui a eu lieu au marché de Marrakech...
Nabil Ayouch: Les chevaux de dieu c'est inspiré de ce qui a été un vrai tremblement de terre au Maroc. Quelque chose qui a secoué l'ensemble du peuple marocain le 16 mai 2013 où 14 jeunes des bidonvilles de Sidi Moumen, qui habitent, à quelques kilomètres de chez moi descendent dans cinq endroits différents et se font exploser en visant pas n'importe quel lieu mais en visant des lieux qui touchent à l'identité marocaine dans sa diversité. Un resto espagnol, un resto italien, un cimetière juif, un centre culturel israélite et un grand hôtel international. Pour nous, au Maroc, c'était quelque chose d'énorme parce que c'est un pays qui est bâti, construit au fil des siècles sur le mélange des races, le mélange des cultures et là, ça a été quelque part la fin de l'innocence. D'un seul coup ça était un réveil très brutal. Il se trouve que ce quartier de Sidi Moumen, je le connaissais très bien, j y ai tourné les premiers scènes d'Ali Zaoua. J y ai aussi tourné des documentaires sur le microcrédit à Sidi Moumen. C'est un quartier que j'ai beaucoup arpenté. J'ai été peut-être plus heurté par ce qui s'est passé le 16 mai 2003 quand j'ai appris que ces jeunes descendaient de ces quartiers-là. J'ai eu envie d'y retourner. J'avais envie d'aller à l'écoute de cette jeunesse et d'entendre ce qu'elle avait dire. C'est petit à petit comme ça que j'ai construit le propos du film.
Ce n'est pas une reconstitution mais la façon que vous avez de raconter avec ces tranches chronologiques lui donne un cachet de véracité supplémentaire...
Comme si c'était la biographie de ces gamins, car quand ils vont commettre ces attentats ils ont 22 ou 23 ans. Ils sont tout jeunes. Je me suis inspiré d'un roman qui s'appelle Les étoiles de Sidi Moumen, roman de Mahi Bine Bine. Qui parle de faits réels. C'est un peu sur la base de ces matières-là que j'ai eu envie de repartir à l'origine de la violence. A la source de la violence car elle ne vient pas de nulle part. Elle a une origine et ce qui m'intéresse dans Les chevaux de dieu c'est d'aller remonter à cette origine.
Vous démystifiez un peu comment on devient terroriste. Un peu comme dans le film de Nouri Bouzid Making of mais différemment... Est-ce une manière de comprendre ces gens-là et leur cheminement?
Comprendre en tout cas ce qui pourrait être compris, car tout ne peut pas être compris dans cette histoire car il y a des choses qui nous échappent forcément. Pour qu'un être humain décide d'en arriver là, il doit arriver à un certain degré de désespoir, ajouté à cela des paramètres que l'on ne maîtrise absolument pas. Mais en tout cas il y a des facteurs et des éléments constructeurs qui bâtissent cet adulte différemment de ce qui l'aurait été s'il avait grandi dans un environnement autre, s'il avait été à l'école, s'il avait une structure familiale solide qui l'encadre mais pas vécu tous les microtraumatismes qu'il a vécus dans son enfance et qu'on voit dans le film, s'il n'y avait pas eu cet endoctrinement, etc. En gros, c'est sortir des schémas basiques, binaires dans lesquels on veut nous enfermer, surtout les médias occidentaux quand il traite du phénomène du terrorisme où en général on prend beaucoup de raccourcis et on est dans la conséquence et non pas dans la cause. J'ai essayé de comprendre comment effectivement comme vous l'avez dit, un gamin de 10 ans peut se transformer en une bombe humaine.
Ce qui m'a intrigué dans votre façon de filmer est ce premier plan qui, partant du ciel de la carte géographique zoome ce petit patelin isolé, qu'avez-vous voulu signifier par là?
Ce qui m'a frappé dans ces bidonvilles, car j'en ai visité plusieurs, c'est leur isolement. Leur déconnexion. Ils ont été oubliés, donc ils sont plantés quelque part très loin et en même temps, il n'y a rien qui les relie au reste de la ville. La plupart du temps il y a cette fameuse autoroute qu'on voit au début du film que les gamins traversent après le match de foot. Façon de dire que là c'est le monde réel, c'est l'économie, c'est l'industrie, c'est l'emploi et de l'autre côté c'est le chômage, c'est l'oubli, l'absence d'éducation, et c'est là qu'ils vivent et ont grandi. Façon de planter le décor.
Vous l'avez dit, et effectivement je l'ai remarqué quand on regarde le début du film on pense forcément à Ali Zaoua, vous êtes donc influencé par l'univers des enfants?
Ce qui est sûr c'est qu'il y a une fratrie entre les deux films. Il y a une consanguinité indéniable. Quelque part, ces jeunes qu'on voit dans Les Chevaux de dieu sont ce que les enfants d'Ali Zaoua auraient pu devenir. Après, pour répondre plus directement à votre question, je m'intéresse aux marginaux, à ceux qui vivent à la marge. Plus qu'à ceux du milieu. Parce qu'ils ont leurs codes, ils ont des choses à dire, des choses à raconter. Et je pense qu'on ne les écoute pas suffisamment.
Est-ce le fait d'être métis, né d'un père musulman et d'une mère juive française d'origine tunisienne qui a fait que vous vous intéressez aussi aux deux camps (juif et musulman) dans le documentaire My land sans pouvoir trancher ou juger. Vous aviez peur de vous mouiller?
C'est ça qui fait que je m'intéresse à la différence. Aux différences, c'est cette double identité absolument. Dans mon enfance et ce qui a jalonné mon parcours, j'ai été beaucoup marqué par la période de 5 à 14 ans, pendant une dizaine d'années où j'ai grandi à Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Je ressentais très fortement ce sentiment d'exclusion à la fois, parce que Sarcelles est une ville très communautariste, composée d'Arabes, de Noirs, des Asiatiques, et que moi j'étais un mélange de différentes races, je ne me sentais pas appartenir à une communauté ou à une autre. J'avais un sentiment d'exclusion aussi par rapport à la grande ville qu'était Paris, qui était à la fois toute proche et inaccessible. Je pense que c'est pour ça que j'ai assez vite compris ce que pouvaient ressentir les jeunes de Sidi Moumen, ces jeunes des bidonvilles et j'ai eu envie de m y intéresser. Je me sentais aussi oublié, déconnecté...
Dans votre film My land vous avez eu la judicieuse idée de filmer les deux côtés des camps et de montrer les images aux uns les autres en les confrontant aux points de vue de l'autre. Pourquoi?
J'avais envie de confronter en fait deux mémoires. Une mémoire palestinienne dont l'horloge biologique s'est arrêtée en 1948, donc une mémoire figée. Et puis de l'autre côté, des Israéliens de la jeune génération, donc je saute une génération, une mémoire jamais apprise parce qu'ils ont la mémoire de leur peuple mais ils n'ont pas la mémoire de la terre. Ils sont capables de vous parler de ce qui s'est passé il y a deux mille ans, mais sont incapables de vous parler de l'histoire palestinienne. J'avais envie d'ouvrir des portes, d'éveiller les consciences et j'avais envie véritablement que cette jeunesse israélienne qui vote, qui décide de l'avenir de son pays, petit à petit puisse prendre conscience de choses dont elle est ignorante. Véritablement ignorante et du lavage de cerveau qu'elle a eu à subir depuis des années et même des décennies de la part de son gouvernement, des médias, des manuels scolaires... Il y a un vrai black-out sur la mémoire palestinienne.
Quand on voit et on écoute cette jeune fille juive vers la fin du film, qui plaide pour le vivre-ensemble on comprend en quelque sorte le message ou l'idéal vers lequel tend votre film et qui résumerait peut-être votre état d'esprit...
Il y a à la fois un enjeu politique qui est sous-jacent, sur lequel je suis très pessimiste et puis un enjeu humain pour lequel par contre j'ai plus d'espoir. Parce que, dès qu'on parle de l'humain, les frontières bougent à l'intérieur beaucoup plus facilement que si on parle de territoire, absolument. On sent bien dans le film la manière dont évoluent ces Israéliens vis-à-vis de ces images des Palestiniens. On sent que cela les affecte. votre commentaire
votre commentaire
-
XAVIER DE LAUZANNE, RÉALISATEUR FRANÇAIS, À L'EXPRESSION "Le rôle de l'éducation scolaire dans l'int
Par hechache2 le 22 Octobre 2013 à 10:04.XAVIER DE LAUZANNE, RÉALISATEUR FRANÇAIS, À L'EXPRESSION
"Le rôle de l'éducation scolaire dans l'intégration"
XAVIER DE LAUZANNE, RÉALISATEUR FRANÇAIS, À L'EXPRESSION
"Le rôle de l'éducation scolaire dans l'intégration"Taille du texte :



En France, l'école a pour obligation d'accueillir tous les mineurs de moins de 16 ans, français ou étrangers, en situation légale ou non. Pour de nombreux adolescents migrants, ballottés d'un continent à l'autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d'intégration. Le réalisateur Xavier de Lauzanne a posé sa caméra sur les bancs de l'école où Aboubacar, Dalel, Hamza, Thierno et Tako font leurs premières armes...Mais la réalité est souvent semée d'embûches. Réussit-on pour autant et à quel prix? Enfants valises est le titre de ce formidable documentaire distribué actuellement en France grâce à Aloest Distribution-cinéma. Un film qui mérite le déplacement, au regard de l'actualité brûlante aussi qui secoue en ce moment la France en entachant son système politique avec l'expulsion d'enfants scolarisés...
L'Expression: Ce n'est pas Entre les murs, ni L'esquive, votre film donne la part belle aux professeurs, ce qui est tout à fait à leur mérite. Alors qu'en France on critique souvent le système éducatif, vous faites, du coup, un film qui redore un peu le blason de ces professeurs qui sont remarquables dans votre oeuvre..
Xavier de Lauzanne: Oui, car on n'est pas dans le jugement. En fait, dans tout le documentaire, que ce soit à propos des élèves ou des enseignants, on n'est pas dans le jugement. Ça laisse aux spectateurs beaucoup de liberté pour justement voir de quelle manière l'enseignant s'accomplit et les élèves s'accomplissent de leur côté. Evidemment, il y a beaucoup de critiques sur le système scolaire et éducatif, des remises en cause qui sont en même temps nécessaires, mais ça ne doit pas retirer le fait que l'éducation a un rôle bien évidemment primordial dans l'épanouissement d'une personne et dans le cas de l'immigration, ces jeunes-là qui viennent d'arriver sur le territoire français, quel est le premier visage français qu'ils voient? C'est leur enseignant. La place de l'enseignant est donc très importante. Ce qui m'intéressait de voir était la place de l'éducation dans le processus de l'intégration. On voit évidemment que c'est absolument essentiel et que l'enseignant a un rôle primordial, car c'est lui qui va être souvent le premier élément de stabilité pour ces jeunes-là qui vivent des situations assez rocambolesques.
Justement, c'est vrai que même si les professeurs paraissent très chaleureux et humains, le système éducatif est très présent avec ses failles. Il y a cette séquence où la prof parle de laïcité avec une de ses élèves et lui demande d'enlever son voile. Aujourd'hui, en France, il y a toujours ce débat-là autour du voile, y compris via cette loi contre son port à l'université. Ça vous interpelle? Ça provoque quoi en vous?
Le voile? Honnêtement rien. Je m'en fiche. Franchement, on fait généralement grand cas de petites choses et très honnêtement pour moi, le voile c'est une petite chose. Car il y a à côté de ça, plein de choses extraordinaires qui se passent. Vous avez quelques personnes qui refusent de l'enlever et ça fait la une de l'actualité. Alors que vous avez des tas d'élèves qui comprennent ce discours sur la laïcité, qui fait partie des valeurs françaises et qui l'acceptent. Et puis quand on vit en France et on veut devenir Français, eh bien, on l'accepte la loi française et la majeure partie des gens originaires de l'étranger l'acceptent. Vous me demandez ce que cela provoque en moi, eh bien rien, car je m'en fiche puisque cela concerne une minorité. Enfin, une minorité qu'on rend visible. Malheureusement. Et donc après on en parle et ça fait beaucoup de bruit.
Votre film fait écho indirectement à ce qui se passe en France, notamment ce fléau qu'est l'islamophobie dont on parle aussi beaucoup, ainsi que le racisme. Ce qui m'a frappé surtout est de voir ces vieilles femmes qui se disent juives et qui viennent témoigner dans cette classe de leurs souffrances subies lors de la shoa en les comparant aux problèmes de racisme que vivent ces enfants. N'est-ce pas un peu tiré par les cheveux, incomparable même car ça remet encore une fois sur le tapis cet éternel sentiment de victimisation des juifs qui tendent à faire attendrir les autres sur leur passé? Sous-entendez-vous donc que le gros problème de racisme dont souffrent ces enfants est comparable aux souffrances des juifs?
C'est un groupe de personnes âgées qui sont venues témoigner dans la classe. Elles parlent justement du rapport à la différence et de l'acceptation de la différence voilà. Chacun parle en son nom. La personne juive qui a souffert de cette question-là regarde l'autre, elle en parle en tant que juive, mais elle ne doit pas bien l'avoir évidemment perçue comme une généralité. La comparaison s'arrête là. Il s'agit juste de souffrir du regard de l'autre. Souffrir d'une méconnaissance de l'autre sur soi-même et c'est de ça que ces personnes voulaient parler. La question de l'islamophobie en France, encore une fois, je la trouve terrible, car combien de fois on parle d'islamophobie et combien de fois on parle d'entreprises d'initiatives qui sont faites pour la coexistence. Eh bien la coexistence en marche qui marche, on n'en parle jamais dans les médias. Par contre, de l'islamophobie on en parle. Eh bien, c'est pareil. Cela concerne une minorité de la population. Alors que l'acceptation de la coexistence, ça concerne la majorité de la population et ça c'est le problème de la médiation qu'on rencontre. C'est quelle est l'image que les médias nous renvoient? C'est une image portée sur la polémique. Pourquoi? Parce que la polémique fonctionne, fait vendre, amène du fric, de l'argent. Donc, on cultive cette polémique. Mais à force de la cultiver on crée l'image d'un monde insupportable, qui ne correspond pas à la réalité de ce monde-là. Ce qui me fait plaisir en faisant des films comme ça, c'est qu'on parle d'un monde qui est quand même le monde de tous les jours, qui existe, qui n'est pas un monde de conflits et de polémiques et qui est un monde de gens qui essayent d'avancer dans la vie, de se construire et pour lequel on essaie de construire des outils et que l'on intègre. En France, mine de rien, comme le film le dit au début, il y a quand même une loi qui précise que tout mineur entre 6 et 16 ans est obligatoirement accueilli par l'éducation nationale, qu'il soit homme ou femme, sans papier ou en situation légale. N'importe qui pose son pied sur le territoire français et qui est mineur est accueilli dans les structures de l'éducation nationale. C'est une belle loi. A mettre en oeuvre ce n'est pas forcément évident.
Comment sont dirigés ces enfants vers ces classes spéciales qui n'existent apparemment quasiment plus, depuis que vous avez tourné votre film il y a quatre ans?
Les dispositifs existent. C'est la forme du dispositif qui change à chaque fois. Qui s'adapte à la question des moyens et de la demande. Cela existe toujours, bien évidemment.
Pourquoi ces jeunes sont toujours dirigés vers des diplômes professionnels?
Ils ne sont pas toujours orientés vers des diplômes professionnels, mais comme ce sont des jeunes qui reviennent souvent en France, qui n'ont pas vraiment un bon niveau scolaire, ils sont orientés vers ces classes, sinon certains sont scolarisés en France puis partent un an au pays et quand ils reviennent ensuite et gardent un niveau tout à fait correct, dans ce cas, ils restent dans les voies normales.
Sur les cinq dont certains étaient en total échec scolaire, je n'ai pas entendu un qui a dit qu'il a été à la fac.. Je parle de la fin de leur cursus quand vous retournez les filmer 4 ans après.
Eh bien oui. Déjà c'était des jeunes qui avaient un niveau en dessous du niveau normal à cet âge-là. Ils avaient au départ entre 13 et 15 ans. Ils avaient un niveau scolaire qui était bien en dessous. Après, il faut rattraper ce niveau. Vous ne pouvez pas demander à un élève qui a un niveau complètement en dessous de rattraper tout ça en deux ans ou voire d'un an pour rentrer à l'universalité. Ils sont en retard par rapport à d'autres enfants de leur âge, c'est pour cela qu'ils sont dans ces classes là. S'ils avaient le même niveau, ils iraient dans les classes normales. Les aider, c'est les orienter après vers des voies professionnelles où ils pourront s'accomplir, plutôt que de rester dans une voie où ils seront en situation d'échec en permanence et seront les derniers de la classe...
Comment s'est fait le choix de ces enfants? Pourriez-vous nous les rappeler?
Oui, il y a Aboubacar qui est Ivoirien. Il a été scolarisé en Côte d'Ivoire, a vécu de plein fouet les violences et la guerre là-bas et a rejoint son frère en France, il y a Tierno qui est Français, mais qui a été renvoyé au pays pendant plusieurs années. Il est d'origine guinéenne et sénégalaise. Il y a Dalal qui est Algérienne et qui venait d'arriver en France chez sa mère et ses deux soeurs et puis il y a Taco qui a perdu son père et qui est arrivé en France chez sa mère en opérant plusieurs allers-retours. Il y a aussi le Tunisien Hamza qui est venu tout seul en France et qui était mineur isolé. Ce qui m'a intéressé chez ces enfants c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà l'émotion qu'ils renvoient. Des choses de l'ordre du sensoriel que l'on perçoit, en plus ils avaient chacun des parcours différents. Donc ça pouvait être une complémentarité entre les uns et les autres.
Vous suivez ces jeunes pendant un an et puis vous ressentez le besoin de savoir ce qu'ils sont devenus des années plus tard pour boucler la boucle? Pourquoi cette volonté de vouloir revenir plus tard sur leurs traces?
Ce n'est pas revenir, mais au contraire aller de l'avant. Effectivement, je termine le film sur un spectacle qu'ils ont donné à la fin de l'année et qui permet un peu de mesurer la progression qu'ils ont pu faire au courant de l'année et après je trouvais cela intéressant de finir le film sur une perspective d'avenir parce qu'il ne s'agit pas d'observer une classe pendant une année, mais de connaître quel avenir pour ces jeunes-là. Je trouvais intéressant d'ouvrir le film au lieu de le terminer sur quelque chose de bouclé, et ce, en les retrouvant quelques années plus tard et voir un peu quel parcours ils avaient pu faire et observer ceux qui ont l'air de se frayer un chemin de manière assez franche et ceux qui vont mettre plus de temps, car ils ont une situation un peu plus compliquée. J'ai attendu aussi 4 ans, car c'est à la fois un problème de production et un choix. Je n'avais pas de diffusion prévue, ni de télé avec moi et donc de financement. Je travaille par ailleurs sur d'autres projets. Le montage m'a pris beaucoup de temps. Sachant que du coup, le film allait mettre du temps pour se terminer, je me suis dit autant le tourner en positif et en profiter pour justement faire une fin ouverte et voir ce que sont devenus ces jeunes-là. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 7 Octobre 2013 à 20:37
Amar Si Fodil. Cinéaste algérien : «Quand on fait un film, c’est déjà un risque !»
le 06.10.13 | 10h00
zoom | © D. R.Jours de cendre est le premier long métrage de Amar Si Fodil. Le film était en compétition officielle au 7e Festival d’Oran du film arabe (FOFA) qui s’est déroulé du 23 au 30 septembre dernier. Le film est produit par Bachir Deraïs, avec l’appui financier du FDATIC, fonds du ministère de la Culture et de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC). Jours de cendre, qui relève du cinéma noir, a été critiqué après sa première projection à Oran. Le film porte les stigmates d’une première expérience, peu réussie, pour Amar Si Fodil dans la réalisation d’un long métrage. Dans cette interview, le jeune cinéaste évoque les difficultés qu’il a eues avant et pendant le tournage, et parle de sa vision du cinéma ainsi que de l’idée du film.
-Vous avez réalisé plusieurs courts métrages, et vous venez de réaliser Jours de cendre, comment s’est fait ce passage ?
J’ai décidé de passer au long métrage après mon retour de France. J’ai étudié l’art et le cinéma à Marseille pendant une année. Je suis rentré en Algérie, et j’ai tourné un court métrage, c’était en 2007. J’avais déjà tourné des courts métrages d’école, aux beaux-arts d’Alger, des films autofinancés. Aux beaux-arts de Marseille, j’ai commencé à écrire un scénario d’un court métrage. Mon professeur d’analyse de cinéma m’a dit que ce scénario pouvait se développer en long métrage. J’ai commencé à travailler dessus. Entre-temps, je suis rentré à Alger où j’ai tourné un court métrage, Le doute, qui a décroché le prix Ali Maâchi (...). J’ai rencontré par hasard Bachir Deraïs dans les couloirs du ministère de la Culture, avec qui j’étais assistant stagiaire sur une production de Merzak Allouache en 2004 (Babor Edzaïr). Je lui ai parlé de mon projet. Nous avons travaillé pendant trois mois sur le scénario, et puis nous avons déposé le dossier d’une demande auprès du Fdatic. Nous avons attendu plus d’une année pour avoir le financement. La commission du fonds a demandé une réécriture du scénario
Pourquoi ?-Il y avait des choses particulières à changer. Par exemple...
Franchement, j’ai oublié. L’essentiel est que le scénario ait été réécrit.
-Et quel a été le déclic de l’histoire racontée dans Jours de cendre ?
A Marseille, je lisais la presse algérienne, et je suis tombé sur un article relatant un fait divers, la découverte de deux cadavres, d’un homme et d’une femme, dans une forêt du côté d’El Eulma. C’était le déclic. Je voulais travailler sur une idée, savoir pourquoi ces deux cadavres s’étaient trouvés dans cet endroit précis. Sur conseil de mon professeur à Marseille, j’ai écrit un scénario pour un long métrage. Et dans Jours de cendre, vous trouvez la scène de deux cadavres en forêt.
-Dans Jours de cendre, Alger est très présente...
Alger, c’est beau, violent. Je ne sais pas si j’ai réussi ou pas, je voulais qu’Alger soit l’un des personnages du film. C’est pour cela que j’ai filmé de cette manière les rues de la capitale. Cela a peut-être provoqué des ruptures dans la compréhension du long métrage. Au fait, je voulais expérimenter la construction d’un plan cinématographique à partir d’une vision d’architecte, puisque je le suis de formation. Je pense que je n’ai pas eu assez de recul…
-Qu’en est-il du casting ?
Je voulais découvrir de nouveaux comédiens. Dans le film, quatre comédiens n’ont jamais joué dans un film auparavant, comme Farid
Guettal (Ali) ou Youcef Sahaïri (Amir). Youcef a fait du théâtre mais pas de cinéma (il a également interprété un rôle dans un feuilleton de Bachir Selami, ndlr). J’ai terminé le tournage en juillet 2012. Le choix de Lamia Boussekine est motivé par le fait que je cherchais une comédienne qui avait la maturité et la fragilité à la fois pour interpréter le rôle de Fatima. J’ai «casté» plusieurs comédiennes non expérimentées, mais je ne voulais pas prendre ce risque surtout pour un rôle principal.-La bande originale du film paraissait effacée à l’écran, pourquoi ?
Un bon travail a été fait avec le compositeur Lyes Mahmoudi, un jeune talentueux, sur la musique et l’image. Il est vrai que la musique originale n’est pas très présente dans le film. J’estime que l’utilisation de la musique facilite l’accessibilité à la compréhension. Je n’en voulais pas, en fait. Sans vouloir compliquer le récit, je refusais d’en faire un long métrage musical. J’ai fait le choix d’utiliser la musique à des moments (...). J’ai pris deux chansons du groupe Amarna, deux chefs-d’œuvre de la musique algérienne. La mort de Djillali (chanteur du groupe) est une perte pour la musique algérienne. Ces deux chansons, comme Khilwni nbki ala rayi, reflètent la mélancolie présente dans le film, l’histoire de Fatima. Elle rendait bien l’émotion que je voulais. J’ai été étonné d’entendre des personnes s’interroger sur la non-utilisation de la musique algéroise, puisque l’histoire se déroule à Alger ! Amarna est un groupe algérien ! Finalement, c’est compliqué... Lors de la projection ici à Oran, le public a applaudi le film…
-Etes-vous satisfait du jeu des comédiens...
Satisfait ou pas, nous avons énormément travaillé. J’ai pris le risque de faire appel à des comédiens non expérimentés. Je suis content de les avoir découverts. Quand on fait un film, c’est déjà un risque. Le risque zéro n’existe pas. Un tournage, c’est très éprouvant. Rester sur le plateau durant toute la journée n’est pas facile pour les jeunes acteurs. Grâce à leur expérience, Samir El Hakim et Lamia Boussekine arrivaient à gérer leur fatigue. Ce n’était pas le cas pour les autres. Le plus talentueux des comédiens non professionnels peut s’effondrer à tout moment. Nous avions un plan de travail très serré. Nous tournions jour et nuit. Il fallait tourner en 30 jours.
-Vous avez dû supprimer beaucoup de scènes au montage. C’est en tout cas visible à l’écran…
J’avais un premier montage qui faisait deux heures. J’ai trouvé que c’était très long par rapport à la compréhension du film. J’ai préféré raccourcir le film, mais un film n’est jamais achevé. Quand je l’ai vu en salle, j’ai découvert qu’il y avait des choses que j’aurais dû modifier, arranger. Quand on fait le montage d’un film, on le fait sur les petits écrans. En Algérie, nous n’avons pas les audits ou les salles de projection de pré-montage pour visionner les films et rectifier ensuite.
-Lors de la projection ici à Oran, il y a eu des rires dans la salle. Vous avez une explication ?
Franchement, je n’ai pas d’explication. A l’écran, il n’y avait rien de drôle (....). Certains ont dit que le réalisateur est en train de jouer avec le spectateur. Bien sûr, j’ai essayé de travailler sur l’émotion, créer des zones dans le film pour amener le spectateur à se poser des questions.
-Et comment trouvez-vous le cinéma algérien actuel ?
Nous avons des difficultés à produire des films en Algérie. Le nombre de films produits par année est très faible. C’est triste. A travers cette première expérience de long métrage, j’ai compris beaucoup de choses.
Ce n’est pas un problème d’argent mais celui de structures et de techniciens. Alors que tout était prêt, nous avons attendu pendant deux mois avant de commencer le tournage, en raison de l’absence d’un technicien, retenu dans un autre tournage. Je parle de production, pas de distribution ou de salles de cinéma (…). Je ne vois pas quelles sont les thématiques traitées par le cinéma algérien, mis à part la guerre d’Algérie. Sinon, il n’y a que des films tels que ceux de Djamila Sahraoui Yema, ou Fatma-Zohra Zaâmoum Kedach thabni... Des avant-premières de films sont organisées à Alger, après on ne voit plus rien, pas de distribution de films au niveau national. Le Festival d’Oran m’a permis par exemple de voir Zabana ! (Saïd Ould Khelifa) et Harraga Blues (Moussa Haddad). Je n’ai pas pu voir ces longs métrages à Alger.Fayçal Métaoui
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien





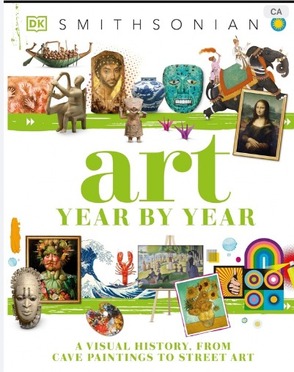




















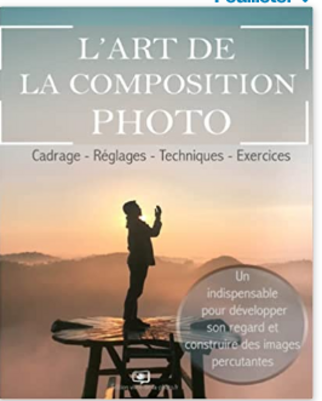







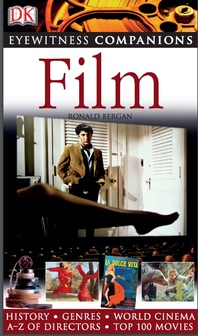





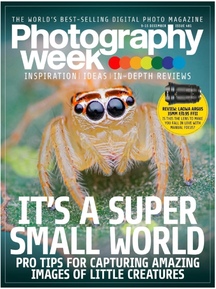



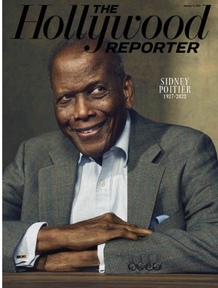








































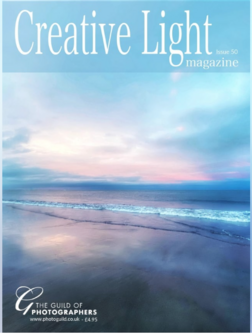

















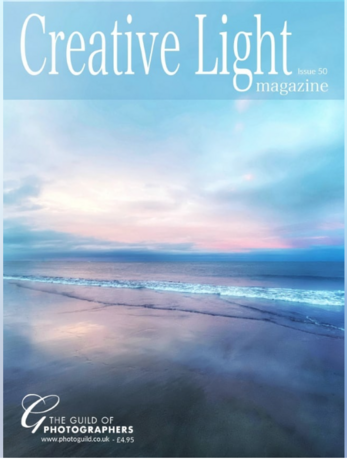


















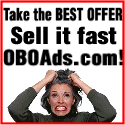
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot









