Le cinéaste syrien, Mohamed Mallas, rencontré au 4e Festival du film arabe de Malmö
“Je suis toujours travaillé par la douleur et le malheur des autres”
Par : Houchi Tahar
Le plus rebelle et le plus libre des cinéastes syriens s’est imposé sur la scène cinématographique mondiale malgré la censure du régime de son pays qui a sensiblement réduit son élan créatif.
Après, entre autres Al Manam (1987), Al Lail (1992) et Passion (2005), il rompt 9 ans de silence et livre L’Echelle pour Damas (2013) qui sort alors que la Syrie est prise dans un cyclone de violence inouïe. Le succès a été immédiat. Il reprend son bâton de pèlerin pour sillonner le monde pour défendre son film, évoquer son projet intellectuel et témoigner de la Syrie meurtrie.
Liberté : Derrière vous, vous avez plus de 40 ans de pratique cinématographique et littéraire. Quel regard jetez-vous à cette tranche de l’histoire dans laquelle vous avez été pris à la fois comme acteur subissant et agissant ?
Mohamed Malas : Ma nature profonde, ma tendance à interroger aussi bien mon existence que celle de ceux qui m’entourent et mon besoin perpétuel de m’exprimer m’ont conduit à apprendre, à maîtriser et à développer les langages cinématographique et littéraire. C’était mon moyen de trouver mon équilibre intérieur et d’agir sur l’histoire en me positionnant du côté de la justice et de la vérité. J’étais et je suis toujours travaillé par la douleur et le malheur des autres. Mes choix m’ont attiré les foudres de la censure qui a toujours essayé de me réduire au silence et d’effacer mes œuvres.
Mais ma détermination et la puissance de l’art ont fait que la répression, malgré ses petites victoires, ne triomphera jamais sur moi. Ces dernières années les Syriens ont crié, l’autorité a redoublé de férocité, et le peuple s’est rebellé d’une manière spontanée et anarchique. La communication langagière et artistique a reculé au profit des crépitements des armes et des explosions de roquettes. Dans cette situation tragique, cacophonique et absurde, je continue à déployer mes forces et énergies pour produire, servir mon peuple et marquer l’histoire.
En quoi consistent justement ces productions ?
Aidé par mon penchant pour la forme littéraire et le besoin d’expression, j’ai tenu, depuis 1968 jusqu’en 2005, un journal quotidien dans lequel je transcris mes réflexions et mes émotions autour de l’actualité, de ma vie et de mon expérience cinématographique. Pour moi, ces écrits sont une référence inestimable qui me permet aussi bien de justement cerner le passé que de mieux comprendre le présent. Ainsi, la préparation et la réalisation de mes films ont été accompagnées par des journaux quotidiens. Le film Al Manam a vu son journal publié à Beyrouth, chez Dar Al Adab, sous le nom de “Journal d’un film”. Je considère cette publication comme la plus proche et fidèle à mes intentions littéraires. Le Journal de Moscow dépassant les 1000 pages renferme des témoignages importants sur moi et mon entourage de l’époque, notamment dans le monde soviétique. Durant les 4 derniers mois passés à Damas à préparer le montage financier de mon prochain film, j’ai puisé dans ces écrits. Je pense même à publier prochainement un livre sous le nom de “Cinéma enterrée, journal d’un cinéaste syrien : 1974-1980”.
Cette délimitation historique a-t-elle une signification particulière ?
Oui. J’y évoque surtout la naissance et le développement de ma très forte relation amicale avec le cinéaste syrien Omar Amiralay avec qui j’ai cofondé Cinéma Club de Damas. Je me suis arrêté en 1980 car cette date coïncide avec nos départs respectifs de Damas : Beyrouth pour travailler sur le film Al Manam me concernant, et Paris pour Omar.
Vous avez encore d’autres projets ?
Oui. J’ai un deuxième livre qui est prêt pour publication “Journal et scénario d’un film non réalisé”. Après mon film Al-Lail et mon effleurement de la mort, j’ai entamé un projet de film portant le titre “Cinéma dunia” qui a été aussi accompagné d’un journal quotidien. Le projet, au seuil de la réalisation, a été remis aux calendes grecques suite aux blocages du centre cinématographique syrien. Aujourd’hui, l’envie de reprendre le projet et le transformer en livre me tient à cœur.
Qu’en est-il de la caméra ?
En matière de cinéma, j’ai un scénario ficelé et je suis dans la phase de montage financier. C’est une production internationale. Nous cherchons, avec mes producteurs français et tunisien, des compléments de financement avant de lancer le tournage. Le film va se dérouler essentiellement à Beyrouth, mais aussi en Syrie. Le titre de travail est “Lumière”. Le titre en arabe est “Leit lel Barrak 3aynan” qui est une chanson d’Ismahan.
Réalisateur actif et engagé, vous avez évolué en marge des circuits officiels. Par conséquent vos films ont été victimes de la censure, entre autres, le documentaire Nur wa Zilal (1990) et Al-Lail (Tanit d’or au Festival de Carthage en 1992) lequel n’a été projeté en Syrie qu’en 1996. A l’instar des cinéastes américains, soumis au code du sénateur William Hays, la censure vous a poussé à emprunter des chemins artistiques aussi sinueux que prolifiques. Pensez-vous que cela a été une chance même si cela a réduit sensiblement le nombre de vos réalisations ?
Les réalités se construisent par étapes et naturellement. Depuis le début, j’étais bercé par l’illusion que nous pouvions mettre notre art au service de notre peuple et à conduire notre société vers le progrès.
Aujourd’hui, nous découvrons avec stupéfaction le contraire. Le pouvoir savait mieux que nous. Il s’est montré vigilant et répressif avec nos écarts en matière de liberté. En même temps, il est vrai que cette dureté a crée les conditions propice à une recherche formelle et esthétique qui a au final beaucoup servi et amélioré mon langage cinématographique. En d’autres mots, cela a favorisé et accéléré ma compréhension et ma maitrise de cette puissante arme que j’ai affutée autant que j’ai pu. On apprend mieux sur les chemins difficiles. En substance, je ne dirai pas qu’il s’agit d’une chance, mais cette posture de censuré m’a permis d’affûter mon expression cinématographique et donner de l’épaisseur à mon projet intellectuel.
Vous affectionnez aussi bien le documentaire que la fiction. Avez-vous une préférence ?
Le cinéma est pour moi unique. Il est un moyen d’expression de choses profondes et existentielles. Quand la fiction ne répond pas à mes besoins et intentions, j’opte pour le documentaire qui me permet de m’appuyer sur un lieu, une idée ou un personnage pour m’exprimer. Le cinéma est comme l’écriture ; la caméra devient une plume. L’absence de caméra est comblée par le stylo. Mes films prennent souvent des formes littéraires particulières. C’est donc le besoin profond qui détermine le choix et la méthode. J’écris et je réalise quand les souffrances et les douleurs de la vie m’interpellent. Je me demande souvent quand est-ce que la vie devienne normale afin que je puisse plus sentir le besoin de prendre ma plume ou ma caméra.
Comment lire votre dernier film l’Echelle pour Damas ? Une échelle pour le rêve ?
C’est surtout une échelle vers notre Syrie que nous voulons. Pas celles des autres : pouvoir, rebelles et étrangers confondus. Après 40 ans de silence, de patience et d’acceptation, pendant que mes limites ont été atteintes depuis longtemps, les Syriens sont arrivés à un degré où ils ne peuvent plus continuer à vivre comme des moutons. C’est là l’explication de l’explosion aussi violente que surprenante. Le film est construit à l’instar d’un poème visant à exprimer une douleur. Il faut absolument prendre de la hauteur pour comprendre la Syrie et la projeter dans le futur. Et dans une telle posture, une question lancinante s’impose à moi : vais-je mourir en douceur ou fauché par une explosion ?
à quoi ressemble le visage de Damas aujourd’hui, loin des descriptions médiatiques ?
Son visage est très amoché. Elle a accueilli des milliers de Syriens qui sont venus des autres parties du pays à la recherche de la sécurité. Tout le monde cherche aussi à se reconstruire, même si cela est difficile à cause des diverses occupations et agressions qu’ils subissent. Quand les contraintes et les problèmes grandissent, les espoirs s’amenuisent. La violence, la peur, la méfiance et l’insécurité font partie de la vie quotidienne.
Malgré cela, vous avez fait le choix de rester vivre sous le ciel de Damas obscurcie par la poudre et la poussière des explosions. Quelles sont vos raisons?
J’ai choisi de rester en Syrie essentiellement pour deux raisons : vivre auprès des miens et protéger mon projet cinématographique et intellectuel. La vie n’est pas aisée. Je ne fais pas de l’exagération en disant qu’elle est même infernale. On vit au milieu d’un champ de bataille. Il y a l’autorité officielle qui lance des roquettes depuis Damas. Il y a aussi les rebelles qui répliquent. Les roquettes tombent parfois sur le toit de mon voisin, parfois un peu loin. Chaque minute qui passe, on prie Dieu que notre mort soit la plus douce qui soit. Nonobstant, je ne veux guère terminer ma vie en exil.
Après un soulèvement plein d’espoir contre la tyrannie, la Syrie a sombré dans le chaos. Un monstre prend possession de la moitié du pays et des avions étrangers bombardent. Quelle analyse faite-vous de la situation ?
Après 4 ans de barbarie, de tuerie de tortures et de sauvagerie, on assiste à l’émergence d’une structure humaine, quand humanité il y a, anormale. Le dialogue est remplacé par la méfiance, la confrontation et la confusion. Avec la disparition de l’autorité, de la morale et du respect, des phénomènes humains et sociaux étranges font surface. L’autorité censée réguler la vie et protéger le citoyen devient une structure qui réprime, combat et guerroie. Et de l’autre côté, un ennemi, censé être l’alternative, qui use de la même stratégie. Cette situation conduit à tolérer le vol, la violence et le crime.
Ainsi tous les dérapages, qu’ils viennent de l’intérieur ou de l’extérieur, sont possibles. Par conséquent, le rêve des Syriens de voir des colombes voler dans le ciel de Damas au lieu de roquettes est devenu mince.
Que peut faire le cinéma et l’art?
Il n’y a de place que pour la tuerie et la destruction. Témoigner peut-être, transcrire l’histoire et fixer la mémoire. Il est notre arme pacifique à moi. Il n’est pas un hasard qu’aujourd’hui à Damas, toutes les violences envers le citoyen sont tolérées et justifiées, alors que la caméra est interdite. Elle représente le même danger que les fusils de guerre.
Et le centre cinématographique syrien est actif ?
Bien sûr. Les structures officielles s’efforcent à donner une impression, et en vain, que la vie est normale. Les écoles, les universités et toutes les autres institutions ouvrent obligatoirement.
Entre 1980 - 1987 vous avez tourné AlManam (Prix du Festival International de programmes audiovisuels) durant lequel vous demandez aux réfugiés palestiniens de décrire leur rêve. Aujourd’hui, les Syriens sont dans une situation similaire. Quel est leur rêve ?
Le rêve des Syriens aujourd’hui n’est plus un rêve stratégique. Il est une résignation devant la dramatique situation actuelle. Ainsi, le souhait principal des Syriens reste et demeure la paix.
Après l’échec, les Syriens ne rêvent plus forcément d’un changement, mais d’une urgente reconstruction psychologique et sociale. L’espoir est mince. Ils se cherchent plus ailleurs qu’à l’intérieur. Mais je reste convaincu que si l’occasion, aussi faible soit-elle, leur est offerte, ils se relèveront.
Et votre rêve à vous, en tant que cinéaste ?
Il me reste ni rêve ni illusion, surtout suite à mon expérience avec la mort lors de mon coma causé par un accident de circulation grave.
A mon réveil, j’ai constaté que tous mes rêves se sont brisés. Je suis devenu très réaliste. Après vinrent les évènements qui ont réduit davantage mes espoirs et attentes à deux modestes projets évoqué précédemment : publier deux livres et réaliser mon film en préparation avant mon départ.
T. H.









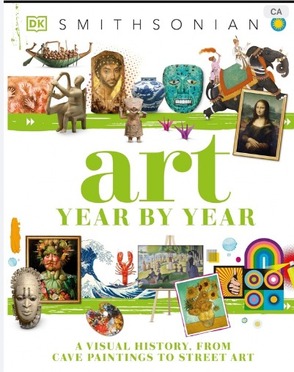




















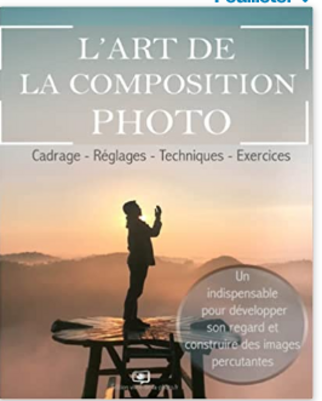







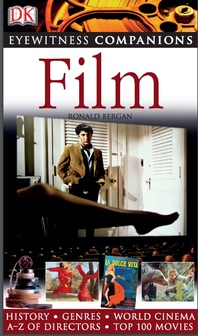





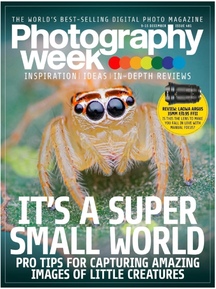



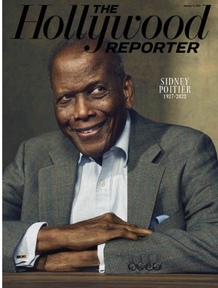















































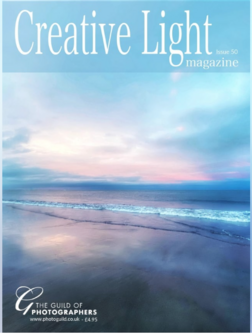

















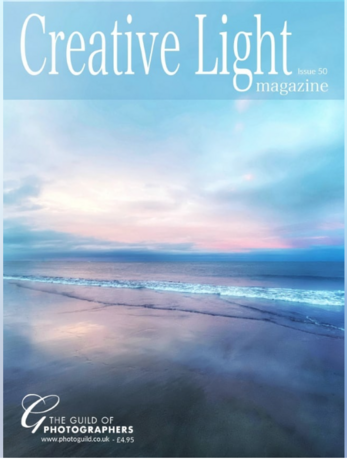


















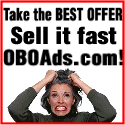
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot






 Facebook
Facebook  del.icio.us
del.icio.us Digg
Digg StumbleUpon
StumbleUpon 






