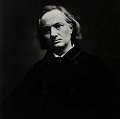-
Par hechache2 le 30 Août 2013 à 15:37
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 30 Août 2013 à 15:34
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 30 Août 2013 à 15:33
Le petit monde de Disdéri, par Sylvie Aubenas 




Un fonds d'atelier du second Empire
Alors que tant de fonds d'ateliers photographiques du XIXe siècle ont entièrement disparu, celui du photographe André Adolphe Eugène Disdéri (1819-1889), inventeur en 1854 du portrait au format carte-de-visite, fut sauvé de la destruction, de façon pour ainsi dire miraculeuse, par le général Rebora qui l'offrit à son ami Maurice Levert (1856-1944). Ce dernier, fils d'Alphonse Levert (préfet sous le Second Empire puis député du Pas-de-Calais), s'était trouvé contrarié dans sa vocation militaire par un malheureux accident qui lui avait fait perdre un œil. Sa fortune le lui permettant, il consacra donc sa vie à collectionner des armes et des uniformes de l'armée napoléonienne. En marge de cette activité, il cultivait sa nostalgie des fastes de l'Empire en servant de secrétaire particulier au prince Victor-Napoléon, prétendant bonapartiste de l'époque, et en rassemblant une bibliothèque et une importante collection de portraits photographiques sur les personnalités du Second Empire. On ignore dans quelles circonstances et à quelle date il se vit offrir les vestiges de l'atelier de Disdéri, une galerie de portraits sans égale pour lui puisque l'essentiel de l'activité du photographe se situe entre 1854 et 1870. Le fonds tel qu'il le recueillit est celui que Anne Mc Cauley a consulté à la fin de son étude sur Disdéri, et, sans aucun doute, exactement le même que celui qui fut proposé aux enchères par les descendants de Levert en 1995. Les négatifs (sur verre au collodion) ont disparu, mais on ignore si Levert les a négligés, détruits, ou s'ils avaient déjà disparu à l'époque incertaine où il recueillit les tirages.

Des planches de portraits
Ces tirages constituent la très grande partie de ce qui subsiste de l'activité de l'atelier. La particularité et le grand intérêt de ceux-ci tiennent à ce qu'ils se présentent sous forme de planches regroupant plusieurs portraits avant découpe. Le portrait carte-de-visite achevé, en effet, était vendu au client sous forme d'une petite image rectangulaire collée sur un carton au nom du photographe. Mais, au moment de la prise de vue, plusieurs portraits étaient juxtaposés sur Ie même négatif, constituant une mosaïque comparable à celle du Photomaton. Dans un même format de négatif, tous les cas de figure étaient possibles : un seul grand portrait, deux moyens, un moyen et quatre petits, six et jusqu'à huit petits (le cas le plus fréquent). II peut s'agir soit de la même image saisie plusieurs fois simultanément, soit de poses successives, sans compter, là encore, tous les cas intermédiaires.

Les registres d’atelier
Ces planches étaient conservées dans des registres, où elles étaient collées dans I'ordre des numéros de négatif (numéros inscrits à I'aide d'une pointe dans Ie collodion, pratique courante à I'époque). Elles étaient ainsi classées pour répondre à d'éventuelles demandes de retirage, puisqu'elles permettaient de visualiser Ies images avant d'en rechercher Ie négatif. Ainsi, Ie client choisissait la ou Ies images de la planche de portraits qu'il désirait commander. Parallèlement, il existait un registre commercial, ou plutôt un répertoire, non illustré, où les clients étaient inscrits par ordre chronologique à I'intérieur de chaque lettre de l'alphabet, selon I'initiale du nom de famille. Ce registre s'étend de septembre 1857 à février 1865 et contient environ cinquante mille références, soit le nom du client et la date de la prise de vue. II constitue avec cinq registres originaux, contenant plus de deux mille planches classées dans I'ordre des négatifs, les seuls vestiges intacts de I'atelier.

Des albums thématiques sur la société du second Empire
Les autres registres ont en effet été dépecés par Maurice Levert dans I'intention de constituer des albums thématiques sur la société du Second Empire. Sa profonde connaissance de ses membres, de ses arcanes, des alliances, des carrières dans I'aristocratie et la haute bourgeoisie mais aussi du monde des artistes, des danseurs, vedettes de I'Opéra ou des théâtres, du demi-monde, lui permirent de former des albums factices par sujets : quatre-vingt-onze albums (contenant plus de douze mille planches en tout), dont quarante consacrés au "monde", deux au "demi-monde", deux aux "gens de lettres", six à la "mode", six aux Russes, sept aux Anglais, deux aux "excentriques", etc. C'est ainsi que le fonds de I'atelier était rangé dans sa bibliothèque, ainsi qu'il a été conservé pendant près de cinquante ans après sa mort et ainsi qu'il a été dispersé à I'hôtel Drouot en 1995. Les lots adoptés pour la commodité de la vente étaient ces albums constitués par Levert, et n'avaient donc plus rien de commun avec le classement de I'atelier dans sa logique première et commerciale.Acquisition du fonds

Devant I'importance de la collection Levert pour I'histoire de la photographie (outre les clichés de Disdéri, elle contenait aussi des épreuves d'Olympe Aguado, de Gustave Le Gray, de Léon Crémière, etc.), les institutions françaises se sont mobilisées : la Bibliothèque nationale de France, le musée d'Orsay, le musée de I'Armée, le musée de Compiègne se sont entendus pour répartir, en fonction des spécificités des collections de chacun, les acquisitions qui seraient faites. II s'agissait de sauver un ensemble aussi significatif et cohérent que possible, tout en sachant que le tout ne pourrait être acquis, en raison des limites budgétaires.
Le département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France, dont la vocation est encyclopédique, devait s'attacher à sauvegarder la mémoire de I'activité de Disdéri dans son ensemble. Le registre de clientèle de 1857 à 1865, les cinq registres par ordre de négatifs (soit, je I'ai dit, plus de deux mille planches de huit) ainsi que ces quarante albums et deux autres consacrés aux "gens de lettres" furent donc la sélection préalable de la Bibliothèque nationale de France. A quoi s'ajoutaient deux caisses contenant des planches en vrac (environ douze mille, formant un lot unique) que Levert avait sans doute compté insérer dans ses albums après les avoir extraites des registres originaux, ou du moins recueillies avec I'ensemble du fonds. Peu attirant à première vue, mais d'une masse alléchante, ce lot n'avait pu être soumis qu'à un examen superficiel avant la vente. On a pu constater depuis avec satisfaction qu'il s'y trouve des portraits très variés, en particulier des exemples nombreux de ces portraits d'étrangers (président de Haïti, ambassadeurs japonais, noblesse italienne ou espagnole, familles régnantes, etc.) qui n'avaient pu être acquis par ailleurs. On peut affirmer que I'acquisition effectuée par la Bibliothèque nationale de France, au total quelque dix-neuf mille photographies, plus des trois quarts des planches mises en vente, et trente pour cent de la production totale de I'atelier, constitue bien un échantillon représentatif de I'activité de Disdéri.
Le musée d'Orsay, quant à lui, se portait acquéreur, en ce qui concerne Disdéri, des six albums de Russes, de six d'Anglais, de cinq sur la "mode" et quatre sur le "théâtre (divers)", soit un ensemble de trois mille planches environ. Si une partie du fonds mis en vente le 28 janvier 1995 est maintenant atomisée dans diverses collections publiques et privées, notamment outre-Atlantique, cette perte ne représente donc pas plus de quatre mille planches. L'ensemble acquis par les collections publiques françaises offre une vision sans angles morts de I'ensemble de I'œuvre (en portraits carte-de-visite) du photographe.
Le portrait carte-de-visite paraît une image banale, répandue, faite pour être distribuée largement. Néanmoins, beaucoup de ces images étaient totalement inconnues : pour ne citer qu'un cas, paradoxal, le fonds Disdéri a livré le visage, jusque-Ià ignoré, du célèbre critique photographique Ernest Lacan. Dans Ie domaine précis de I'iconographie des personnalités du Second Empire I'ensemble fournira des milliers d'illustrations inédites à tous les chercheurs et iconographes en quête de portraits.
Si L’étude d'Anne Mc Cauley et I'exposition "Identités : de Disdéri au Photomaton", présentée en 1985-1986 au Centre national de la photographie sous la direction de Michel Frizot, disaient déjà I'essentiel sur Disdéri et le portrait carte-de-visite ce fonds énorme, lorsqu'il aura fait I'objet d'une étude approfondie, permettra d'affiner I'analyse et nous apportera une infinité de précisions sur la pratique du portrait. L'exploitation synthétique, sérielle, de ces portraits, tous identifiés et datés, contribuera à étayer les hypothèses déjà avancées et, sans doute, à établir une histoire et une sociologie plus fines et plus exactes de cette pratique.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 30 Août 2013 à 15:32
Photographe et modèle
 On dit "faire un tableau" mais "prendre une photo" ;
On dit "faire un tableau" mais "prendre une photo" ;
la relation du photographe à son modèle est-elle une relation de pouvoir ?

Contrairement à une idée reçue, le photographe n’est jamais un sujet désincarné face à un objet maintenu à distance.

Algérienne, Marc Garanger
Jeune femme blonde adossée à un téléviseur,Jean RaultCeci est particulièrement vrai pour le portrait, puisqu’il repose dans sa possibilité même sur une interaction entre le photographe et le portraituré. Il est vrai que cette interaction n’est pas toujours égalitaire et il arrive que le consentement du portraituré soit extorqué ; il suffit de penser aux photos ethnographiques du XIXe siècle ou au portrait judiciaire. Mais lorsque c’est le cas, l’image, loin de masquer les relations de pouvoir qui ont permis sa naissance, les exhibe malgré elle, que ce soit à travers le regard du portraituré (pour s’en rendre compte, il suffit de comparer les portraits d’Indiens réalisés vers 1885 par David F. Barry dans une perspective manifestement "ethniciste", à ceux, plus tardifs et plus respectueux de l’identité des portraiturés, réalisés par Curtis), à travers sa posture corporelle, voire à travers l’organisation formelle de l’image (qu’on pense aux conventions formelles des portraits anthropométriques). Ceci tient au fait que, dans la fabrique du portrait photographique, on n’a jamais un seul sujet humain mais toujours deux : il n’y a pas un regard unique mais deux regards qui s’éprouvent réciproquement. Il en est ainsi même lorsque le regard du portraituré s’absente : sauf formalisme ou esthétisme, le corps du portraituré lui aussi éprouve le regard du photographe, voire le dénonce. Il faut donc compléter ce qui a été dit plus haut : s’il est vrai que le portraituré ne peut atteindre sa propre identité qu’en s’exposant à la médiation (toujours risquée) du regard du photographe, celui-ci à son tour s’expose à travers la manière dont il prend (ou ne prend pas) en charge cette situation de médiation. Pour le dire autrement : le portrait photographique présuppose toujours un pacte dont l’enjeu est la rencontre et la négociation de deux désirs. Or il n’y a aucune raison pour que le désir d’œuvre du photographe et le désir d’image du portraituré coïncident : de ce fait, le portrait rencontre toujours sa vérité dans la manière dont il négocie la tension entre des regards qui se croisent et qui s’éprouvent mutuellement.

Dora Maar, Rogi AndréDans la mesure où le photographe, plus radicalement que le peintre, doit toujours composer – et ce au sens littéral du terme – avec le portraituré, le portrait photographique ne saurait être qu’un genre difficile et risqué. Il repose en effet sur un équilibre instable qui peut à tout moment être rompu : soit le portraituré est escamoté par le photographe qui cherche à imposer la souveraineté de sa volonté de puissance par un geste purement formel ou esthétisant ; soit le portraituré se sert du photographe pour accéder à une image narcissique de lui-même, quitte à se faire ainsi le faussaire de sa propre vie.Jean-Marie Schaeffer
Extrait du catalogue de l’exposition
Portraits, singulier pluriel
Edition Mazan/Bibliothèque nationale de France – 1997
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 30 Août 2013 à 15:31
L'évanouissement de la ressemblance 




Jeux de miroir
Au-delà des thèmes évidents de la découverte de soi par l'image spéculaire, de Narcisse, du double, l'Autoportrait au miroir de Dieter Appelt met en scène le mécanisme de la perception et la nature optique de la photographie. La théorie de la palpation par le regard chez les Anciens s’appuyait sur l'hypothèse d'une émission par l’œil d’un cône de rayons sensibles à la couleur et à la lumière, les "sensibles propres de la vue". Le flux visuel participait de la nature de l’Esprit, du pneuma. Le regard capable de palper les objets les atteignait bien au-delà des limites physiques du corps. Tout le dispositif mis en œuvre par Dieter Appelt matérialise non seulement l'imprégnation des instances percevantes par l’objet perçu, mais aussi la formation de l’image rétinienne et de l’image mentale. L’interposition de son corps entre l’objectif photographique tenant la place du voyant et l’image produite (la sienne dans le miroir) rappelle que l’essence n’est pas assimilable à la représentation. Un véritable battement se produit entre la réalité et l’imitation, la valeur visuelle et la valeur tactile. Le pneuma, vapeur sortie de la bouche et couvrant le miroir, pourrait entrer dans la symbolique de l’effacement. Il paraît au contraire tentative de contact du sujet avec lui-même, perception rendue possible de l’en-dehors de soi, par ce souffle venu de l’en-dedans. Mais c’est le reflet, l'objet perçu qui est touché, non le sujet. La double médiation, du miroir qui reflète et du négatif qui s’imprègne, mène l’empreinte photographique à ne fixer que le reflet d’une apparence. Le réel visage, celui qui se reflète, n'est pas atteint… L’image en miroir présente toujours un aspect inversé de nous-même. La vision du visage photographié ne nous donne pas l’apparence, la ressemblance qui nous ressemble. Elle crée un suspens, creuse une distance, engendre l’étrangeté.


Fragmentation : aux limites de l’identification
Le protocole mis au point par Alphonse Bertillon comprenait non seulement un descriptif complet du visage face-profil, mais également une découpe des détails organisée selon une logique anatomique et visuelle, certains fragments ayant une valeur absolue d’identification. Etrange métonymie, les contours et les plis du pavillon auditif représentaient infailliblement la quintessence de l'individu, susceptible d’être remarqué jusque dans ses fragments les plus minces.
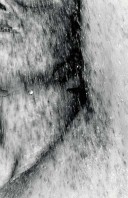


La photographie prend en compte cette opération et la retourne en question esthétique et ontologique. Si la photographie reste bien, tout du long, une photographie, si sa valeur indiciaire demeure inentamée, jusqu’à quel point le modèle pourra-t-il être fragmenté ? Et quelle sorte de fragmentation sera-t-il possible d’accomplir ? Les travaux, aussi bien de Jean-Claude Bélégou et Yves Trémorin que de Rossella Bellusci ou Maria Theresa Litschauer, choisissent des découpes apparemment aléatoires, non significatives : ce n’est plus le visage qui est en question, ce sont les traits, les marques, les rides, la matière, l'ombre, la lumière. Il n’est plus reconnaissable, pourtant il n’a jamais été atteint d’aussi près que dans cette proximité illisible. Il nous donne une totalité, en quelques centimètres carrés agrandis à la dimension d’un paysage. "C'est une carte géologique en relief. Et malgré tout, ce monde lunaire m'est familier. Je ne peux pas dire que j'en reconnaisse les détails, mais l'ensemble me fait une impression de déjà vu." Non seulement il n’est plus identifiable que comme déjà vu, mais la forme a disparu dans le grain du papier et la trace des sels d’argent.

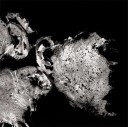


Dans la série Stigmates, Marianne Grimont tente autrement l’accès à la similitude. La matière cosmétique dont elle enduit son visage et qu’elle dépose et photographie ensuite se constitue à la fois en écorchement et en "vera eikon", véritable image, issue du même principe que le Mandylion d’Edesse ou le voile de Véronique, empreintes achéiropoïètes du visage du Christ. Le dispositif n’est pas optique, mais concrètement tactile. L’idéalisation du modèle, la distance, sont évacuées : cette véritable image, l’icône exemplaire, est une surface incertaine, grumeleuse, homothétique d’une face rendue méconnaissable par son absolue exactitude, une fois la troisième dimension disparue. La perception de soi-même n'est pas possible dans la proximité. Le visage disparaît, pire, se décompose, à être vu de si près.




La violence de la représentation
Les œuvres d'Arnulf Rainer ou de Henry Lewis rendent tangible la violence de la représentation. La biffure, le pigment recouvrent le visage, non pas méconnaissable, mais inconnaissable. Chez Rainer, la surface de la photographie se substitue à la peau pour recevoir tous les outrages de l'iconoclasme. L'image, autoportrait ou photographie du masque mortuaire d'un personnage historique, est sabrée de violentes ratures, recouverte de pigments qui ne laissent plus entrevoir que quelques fragments du visage sous-jacent, flottant entre surface et profondeur. Le portrait ne se situe plus dans la représentation mais dans la trace, l'indice d'une action violente. L'outrage est double puisque le doute plane à la fois sur la photographie elle-même et sur la valeur de représentation de l'image qui, semblable à l’original, s’identifie à lui. Cette adéquation a pour évidente conséquence que l’atteinte à l’image, loin de se borner à un aspect symbolique, se veut concrète atteinte au modèle, ainsi qu’en témoignent les manifestations d’hostilité aux effigies religieuses et politiques.
Henry Lewis ne s'attaque nullement à l'image. Son rôle est de témoigner (non de prouver quoi que ce soit, il faut le préciser), comme elle témoignait des œuvres des actionnistes. Le propos est loin d'être le même.
La photographie de par sa valeur d'indice n'a pas, contrairement à la peinture, vocation à ressembler. La similitude y est massive, irrémédiable. Le passage par la reconstruction ne peut s'y produire. Henry Lewis le réalise en amont, avant la prise de vue, torturant son visage afin de voir à quoi il peut ressembler. Le visage qui sort de la cabine du photomaton n'est jamais le nôtre.
Les affiches lacérées, la toile déchirée, photographiées par William Klein et Vilem Kriz mettent en évidence la nécessaire relation des composants pour garantir une forme. Photographier l'usure, la destruction par un acte créateur lucidement revendiqué procède d'un mouvement tout à fait contraire de l'iconoclasme : le constat visuel d'une fatigue et d’un évanouissement de la ressemblance.



 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien





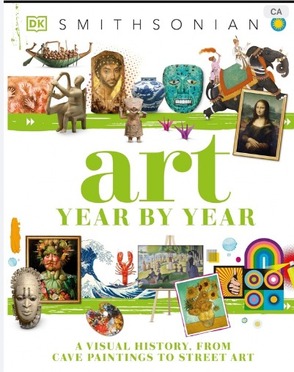




















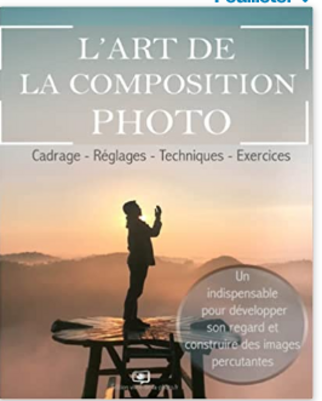







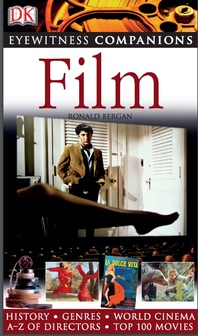





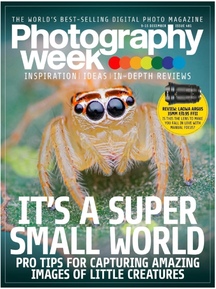



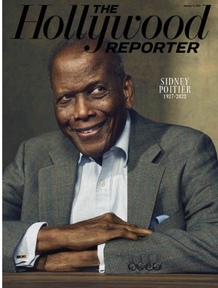








































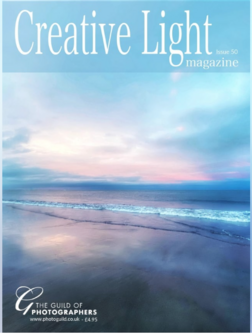

















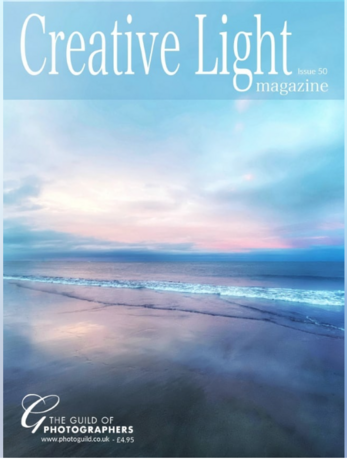


















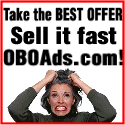
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot