-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:38
El Gusto

Un film de Sanifez Bousbia
Un documentaire que « c'était pas la peine ».
Article de Emmanuel Hoblingre

Synthèse de traditions musicales berbère, andalouse et religieuse, le chaâbi est né au milieu des années 1920, dans la casbah d'Alger. Influent et populaire, ce courant musical disparaît avec la guerre d'indépendance : les cafés ferment, les musiciens se dispersent, certains contraints de quitter l'Algérie pour la métropole. Cinquante ans après, la réalisatrice Safinez Bousbia tombe sous le charme de cette musique et de son histoire : elle décide d'organiser les retrouvailles d'anciens camarades. Ensemble, ils forment l'orchestre El Gusto.
Avoir un bon sujet ne suffit pas ; encore faut-il savoir le traiter. Un groupe de musiciens qui se recompose après des décennies ? Wim Wenders (Buena Vista social Club, évidemment) mais aussi Miguel Kohan (le très beau Café de los maestros) l'ont traité avec succès à l'écran. Chacun à leur manière, ces réalisateurs ont su capter une époque révolue et les outrages du temps. Une douce nostalgie nous emportait : nous suivions des destins incroyables, tendions l'oreille, curieux de chaque anecdote et de la moindre confidence. Naturellement, la musique ne s'en trouvait que bonifiée. Hélas, dans El Gusto, ce n'est ni le chaâbi ni ses interprètes qui sont à l'honneur mais la réalisatrice, qui squatte le champ et étale sa vie plutôt que celle de ces musiciens. C'est que le film repose sur un postulat de départ bancal, le choix d'un angle peu approprié : il s'agit de raconter une histoire à travers l'expérience personnelle de cette jeune réalisatrice. Une agaçante voix-off raconte ainsi la genèse du projet et les difficultés rencontrées pour finalement aboutir aux retrouvailles. Celles-ci n'interviennent que dans le dernier quart du film, tant et si bien que le documentaire s'achève donc là où il aurait dû commencer.
A ce fondamental problème de construction du récit vient s'ajouter la faiblesse généralisée du traitement. La caméra n'est jamais là où il le faudrait, les séquences musicales sont trop rares et filmées sans génie ; quant aux récurrentes vues aériennes de la casbah, elles sont un non-sens au milieu de ce film intimiste. Il y a enfin cette sensation désagréable que tout cela est un rien scénarisé, tourné et retourné. Pour un documentaire, cette impression tenace de construction est gênante.
Au final, le film ne trouve pas sa voie, suivant beaucoup trop de personnages et de pistes, hésitant entre une chronique mélancolique d'Alger, un cours du soir accéléré sur la guerre l'Algérie et un reportage touristique sur la casbah. On se perd un peu et on s'ennuie ferme. La musique dans tout ça ? On ne l'entend guère, noyée au milieu d' interminables interviews de vieillards qui radotent que le bon temps est révolu (franchement vain). Et lorsque enfin les musiciens se retrouvent, ce qui devait arriver... n'arrive pas. Ils ne se disent rien ou presque, se toisent autour d'une bière, sans plus. A se demander s'ils se sont déjà croisés dans une autre vie ! Là encore, on se dit que la réalisatrice, plutôt que d'occuper le cadre, aurait mieux fait de rester derrière la caméra, à l'affût de propos intéressants et d'images percutantes.
En voulant faire connaître et partager sa passion pour le chaâbi,Safinez Bousbia rend au final un bien mauvais service à la musique qu'elle prétendait promouvoir. Trouvé dans un bac, adossé à un CD d'El Gusto, un DVD bonus incluant ce documentaire mal fichu, ce film serait pris pour ce qu'il est : une laborieuse tentative d'expliciter les racines de la musique chaâbi, un film promotionnel pour vendre un groupe de papis. Pas de quoi s'énerver. En revanche, à une heure où manquent les écrans de cinéma pour faire connaître de jeunes et talentueux réalisateurs, la sortie en salles d'un tel objet ne peut qu'agacer. D'autant que la réalisatrice, également productrice du groupe, conclut son film en rappelant qu'une tournée mondiale est en cours... Ces papis ont beau avoir l'air sympathiques et leur musique pas désagréable, ce documentaire l'est beaucoup moins. Au sortir de la salle, le sentiment franchement désagréable d'avoir payé sa place pour visionner une mauvaise pub. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:35
Délice Paloma
« Délice Paloma »… Voilà un titre aussi alléchant qu’un mystère, aussi musical qu’un refrain et surtout, aussi inoubliable qu’un film de Nadir Moknèche ! Celui que l’on surnomme « l’Almodovar algérien » depuis Le Harem de Madame Osmane (avec Carman Maura) et Viva Laldgérie, poursuit avec Délice Paloma, une œuvre moderne et à contre-courant des idées reçues sur l’Algérie féminine. Ce troisième long métrage, nouveau portrait tragi-comique d’un peuple en pleine ébullition, confirme le talent d’un cinéaste amoureux.
Et c’est à travers les traits de son égérie Biyouna que Nadir Moknèche dépeint cette fois l’Algérie. « Madame Aldgéria » comme se fait appeler son personnage, devient l’allégorie délicieuse de tout un peuple. Déterminée, malicieuse, lucide et cynique, presque désenchantée, elle dirige une agence bien particulière, à son image. Du simple service de détective privé à celui de « loueuse de charme », rien n’effraie cette femme d’affaires au cœur large mais pour qui la fin justifie bien trop souvent les moyens. Moyens qui la conduisent finalement à passer trois années de sa vie en prison. Le film s’ouvre sur justement sur sa sortie. Seules deux proches sont venues accueillir Zineb (qui n’est plus Madame Aldjéria). Sa sœur, et son ancienne « collaboratrice » Shéhérazade (magnifique Nadia Kaci, autre muse du réalisateur) qui, désormais « clean », a elle aussi abandonné son pseudonyme attrayant pour retrouver son identité et par la même, une existence plus « conforme » aux attentes de la société. Elle s’est mariée, porte le voile et est devenue mère de deux enfants.
La subtilité du film s’exerce dans le traitement de son histoire. Au lieu d’adopter une narration purement chronologique, Nadir Moknèche opte pour l’utilisation constante d’allers-retours entre le présent (son retour de prison) et le passé (trois ans auparavant, alors qu’elle traitait son ultime affaire). Le récit de l’héroïne diffusé en voix-off, permet à celle-ci un retour critique sur son histoire, et bien sûr sur elle-même. Si le procédé a peut-être parfois trop tendance à tenir la main du spectateur dans le ressenti du personnage, la mise en scène, elle, reste fluide et bien pensée. Autour de Madame Aldjéria la tension monte crescendo. Ce qui pourrait sembler, de prime abord, n’être qu’une comédie féminine légère en plein le centre d’Alger, se révèle rapidement plus sombre. Le réalisateur entrouvre des milliers de portes habituellement closes. De la condition de la femme en Algérie, au problème de l’économie souterraine en passant par le terrorisme des années 90, c’est une fresque du pays tout entier qui surgit sous les yeux du spectateur.
Délice Paloma laisse évidemment la part belle aux femmes. Pléthore de tempéraments féminins défilent à l’écran. Madame Aldjéria bien sûr, en chef d’orchestre de la bande, fait se croiser les destins de Mina, sa sœur sourde-muette qui ne peut que suivre le mouvement, Shéhérazade, devenue fidèle prostituée de luxe, et Rachida rebaptisée Paloma, et qui apprend à marcher sur ces traces. Le film confronte différents visages de l’Algérie d’aujourd’hui. Celui des valeurs traditionnelles comme la famille et la solidarité mais aussi celui de la dureté, de la souffrance et des désillusions. C’est pourquoi le rôle de Paloma se détache tellement. C’est l’île de pureté du film. Tous les espoirs secrets du peuple algérien sont portés par cette jeune femme à l’innocence exacerbée, qui porte le nom d’un dessert exotique à la fleur de Jasmin et qui fait surtout directement référence à la colombe (« palumba » en latin) symbole suprême de la beauté et de la pureté. Quant à la masculinité, si elle n’est pas autant représentée dans l’histoire, elle n’en est pas pour autant silencieuse. Les questions du partage, voire de la perte de l’autorité, du désir féminin, ou encore de l’homosexualité ne sont pas ignorées.
Au final Nadir Moknèche réussit avec ce troisième long métrage, à imposer son propre style. En partant d’une histoire de femmes, il parvient à prendre la température de tout un pays sans jamais s’égarer. Délice Paloma est d’un comique amer et inversement.
« Vous connaissez quelqu’un sur Terre qui aime les Algériens ? », l’une des dernières phrases prononcées par l’allégorique Madame Aldjéria étonne tout d’abord, puis prend tout son sens. Le cinéma de Nadir Moknèche est moins un hommage aux femmes qu’un hommage à l’Algérie, son histoire et son avenir. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:34
Dernier maquis

Un film de Rabah Ameur-Zaïmeche
Avec Rabah Ameur-Zaïmeche, Abel Jafri, Christian Milia-Darmezin
Beau virage dans l'œuvre de plus en plus radicale de Rabah Ameur-Zaïmeche, jeune cinéaste soucieux de la parole (et du geste) nue(s).
Article de Sidy Sakho

Succédant à Wesh Wesh, qu'est-ce qui passe ? (2002), film « de banlieue » suivant les pas de Kamel, jeune homme d'origine algérienne victime de la double peine, et Bled Number One (2006), accompagnant ce même Kamel dans son retour « forcé » au pays, Dernier marquis a déjà ceci de marquant qu'il prend un virage radical dans un parcours jusqu'ici aisément lisible . Ce n'est plus cette fois le seul chemin d'un certain individu, d'un « personnage principal » bien identifiable qui installe la fiction, détache une action d'un relief « documentaire » (La Cité ; Le Paysage ; Le Garage), mais le permanent partage des forces induit par l'idée même du « groupe ». Le cinéaste-acteur incarne ici Mao, chef d'une entreprise de réparation de palettes reliée à un garage de poids-lourds. Autour de lui, une poignée d'hommes, travailleurs immigrés issus pour la plupart du Maghreb et d'Afrique noire. Très vite et de plus en plus précisément se dessinera en ce lieu presque unique (« Entre les palettes » pourrait être un titre alternatif), l'horizon d'une discordance, d'une inévitable tension inhérente à cette proximité des statuts. Seul contre/devant/face à ses employés, le patron se verra amené à mêler à son autorité une prudence, une écoute indispensables à la fluide continuité du travail. Ne fait aucun doute, dès la lancée du jeu, que de la vigilance, de la bonne réception d'une requête, une demande, même infimes, dépendra l'équilibre d'un bien instable corpus.

Comme rarement dans le cinéma français, Dernier Maquis représente la réalité de ce qui trop souvent relève d'une forme de « fantasme », de projection vague guidée par une pardonnable méconnaissance : le lien permanent, pour tous ces hommes, entre le travail et la religion. Nous est ainsi offerte, in extenso, une longue séquence de prière musulmane regroupant les travailleurs dans une petite mosquée initiée par Mao, à dessein sans doute de leur assurer, au-delà de leur activité quotidienne, un repère commun – qui s'avèrera pourtant être au final leur premier véritable point de discordance. Se lit dans cette approche frontale, « quasi-documentaire » (bien que tout ici demeure de pure fiction), ce corps à corps avec la réalité de son sujet, une nécessité, de la part de RAZ, de relier à tout instant l'avancée linéaire de son récit, le découpage apaisé de ses séquences à une matière brute ne cessant de lui échapper un peu. A défaut de pouvoir tout saisir de ce qui constitue la vie de ce peuple sous-représenté, assez invisible sur les écrans, pourquoi ne pas s'essayer, modestement, à une rencontre, une immersion subtile dans son paysage rituel, négocier, avec la distance comme la proximité requises dans pareil procédé, une possible restitution de ce réel ? Le jeu en vaut d'autant plus la chandelle que bonne part des acteurs de cette restitution sont directement tirés de ce réel ( la troupe de « vrais » acteurs du cinéaste, constituant l'équipe des « mécaniciens », est associée à de véritables ouvriers, jouant pour ainsi dire leur propre rôle de « manœuvres »). Résulte de l'expérience un trouble et efficace mélange de permanente clarté du trait, des mots, et de confusion, de mise en doute de la dimension totalement « fictive » de certaines situations.

Ne manqueront, ne manquent déjà pas d'être avancées moult tentatives (évidemment toujours pertinentes et bienvenues, quoique un peu attendues) d'identification de Dernier Maquis comme film « politique », plus précisément manifeste « marxiste » à la transparence de jeu sensiblement « brechtienne ». Comment, en même temps, ne pas être pris, à la vision de pareille mise en scène du mouvement de contestation et de revendication de droits d'un groupe de travailleurs abusés par leur employeur, de ce réflexe d'apparentement de l'œuvre à une certaine ligne, un certainidéal ? En effet, ce film est politique jusqu'au bout des ongles, dans le sens littéral d'une confrontation (essentiellement verbale, finalement physique) des parties mises en présence. Dans le sens poétique de la volontairehypervisibilité d'une couleur : le rouge, celui recouvrant les palettes manipulées et regroupées à longueur de journée. Mais l'évidence du positionnement politique du film ne doit pas être un frein au suivi d'une passionnante installation de cinéaste dans l'organisation d'un regard précis sur le monde. Comme dans le dernier opus de Laurent Cantet, tonifié par l'entremise d'une vertigineuse proposition dialectique autour de l'organisation et de la formulation d'une parole, d'un raisonnement tenable face à l'altérité, déborde ici la richesse monstre des langages. Entre interrogations franches et fourberie, menaces à ciel ouvert et négociations semi-diplomatiques, la direction esthétique (d'ascendance certes théâtrale) du cinéma de Rabah Ameur-Zaïmeche est de celles qui poussent à un travail sur l'attention, le guet, le requestionnement de tout édifice. S'y dévoile, l'air de rien et souvent pour le meilleur, une forme plus diffuse (mais toute aussi saisissante) de politique : celle d'un jeune auteur en pleine action.

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:28
Cartouches gauloises

Un film de Mehdi Charef
Avec Didier Bourguignon, Assia Brahmi, Tolga Cayir, Betty Krestinsky, Mohamed Faouzi Ali Cherif, Mohamed Dine Elhannani, Thomas Millet, Mohammed El Amine Medjahri
Article de Christophe Chemin

Cartouches Gauloises. Un titre qui introduit les notions d’Histoire et de mémoire. Un titre qui cingle comme une rafale de balles ôtant la vie des algériens pris sous le feu et la folie meurtrière des soldats français d’Algérie. Le pays est scindé en deux. Cette scission permet au réalisateur d’introduire dans son film deux idées importantes : la frontière et le trajet, la quête. Le déséquilibre que produit la frontière provient des privilèges dont jouissent les Français et le marasme que subissent les Algériens. Tout ce qui est à cheval sur cette démarcation, sur cette zone d’entre deux agit comme un réceptacle : les enfants. La bande de copains, qui se réduit au fur et à mesure de l’exode des expatriés français d’Algérie, permet de cristalliser l’amour et la haine enfouies dans le cœur des Français envers l’Algérie et ses habitants.
Nico, l’ami d’Ali, dévoué et vexant, récuse toute idée d’abjection face à l’autre. Le film ne se construit pas par oppositions mais par contacts. Le contact des contraires (la beauté de l’arrière pays algérien avec la mort) mais aussi des similitudes (l’amour des Français et des Algériens pour l’Algérie). Sans cela, Gino ne prononcerait pas devant Ali la phrase douce-amère qui lui brise le cœur avant de partir d’Algérie : « Tu irais dans un pays où tu n’as pas de copains ? », le chef de gare ne prononcerait pas ces terribles paroles : « Ne nous oubliez pas petit… Il n’y a que vous qui nous avez connus. Dorénavant, on n’est plus rien… » et Rachel ne profèrerait pas une telle demande : « Je préfère mourir de la main des Arabes que d’être humiliée, là-bas, en France… »
Fort justement, le réalisateur algérien, qui a vécu la Guerre d’Algérie, ne délite pas son film dans un manichéisme béat et anodin. Son film est une œuvre puissante due aux souvenirs que Medhi Charef met en scène pour conjurer ses vieux démons. L’authenticité du film prend à la gorge le spectateur pour ne plus le lâcher. Seul le dernier plan du film, Ali courant vers le lointain, criant « Papa ! Papa ! », permet de prononcer le vœu le plus cher des algériens, leur indépendance, leur liberté, et ouvre l’espace filmique dans lequel le spectateur, ému comme à ses plus belles heures de cinéphile, court au côté d’Ali en larmes comme épris d’une identification forte avec l’enfant, le cœur léger. Cette ouverture permet à la tension de s’évacuer en même temps que l’enfant court vers le fantôme de son père. La subtilité de ce choix permet de comprendre que la Guerre d’Algérie n’est utilisée qu’en toile de fond au film. Quand la Guerre d’Algérie est montrée, l’horreur inévitable de la guerre surgit. Les dialogues violents allant de pair avec la régression animale et le formatage barbare dont souffrent et dans lequel s’isolent aveuglément les soldats français : « Couvre feu ! Au pieux ! » Deux balles dans la tête… les vendeurs de pastèques meurent dans la rue d’un village algérien sous les yeux d’Ali. Souvent, les plans exploitant la violence brute des affrontements sont filmés frontalement. La caméra fixe, désigne froidement. La beauté du plan rendant d’autant plus glaciale la révélation épouvantable du combat pour un pays. Le portrait de la femme se faisant tirer dessus et qui meurt à travers le trou d’un mur est remarquable et saisissant. Le coup de feu, et tous les autres tirés dans le film, viennent déchirer et surprendre, de par leur soudaineté, un public conquis par le film.
Cette guerre est traitée avec justesse par Medhi Charef en déposant dans son film une structure maintes fois reprises mais ici formidablement exploitée dans les films de guerre : le double mouvement qui consiste pour les résistants (les Algériens) à débuter d’un extérieur pour aller vers un intérieur. Puis, le mouvement des agresseurs, de l’intérieur vers un extérieur bouté hors de ses bases à cause de la défaite. La double trajectoire du film, un mouvement centripète et un mouvement centrifuge coïncident logiquement et narrativement avec le renversement des forces dans l’affrontement entre Algériens et Français. Le plan de Rachel arrosant ses fleurs, tout en étant surcadré, de chez elle et non plus dans son jardin en est le symbole. La conquête du sol trouve une douce ironie, lorsqu’un harki s’empare de la cabane des jeunes enfants. La question de l’habitat est traitée de manière subtile et intelligente par Medhi Charef. D’ailleurs, puisque tout est lié, le drapeau de l’Algérie se remet à flotter fièrement. Il est le contrepoint héroïque et pathétique de la statue de Marianne qui sera détruite par une explosion.
Le film est une œuvre complète, intelligente, talentueuse, dense et subtile. Medhi Charef jongle avec une dextérité époustouflante avec tous les aspects de la guerre d’Algérie (l’horreur, l’ironie, l’humour parfois, la tendresse souvent, l’agressivité…) sans déséquilibrer son film. Le film de Medhi Charef est purement et simplement un chef d’œuvre ! votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:24
Bled number one

Un film de Rabah Ameur-Zaïmeche
Avec Rabah Ameur-Zaïmeche, Meryem Serbah, Abel Jafri
Article de Samir Ardjoum

Un jeune algérien revient au pays. Curieux, solitaire, il parcourt les allées de son village natal en espérant retrouver de l’espoir. La chute sera mortelle.
Le plan séquence qui ouvre le second film de Rabah Ameur-Zaimeche est hypnotique. Une caméra qui pénètre dans un village isolé, des badauds curieux de découvrir cet étranger, un soleil de plomb qui heurte la sensibilité de ces âmes égarées et le spectateur avide d’en savoir plus. Tout est dit dans cette séquence, le cinéaste filme ce qu’il découvre et son film sera placé sous le signe de la curiosité.
Deux étapes, deux histoires, deux personnages viennent hanter ce film.
Il y a d’abord Kamel. Il revient de France. Le mot « expulsion » ne sera jamais prononcé. L’Algérie est la terre ensanglantée de ces origines et il n’est en pas peu fier. Les années de guerre civile sont encore dans les mémoires. Les esprits du terrorisme sont des derviches tourneurs qui embrasent les plaines de ce Far-West désertique. Kamel le devine, le ressent mais n’en souffle pas un mot. Les traditions se découvrent devant lui, les relents amoureux se dévoilent sous son regard discret et la folie des corps se matérialise sans crier gare.
Cet homme aux deux statuts (étranger et autochtone) promène sa solitude dans les recoins de ce village qu’il ne reconnaît plus. Fardeau pour les uns (incompréhension et rejet des villageois), accalmie pour les autres (Louisa, sa cousine belle et aimante), Kamel glisse quelques regards vers des territoires perdus (L’Algérie de son enfance), des zones dangereuses (l’intégrisme religieux), des rites complexes (les traditions familiales). L’Algérie dans son immense contradiction lui offre un cadeau empoisonné, son microcosme effrayant. Kamel se résigne à l’accepter.
Puis Louisa, qui veut faire de la chanson son métier, rejetée par un mari bureaucrate, ignoble et arriviste. Elle a tout perdu, son fils, sa dignité et sa famille. Elle ne peut qu’errer, emportant sa folie destructrice dans ses bras, fuyant cette société lourde et aveugle. On la retrouve à Constantine dans un hôpital psychiatrique (le même qui servit de décor à Malik Bensmaïl pour Aliénations). Elle respire de nouveau, défait le nœud de ses cheveux, pleure beaucoup et renaît. La musique, passion interdite, l’emmène vers une promenade solitaire (très belle séquence de concert).
Sociologue de formation, Ameur-Zaimeche plante un décor qui lui permet de découper au scalpel toute une géographie humaine qu’il redécouvre en la filmant. Vérité de l’instant présent, vérité d’un cinéma que l’on peut contempler, caresser et s’approprier. Passeport pour un état des lieux, possibilité infinie de se faire une idée sur ces représentations, liberté de mouvement. La parole cède la place à l’imaginaire. Très peu de discours, des voix, des regards, le vent qui se lève, balayant les rues poussiéreuses et Kamel, corps malade qui ne peut contenir sa folie, sa colère et qui doit partir. Le droit que propose Ameur-Zaimeche, c’est de réfléchir sur ce que l’on voit. Dessein noble et courtois car humaniste.
Ameur-Zaimeche compose un personnage qui se tient à l’écart de ces rites, observant silencieusement un environnement dégradant qui se borne à rester sur ses positions féodales. D’où une violence dissipée mais qui peut exploser à tout moment. L’auteur filme ce déséquilibre avec beaucoup de lucidité et de respect. Les quelques séquences du quotidien villageois sont traitées sous un aspect typiquement documentariste. Sociologie des corps, réinventant une démographie qui lui permettrait d’élargir son champ de vision, Ameur-Zaimeche filme une Algérie représentée dans toute sa splendeur (alchimie parfaite entre la chaleur humaine et la contemplation naturelle) et dans sa médiocrité (répudiation de la femme, injustice sociale et intégrisme ambiant). Le cinéaste conclut son film sur l’agressivité qui pollue l’air algérien amenant ses propres enfants à quitter définitivement leur terre pour un Eldorado utopique.
Contrairement à ses confrères coléreux qui scrutent l’Algérie avec beaucoup trop de démagogie (Al Manara de Belkacem Hadjadj ou L’Autre monde de Merzak Allouache), Ameur-Zaïmeche laisse parler le silence. En parfait cinéaste, il oriente son road-movie vers des sentiers perdus ou l’onirisme a posé ses armes. Véritable terre d’accueil, son film nous entraîne vers des images que l’on croyait perdu à tout jamais (le rituel du taureau égorgé), vers une réflexion subtile (jamais le mot terrorisme est exprimé) et vers un érotisme romantique (les scènes de plages).
Film libre et bagarreur, Bled Number One est une expérience sensorielle qu’il faut revoir une seconde fois pour mieux cerner la détresse d’un pays en mal d’identification, en mal de cinéma ! votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien





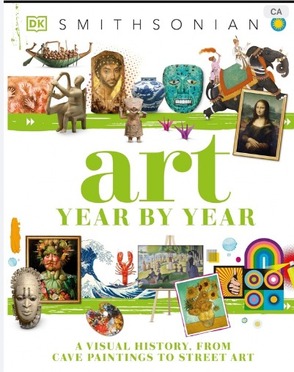




















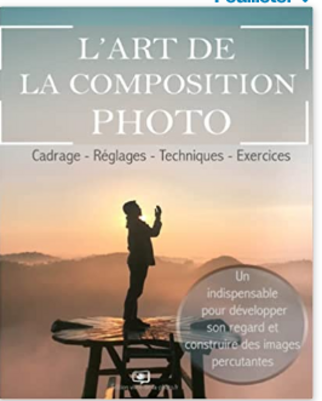







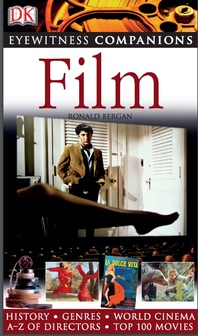





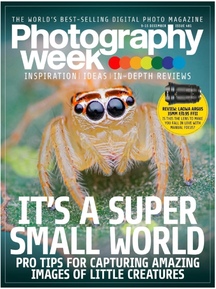



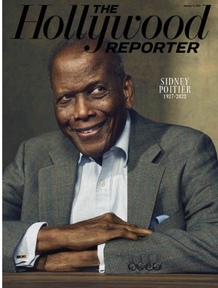








































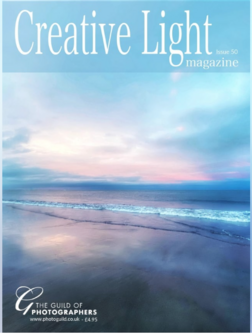

















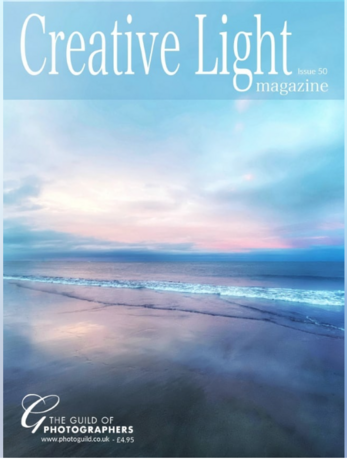


















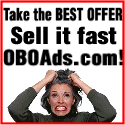
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot










