-
Par hechache2 le 6 Septembre 2013 à 02:33
BLUE JASMINE (2013)
Woody Allen
LA DAME EN BLEU
PAR MATHIEU LI-GOYETTEBlue Jasmine est un douloureux souvenir qui prend vie par le biais de la maladie, une réminiscence animée par le choc de la névrose et entretenue par cette nostalgie d'un bel autrefois. On y flotte aux côtés de Cate Blanchett qui, elle, s'égare dans les bas quartiers de San Fransico (au présent) ou de New York (au passé). Elle en détresse, nous en contrôle, c'est ainsi que fonctionne toute la charge dramatique de Blue Jasmine à l'image des autres grands portraits de femmes de l'auteur (Hannah and Her Sisters, Another Woman, Alice). Le retour de Woody Allenaux États-Unis après To Rome With Love le montre à l’affût des grandes plaques tectoniques économiques. Pas de culture comme dans Midnight in Paris, pas d'amour comme dans la capitale italienne : ce qui définit New York pour le cinéaste, ce n'est plus ses intellos et sa faune d'excentrique, mais bien son argent, sa luxure qui n'en finit plus de s’épandre et d'engloutir. Les boutiques de luxe, les magouilleurs, les sugar daddies sans scrupule, bref, toutes les proies du fisc réunies dans la cité du dollar.
Car même si Jasmine French, cette ex-bourgeoise dont le mari (Alec Baldwin) s'est avéré un escroc de première, est malade, sa maladie est ici l'entonnoir du montage. Chaque crise ramène à l'essentiel les possibilités du récit jusqu'à inaugurer un flashback, une explication supplémentaire qui lève le voile sur la vie d'avant l'écroulement. En ce sens, l’œuvre sert de pivot brillant entre deux époques (celle de l'Amérique des années 2000 et celle des années 2010 marquées par le mouvement Occupy, la conscientisation de masse et la critique popularisée des pouvoirs établis) entre lesquelles Jasmine est écartelée. Pour souligner le contraste, la ville de la côte Est répond à celle de la côte Ouest comme les deux poids de la grande balance étasunienne. D'une part, la maladie de Jasmine la replonge dans une nostalgie de l'aisance, d'autre part sa sœur (Sally Hawkins) l'aide à se reprendre en mains. Si la vie occidentale, c'est celle de la Crise, c'est aussi celle du perpétuel renouvellement. Changer de carrière à 40 ans, c'est bien là l'autre thème de Blue Jasmine.
Plus encore, c'est le thème primordial d'un film qui sait alterner entre le général et le particulier en traçant des corrélations éclairantes entre l'économique et l'intime. Dans un monde où l'humoriste Louis C. K. est un gentil technicien de son qui roule sa bosse et où Peter Sarsgaard est un diplomate qui rêve du sénat, le jeu des classes sociales se manifeste à chaque conversation, à chaque « c'est à cause des gênes » que lance la petite sœur commis d'épicerie à la grande Jasmine. À l'image des mélodrames bourgeois de Jean Renoir, les luttes verbales proférées dans Blue Jasmine agissent comme révélateurs des inégalités. Allen révèle, comme la fleur du titre qui ne se dévoile que la nuit (et comme le faux nom de l'héroïne), comment l'amour est aujourd'hui économique, comment le mariage est aussi une alliance de portefeuilles et comment, au-delà des baisers et des complicités, tout se termine en dettes, en poursuites, en gains et en pertes. L'auteur montre un amour bourgeois qui découle d'une stabilité financière comme à l'époque des rois et des reines. D'une métaphore érotique du jasmin bleu, voilà qu'on se retrouve à patauger dans le sang bleu néo-libéral.
Heureusement, Allen ne s'est pas lassé du sentiment amoureux qu'il considère bien éloigné de l'institution du couple, car Blue Jasmine n'est pas le film cynique et grincheux qu'il aurait pu être. D'abord parce que Cate Blanchett y met toutes ses tripes, ensuite parce qu'Allen donne sans cesse de l'espoir à ses personnages. La vie semble s'écrouler pour mieux se refaire, les malchances précédant les retournements de situations bienheureux. Avec la sagesse de l'âge, Allen montre le couple se décomposer à coup d’ellipses ambitieuses; personne, sinon la sœur, ne s'en sort, car tous se sont frottés trop près de cette belle inconnue, seule à sa table, qui attire, qui charme et qui, sans trop s'en rendre compte – par manque d'affection, suggère l'auteur – a fracturé le mythe de l'amour.
Les regards complexés de Blanchett et sa manière de gesticuler, tant par le rythme de ses bras que par sa façon de se taire, de pencher la tête et de fixer dans le blanc des yeux son interlocuteur, n'en deviennent jamais lassants. C'est que tout le talent de l'actrice est renchéri par la patience d'Allen qui s'obstine à ne pas couper l'élan de l'interprète par un contrechamp, luttant pour que chaque échange repose essentiellement sur des dialogues inspirés qui se tendent la parole plutôt qu'il ne la s'entrecoupe. Quand Blanchett parle, c'est tout le cadre qui devient silencieux. Quand elle parle dans le vide. Quand elle parle à son ex-mari. À son petit ami diplomate. À sa sœur. Les gens se taisent alors qu'elle, elle coupe... Elle coupe comme elle coupe son présent d'un trop de passé, repassant sa vie en boucle, prisonnière de ses décisions enflammées qui causèrent ultimement sa propre perte.
Blue Jasmine est-il le film d'un cinéaste aux regrets inconsolables? Ce serait prendre au pied de la lettre Allen que d'y voir une complainte. Au contraire, Blue Jasmine est l'une de ses œuvres les plus vivaces; on y montre comment la nostalgie paralyse et comment, nonobstant la détresse et l'abandon ressentis par l'héroïne, le monde continuera toujours de tourner, qu'elle en soit le centre d'attraction ou non. Que l'auteur mette en doute la subjectivité, qu'il ose, ne serait-ce qu'ici, exposer clairement l'inévitable folie qui en découle (dans le récit comme par son montage), c'est bien le signe que malgré les années, les cinquante œuvres et toutes celles à venir, il n'y aura jamais assez de films de Woody Allen. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 6 Septembre 2013 à 02:30
Mostra de Venise, jour 4:Terry Gilliam et Gia Coppola
 03/09/2013 | 18h27
03/09/2013 | 18h27Les jours ne se ressemblent pas à la Mostra de Venise. Dimanche 3 septembre morose, lundi 4 plus rose.
La catastrophe du jour, même si l’on n’en attendait pas grand-chose, c’est le nouveau film de Terry Gilliam : The Zero Theorem. Co-production internationale un peu cheap, ce film de science-fiction mériterait de remporter le Lion de béton du film le plus plombant de la première moitié du festival. Si l’on devait le résumer en deux mots, ce seraient : lourdeur et laideur. De la mise en scène, du jeu des acteurs, de la “pensée”, des sentiments, des personnages. En fait, Terry Gilliam ne semble pas avoir avancé d’un pouce depuis Brazil, sauf qu’il ne dispose plus des moyens imposants qui étaient les siens à l’époque et surtout que le monde, lui, n’est plus tout à fait le même. Sa critique de la société libérale fait plof. Ce voyage dans le futur se trompe de direction et part vers le passé. N’insistons pas, sinon pour dire que le pauvre Christopher Waltz y joue le plus mauvais rôle de sa vie depuis quelques années, que Mélanie Thierry est malmenée. Dans le genre, The Meaning of Life en disait plus sur aujourd’hui. Bref.
On a aussi découvert une jeune cinéaste. Dans la famille Coppola, voici donc la petite-fille de Francis, la nièce de Roman et Sofia, la jeune Gia (26 ans, la fille de Gio, le fils aîné de Francis, mort accidentellement à 22 ans). Encore une “fille de”, oui… Palo Alto, son premier film, n’a rien de génial. Surtout, on a l’impression de l’avoir déjà vue cent fois, cette adolescence américaine qui ne peut pas s’empêcher de faire des bêtises plus grosses qu’elle (ne serait-ce que chez Sofia). Mais le film a confiance dans le cinéma, se laisse aller à des digressions gracieuses, prend son temps, décrit les parents avec finesse, les intermittences du cœur et du sexe avec humanité et indulgence. Cette fille a le sens du tempo. On se laisse entraîner par le charme intelligent du film et celui de ses interprètes, dont certains déjà célèbres : James Franco (qui a produit le film), Val Kilmer (hilarant en beau-père junky), la craquante Emma Roberts. Bon. Une dynastie de cinéma, ces Coppola. On attend mieux la prochaine fois.
On a vu aussi une partie du nouvel opus de quatre heures du grand documentariste Frederick Wiseman, At Berkeley, qui décrit les arcanes de cette grande université californienne. Un début génial, enthousiasmant, galvanisant, politique. Un film qui agite des idées. On en reparlera quand on l’aura vu en entier à Paris (et surtout avec des sous-titres français…).
Ana Arabia, le nouveau film de fiction d’Amos Gitai, nous a laissés un peu de marbre : un plan séquence de 84 minutes au cœur d’une maison, de ses cours intérieures. Une journaliste est venue enquêter sur une femme qui y habitait depuis 1948 et qui vient de mourir. Rescapée d’Auschwitz, elle avait fait scandale en épousant un Arabe musulman. La journaliste interroge le mari, les enfants… L’ensemble est assez artificiel et théâtral, parfois émouvant, mais ne trouve jamais l’élan nécessaire pour nous embarquer, nous subjuguer, nous soumettre à sa forme. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 6 Septembre 2013 à 02:08
Locarno 2013 : Léopard d'or pour Histoire de ma Mort d'Albert Serra
FESTIVAL RECOMPENSES | Par GUSTAVE SHAÏMI | le 19 Août 2013 à 11h08Le festival organisé sur les rives du Lac Majeur en Suisse s'est clôturé hier soir. Le Léopard d'Or, la plus haute récompense décernée, a été remis à l'Espagnol Albert Serra pour son film Histoire de ma Mort, sur les dernières années de la vie de Casanova.
Albert Serra, mis à l'honneur au printemps dernier au Centre Pompidou avec une exposition et une rétrospective de ses films, a confirmé à Locarno la dimension radicale de son cinéma : son approche de Casanova en a surpris plus d'un puisque, loin de Venise ou de la France, c'est en Transylvanie qu'on suit le séducteur mythique, à la rencontre... de Dracula. La sortie dans la salles françaises est fixée au 23 octobre.
Le Prix spécial du jury présidé par le cinéaste philippin Lav Diaz a été décerné au film portugais E agora? Lembra-me, réalisé par Joaquim Pinto, séropositif depuis près de vingt ans. Le Sud-Coréen Hong Sang-soo, grand incontournable des festivals (il était en Compétition à la Berlinale en février avec un autre film, Haewon et les Hommes, bientôt en salles), a remporté le Léopard d'Argent de la meilleure réalisateur avec Our Sunhi, nouveau récit fait d'échos et de subtiles variations sur une jeune femme et la manière dont elle est perçue par trois hommes différents, tous amoureux d'elle.
La Suisse, pays organisateur, n'a pas été laissée en reste par les jurés - parmi lesquels la Française Valérie Donzelli et le Grec Yorgos Lanthimos, puisque le documentaire Tableau noir, tourné dans une école de montagne juste avant sa fermeture, a reçu une Mention spéciale.
Le palmarès complet :
- Léopard d'Or : Histoire de ma Mort d'Albert Serra
- Prix spécial du jury : E agora? Lembra-me de Joaquim Pinto
- Prix du meilleur réalisateur : Hong Sang-soo pour Our Sunhi
- Prix d'interprétation féminine : Brie Larson dans Short Term 12 de Destin Cratton
- Prix d'interprétation masculine : Fernando Bacilio dans El Mudo de Daniel et Diego Vega
- Mention spéciale : Short Term 12 de Destin Cratton et Tableau noir d'Yves Yersin
Source : site officiel du festival
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 18:19
Omar Gatlato

Un film de Merzak Allouache
Avec Boualem Benani, Aziz Degga, Farida Guenaneche,Rabah Leghaa
C'est une belle légende qui continue de surprendre. Omar Gatlato, c'est le titi algérois qui traine sa belle carcasse d'amant lunaire, un café goudron dans la main gauche et son transistor dans l'autre main. Au milieu, une pensée pour sa future bien-aimée...
Article de Samir Ardjoum

Un jour, un ami journaliste me disait ces quelques phrases qui m'ont paru exagérées sur le coup : "Celui qui n'a jamais écouté Amar Ezzahi (chanteur de Châabi, genre musical algérien), accoudé à un mur, la cigarette aux lèvres et le café à la main tout en pensant amoureusement à sa copine, celui-là ne sait pas vivre !" La scène se passait dans la ville d'Alger, à la sortie d'une salle de cinéma. Omar Gatlato, premier long-métrage de Merzak Allouache, en était le film du jour. Dans l'instant présent, je n'avais pu saisir la portée de cet adage algérois. En revoyant le film, je compris très vite le sens de cette poésie urbaine. Ce jeune critique de cinéma, en prononçant ces quelques mots, voulait me donner la définition du quotidien algérois, du bonheur simple et de la quintessence d'une matinale. Ces petits trucs qui vous emplissent de joie lorsque vous les caressez. Le café et la cigarette du matin valent mieux que les richesses d'un roi. Omar Gatlato, c'est tout cela et rien d'autre.
Réalisé en 1976, durant la période Boumediene (président d’Algérie de 1965 à 1978) et en pleine crise pétrolière,Omar Gatlato va perturber le cinéma algérien, le rendant plus libre, plus inventif et surtout plus proche de la réalité. Depuis l’indépendance de 1962, les cinéastes ont orienté leur création vers une approche propagandiste, contrôlée par un financement étatique de plus en plus présent. Restriction des thèmes abordés, sabotage des envolées lyriques et surtout enfermement dans un formatage des plus pénibles. Certaines comédies prenaient le temps et la peine de poser quelques réflexions sur cette nouvelle vie sociétale. Des Vacances de l’inspecteur Tahar à Hassan Terro (avec le surprenant Rouiched), les auteurs prenaient un malin plaisir à dynamiter les imperfections d’une présidence qui réduisit les cris de liberté à des chuchotements actifs. Las des films sur la guerre de libération, une nouvelle génération de cinéastes bercés par le dynamisme des comédies italiennes (Le Pigeon de Mario Monicelli entre autres), et surtout par la désinvolture de la Nouvelle Vague, prirent le pouvoir au beau milieu des seventies. C’est dans ce contexte révolutionnaire que l’ancien coursier Merzak Allouache écrivit son premier scénario. Quelques historiettes sur un jeune algérois, fonctionnaire de son état, charismatique, bagarreur et surtout amoureux de la vie dans tous les sens du terme. Omar Gatlato était né !
Dès le premier plan, l'auteur nous plonge dans l’intimité du personnage-titre. Seul dans sa chambre, Omar finit de s’habiller. Il se présente, nous explique le sens de son surnom (Gatlato signifie « la virilité qui le tue » en arabe), et nous raconte quelques détails clés sur son enfance, ses parents, sa vie en somme. D’emblée, Omar nous est présenté comme un personnage banal, généreux et qui n’aspire qu’à une seule chose : posséder une grosse quantité d’enregistrements chaabi (musique populaire algéroise dont les principaux chanteurs sont El Anka, Guerouabi, Ezzahi et Chaou). Allouache sait exactement de quoi il parle, il est en quelque sorte un « Omar Gatlato » dans l’âme. Algérois, passionné de musiques traditionnelles et surtout féru de cinéma (italien et indien), l’auteur nous présente un homme qui pourrait être son frère jumeau. C’est pour cela qu’Omar se présente face à la caméra, qu’il joue le jeu du reportage, qu’il invite le spectateur à pénétrer dans sa bulle. Le film, dès les premières minutes, s’exprime à la première personne, un « je » qui ne s’entend pas mais qui se voit.
Plus loin, l’auteur nous entraîne dans le quotidien banal d’Omar. Entre le bus plein à craquer, les collègues de bureaux tous plus lunatiques les uns que les autres et les combines professionnelles, les journées de Gatlato se ressemblent toutes. Une scène importante doit être mentionnée car représentative des intentions du cinéaste. Dans le bus qui l’amène à son lieu de travail, Omar effleure par mégarde la main d’une jeune femme qui se tenait près de lui. Quelques secondes suffisent pour créer une gêne réciproque, qui suffit à ce que la jeune femme retire précipitamment sa main, confuse et rouge de honte. Plan court et remarquable, car toute la thématique du film se trouve dans ce geste, toute la tristesse d’un pauvre destin peut se lire dans cette main piégée.
Roy Armes, dans une analyse intéressante (Omar Gatlato, éditions L’Harmattan), convoque le thème de la frustration amoureuse. Il est souvent question d’un désir refoulé, d’une émotion interdite et d’un sentiment censuré, qui se traduisent dans le film par une incommunicabilité avec la famille, par des non-dits avec les amis et surtout par une intimité amoureuse invraisemblable. La société d’Omar Gatlato regorge de contradictions, d’intégrisme religieux et de cloisonnement. Omar ne peut s’affirmer en raison d’une trop grande sécheresse affective. En se confrontant à cette voix mystérieuse, c’est tout un schéma qu’il remet en cause, toute une idéologie qu’il tente de rejeter. La dépression est proche car ce ras-le-bol quotidien l’avale progressivement. Omar ne veut plus survivre, quitte à se démarquer définitivement de son passé. A ce moment-là, Allouache emmène son héros vers la confrontation ultime, la rencontre avec cette femme. La scène sera belle, juste et triste. Omar ne pourra retourner sa veste faute de courage et surtout faute d'avenir. Evidence omniprésente.

Trente années se sont écoulées depuis. L’Algérie a vécu des heures troubles et effrayantes. Guerre civile, inondations de Bab El Oued et tremblement de terre (2003) ont suffi à ébranler une conscience. La génération d’Omar est perdue et désillusionnée, celle qui suit est du même acabit. Quelques auteurs pointent du doigt les difficultés rencontrées par cette jeunesse déboussolée, mais rares sont les films de qualité. Quant à Merzak Allouache, il continue son bonhomme de chemin entre la France et l’Algérie, l’inspiration en moins. Difficile en effet de porter un certain intérêt pour ses dernières productions. Hormis quelques belles percées (Bab El Oued City et Salut Cousin) et un succès public surprenant, dû en partie à la popularité grandissante de l’humoriste Gad Elmaleh (Chouchou), Allouache étonne par la faiblesse de son point de vue mais aussi par la maladresse de ses réalisations. Quelque chose en lui semble brisé, voire effacé. Où sont passés les rêves de jeunesse ? Allouache ne veut plus y répondre… votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 18:15
Mascarades

Un film de Lyes Salem
Avec Lyes Salem, Rym Takoucht, Sara Reguigue,Mohamed Bouchaïb, Mourad Khen
C'est la comédie du mois et elle nous vient d'Algérie. "Mascarade" est une œuvre réussie et prouve une fois de plus la vitalité d'un cinéma qui revient de loin.
Article de Samir Ardjoum

Partir de l’avant. Belle devise, belle politique dont nous aimerions tous appliquer les vertus. Les configurations pénibles se ramassent à la pelle et il est difficile de nos jours de tout changer pour une autre vie, une autre extase, un autre départ en somme. Certains patientent, scrutent, dorment, réfléchissent et puis quand les cartes sont posées, c’est la débandade. Alors, les décisions pleuvent et beaucoup n’en sortent pas indemnes. Mascarades, le premier long-métrage du pétillant Lyes Salem, résume en quelques 90 minutes toute cette soif de liberté. Ce metteur en scène qui parle avec les mains, joue avec les mots et danse sur du velours, traine sa caméra du côté des Monicelli, Rouiched, Keaton (pour ne citer que quelques grands noms du burlesque), et enveloppe ces personnages d’une histoire sensible, mortellement dérangeante et finalement rafraîchissante.
Ce qui frappe d’emblée dans cette comédie du remariage, c’est le temps qui fonce à toute allure, ne donnant pas au spectateur l’envie d’aller voir ailleurs. Salem débute par un gigantesque plan séquence qui s’ouvre sur un minaret, pour se finir sur une bande de villageois s’éparpillant ici et là à la recherche d’une oasis d’apaisement. Tout est dit dans cet instantané de vie et Salem ne brouille jamais les cartes. L’image est plus importante que la parole, et l’auteur césarisé de Cousines (son dernier court-métrage) l’applique dans ses séquences virevoltantes. Ce point de départ est très important, car il caractérise un cinéma qui joue sur l’émotion, mais sans la diaboliser, refusant par la même occasion de verser dans la démagogie. Si Mascarades réussit l’exploit de faire rire, c’est en partie grâce à une construction narrative qui joue sur les codifications de la société algérienne, donc de la vie. Tout respire l’Algérie : la langue algéroise (le derja), les personnages qui certes sont des stéréotypes, mais qui peuvent être reconnus par tous, les quelques subtilités qui renvoient à des non-dits (le personnage du colonel, sorte de parabole sur les magouilles politiques), le geste comique (beaucoup de cris mais point de sang), et surtout cette envie d’humer l’évasion.

La plus belle des idées, c’est de faire adhérer son entourage à un mensonge conséquent. Plus la situation vire au gigantisme, plus l’aspect comique sera amplifié. Mounir, le frère aîné de Rym, fait croire à tout le village que sa sœur va épouser un riche homme d’affaires. Tout respire le toc et cette bêtise aurait pu être désamorcée, mais Salem est un personnage qui aime rire des situations complexes, donc son film va prendre une route problématique où se côtoieront grand dadais (Mourad Khen, toujours aussi bluffant), amant fougueux, épouse lucide (grande Rym Takoucht) et chef d’orchestre, lointain cousin d’Omar Gatlato (Mounir, le personnage mi-romantique mi-conformiste). Salem adore malmener ses personnages, il les dorlote par la même occasion, mais refuse de leur donner une raison de pleurer. Pas besoin, l’attitude en dit bien plus long qu’un monologue discordant.
Beaucoup de joie traverse ce film. Satisfaction d’observer un cinéma qui ouvre les stores de l’ennui, satisfaction de voir un cinéaste refuser la facilité en filmant une comédie (genre réputé complexe dans le cinéma), et satisfaction d’écrire un papier sur une œuvre qui va se bonifier et qui causera pas mal de torts aux détracteurs, ceux qui réchauffent leurs mains avec des braises poussiéreuses. votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien





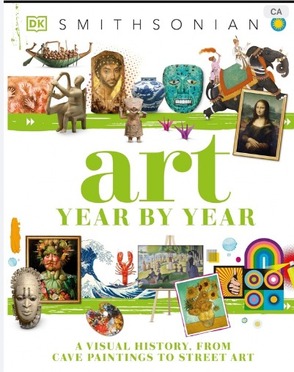




















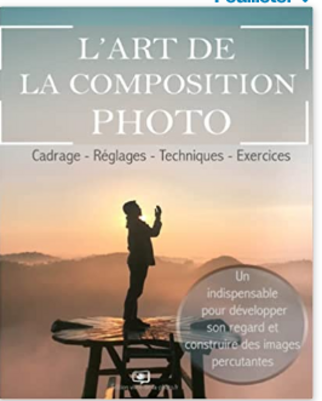







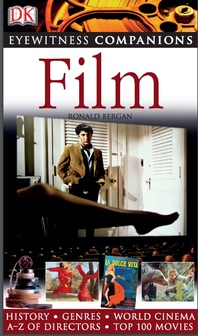





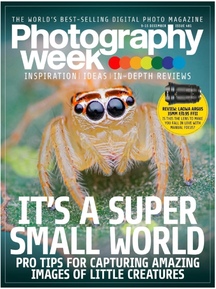



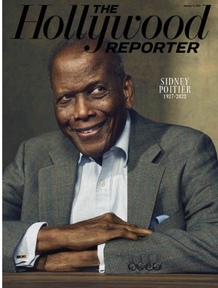








































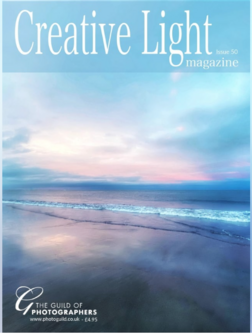

















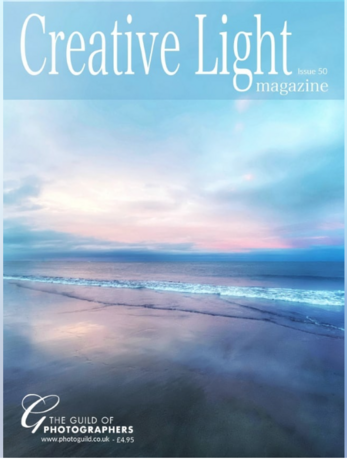


















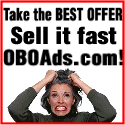
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot









