-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 18:12
Monsieur Lazhar

Un film de Philippe Falardeau
Avec Mohamed Fellag, Sophie Nélisse
Éloge de la retenue dans ce beau film québécois travaillé par les allers sans retour.
Article de Jean-Baptiste Viaud

Ne pas se fier à l’affiche, qui laisse augurer d’une comédie low-cost en milieu scolaire. Si, du fait d’une mise en scène assez dépouillée, Monsieur Lazhar peut par instants faire craindre une version améliorée d’un épisode de L’Instit, le film de Philippe Falardeau est surtout un petit sommet de délicatesse. Nommé à l’Oscar 2012 du meilleur film étranger et récompensé à Namur, Locarno et Toronto l’an passé, Monsieur Lazhar, quatrième long métrage du cinéaste québécois après C’est pas moi, je le jure !, questionne avec tact le deuil chez l’enfant et l’intégration des immigrés. Une maîtresse d’école s’est suicidée, son corps pend au bout d’une corde dans sa salle de classe. Par la porte en verre, Simon découvre la scène et alerte la direction. On évacue les enfants vers la cour de récré. Après, il faut expliquer. Ce qu’il s’est passé, mais aussi qu’on peut, qu’il faut en parler. Il faut remplacer, aussi. Parce que Martine Lachance est partie mais que les cours continuent, Bachir Lazhar, immigré algérien, la remplace au pied levé. Il n’a jamais enseigné, le cache à la directrice. On est dans l’urgence, il obtient le poste.
Le film de Falardeau avance par petites attentions, prenant bien garde à ne pas verser dans le sentimentalisme. L’équilibre est fragile, tant le réalisateur veut parler de tout : difficultés d’intégration d’un immigré à l’étranger, réfugié politique de surcroît ; acceptation de la mort et travail de deuil chez l’enfant, doublé d’un sentiment de culpabilité ; système éducatif à problème, ou le moindre contact est proscrit et où les parents savent toujours mieux que le corps enseignant. C’est sur ce dernier point que Monsieur Lazhar innove : là où Entre les murs se concentrait sur le rapport de force entre professeur et élèves, le film évacue presque intégralement cette notion (Lazhar a finalement peu de mal à se faire apprécier) pour souligner les difficultés à enseigner dans un environnement où le principe de précaution fait loi. Qu’on veuille s’approcher d’un élève, et les soupçons d’abus surgissent ; qu’on tente d’élargir la portée d’une dictée d’une fable de La Fontaine, et les parents rappellent à l’ordre, demandant qu’on se contente d’« enseigner » plutôt qu’« éduquer ».

Monsieur Lazhar n’est pas dénué d’un certain idéalisme, qui lui fait parfois défaut. Ainsi d’une classe un peu trop attentive, de métaphores un rien convenues, ou d’une dénonciation un peu sommaire du suicide par endroits. Il n’empêche que Monsieur Lazhar réussit souvent le dosage, grâce à un sens de l’effet et, surtout, à une grande humilité. Film lyrique, il mouille les yeux, pas parce qu’il est tire-larmes, mais parce qu’il a le goût de la formule et d’un certain réalisme qu’on déteste souvent ailleurs mais qui touche ici. Petite magie dûe aussi et en grande partie aux interprètes : Fellag est irréprochable de tendresse un peu surannée et les enfants, filmés à leur hauteur, d’une immense justesse. Ce n’est pas un film parfait, mais c’est l’inverse d’un film fabriqué - on utiliserait bien l’horrible adjectif « sincère » si tous les films ne l’étaient a priori. C’est un film pour lequel on se prend à douter, venu le moment de le juger : l’aime-t-on pour les bonnes raisons ?
Il y a enfin que Monsieur Lazhar est, sous ses dehors affectueux, un film en colère, sourde mais bien là. Celle d’un homme en colère du sort fait aux immigrés (tracasseries administratives et incrédulité d’une part, acceptation teintée d’excitation de l’exotisme d’autre part), de celui fait aux enfants qu’on laisse seuls face à leur douleur, qu’on quitte « sans dire au revoir ». C’est un film dans lequel les gens partent - pas toujours parce qu’ils meurent d’ailleurs -, partent et ne reviennent pas ; un film qui dit qu’il y a des voyages dont on se passerait. Ce qui est beau, alors, ce sont des choses toute simples : un « merci » chuchoté en fin d’année, une étreinte qu’on sait interdite mais dont on ne saurait se passer. La retenue dont fait preuve Bachir est à l’image de celle d’un film en équilibre, si conscient qu’il pourrait déraper qu’il fait naître l’émotion par son constant frémissement.
À lire : l'interview de Philippe Falardeau. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:58
La Source des femmes

Un film de Radu Mihaileanu
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna
Pour un peu d’amour et d’eau fraiche, les habitantes d’un village oriental entament une grève du sexe. Radu Mihaileanu défend de belles convictions, mais son conte moderne tourne vite au mélo sans âme.
Article de Camille Poirier

Film après film, Radu Mihaileanu n’a cessé de puiser son inspiration à la source du conte. En suivant pas à pas le cheminement du jeune Schlomo vers l’âge adulte, Va, vis et deviens mettait en scène un parcours initiatique digne deCandide. Le Concert, pour sa part, brillait par son caractère volontiers fantaisiste, voire même invraisemblable, à la frontière du conte de fée et de la farce slave. Si La Source des femmes ne déroge pas à la règle (le film est qualifié de conte dès les premières secondes), cela tient au sujet que Radu Mihaileanu a choisi de traiter : dans une bourgade isolée d’Afrique du Nord (ou d’ailleurs…), les femmes sont lasses d’aller chercher l’eau à la source comme l’ont fait leurs mères et leurs grand-mères pendant des siècles. Ces longues marches épuisantes sur une route escarpée et périlleuse, au beau milieu de la poussière et de la chaleur, ne cessent de faire couler la sueur, le sang et les larmes. Résolues à mettre fin au massacre, les villageoises optent pour une solution sans appel : entamer une grève de l’amour jusqu’à ce que leurs époux prennent conscience des maux qu’elles endurent et s’attèlent à trouver une solution. Comme Shéhérazade dans Les Mille et Une Nuits, Leila, Rachida et leurs consœurs font patienter leurs maris, nuits après nuits…
Bien qu’inspirée d’un fait divers qui provoqua une petite onde de choc en Turquie il y a une dizaine d’années, cette fable se veut à la fois universelle et atemporelle : Aristophane n’écrivit-il pas une comédie sur ce même thème, 400 ans avant notre ère ? Avec Lysistrata, l’auteur antique à l’imagination foisonnante se plût à rêver qu’une bande d’Athéniennes pourrait mettre fin à une guerre, tout simplement en désertant la couche nuptiale. Inutile de le préciser, cette comédie licencieuse, non dépourvue de finesse et de lucidité, n’avait nullement pour prétention d’épouser une cause, et encore moins celle des femmes. Radu Mihaileanu prend le parti contraire en choisissant de transformer son conte moderne en hymne à la gloire du beau sexe. De là naissent toutes les faiblesses d’un film gorgé de bons sentiments et d’intentions louables, mais qui ne parvient finalement ni à toucher ni à convaincre.
La Source des femmes éprouve d’indéniables difficultés à trouver un ton juste, jonglant maladroitement entre pure comédie et drame émouvant. Les doux yeux de Leïla Bekhti qui ne cessent de s’emplir de larmes agacent d’ailleurs assez rapidement… Plus grave encore, le film s’acharne à ressasser pendant deux heures – durée inappropriée pour un conte ! – un message de paix et d’amour, généreux mais maladroit. Chants, danses, tirades et sourates, tout est bon pour faire comprendre au malheureux spectateur que la femme est l’égale de l’homme et qu’elle doit, elle-aussi, pouvoir s’instruire et cultiver son jardin. Certaines scènes, à l’image de la confrontation entre la valeureuse Leila et l’imam au cœur tendre, sont d’une désespérante naïveté et ménagent leurs effets avec une délicatesse éléphantesque. Non, l’islam ne prône pas l’asservissement de la femme et ne s’oppose pas à la sensualité. Oui, les petites filles doivent rejoindre leurs frères sur les bancs des écoles, car l’affranchissement passe d’abord par l’éducation. Les messages sont limpides comme de l’eau de roche : un peu trop, sans doute.
Le film aurait pu être un bel hommage rendu aux femmes, que Radu Mihaileanu dépeint fortes, clairvoyantes, courageuses et pacifistes, comme dans ses précédents films. Comment remettre en question la grâce des jeunes actrices (Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Sabrina Ouazani…), le charme des peaux cuivrées sublimées par des plans fixes et rapprochés, ou encore l’aspect envoutant des danses et des chants ? Malheureusement, c’est le résultat contraire qui est obtenu ici : en privant ses personnages de dialogues véritables et en transformant leurs répliques en plaidoyers incessants, Radu Mihaileanu les enferme dans un corset, les restreint au rôle de porte-paroles ou les métamorphose en allégories. Femmes, actrices, toutes s’effacent derrière les convictions d’un réalisateur engagé, mais peu engageant. Dommage.

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:50
Le Repenti

Un film de Merzak Allouache
Avec Nabil Asli, Adila Bendimered, Khaled Benaissa
Regard sur un pardon impossible, dans un drame social exemplaire.
Article de Pauline Labadie

L’ouverture rappelle la fin de Blood Simple (1984) des frères Coen. Un homme court dans une étendue neigeuse, seul. Soubresaut de l’image, stridence de la respiration brûlante du fugitif, nature désertique et sèche sous l’hiver, cette première scène est exemplaire de puissance visuelle.
Algérie, 1999. Après l’élection de Bouteflika, les citoyens approuvent par référendum la loi sur la « Concorde civile », dernière étape des démarches de clémence engagées par l’État envers les combattants du FIS (Front islamique du salut) et de l’AIS (Armée islamique du salut). Suite à sa mise en application l'année suivante, 80% des combattants islamistes se rendent et rejoignent la société algérienne.
Le personnage qui court, Rachid, est l’un d’eux, un « repenti » (El taaib). Il rejoint sa famille miséreuse, abandonnant ses « frères » djhadistes des montagnes pour retrouver une condition d’homme honteux, considéré comme terroriste par les gens de son village.
Présenté à la Quinzaine des réalisateurs l’an passé, Le Repenti prend à bras-le-corps la problématique du pardon national, et concitoyen, après des années de guerre civile et de massacres de civils. Allouache choisit à dessein un personnage principal peu aimable (comment pourrait-il l’être ?) qu’il confronte à un couple, aujourd’hui séparé, de citadins instruits dont la fille fut enlevée par les islamistes.

Lakdhar : Khaled Benaïssa, récompensé à Angoulême par un prix d'interprétation, est remarquable.
Cinéaste du célèbre Omar Gatlato (1976), l’algérien Merzak Allouache a considérablement mis en récit le drame des « années de braises » de son pays, alors même qu’il était forcé de vivre en France - d’un documentaire (L’Après octobre, 1989) sur les émeutes populaires d’octobre 1988 jusqu’à Bab el-Oued City (1994), film de fiction fait sous le manteau où il partageait les colères du peuple algérois.
Patiemment, il construit un parallèle entre le quotidien de Rachid, qui réapprend à vivre en société, et celui de l’homme divorcé. La mise en place de leur rapprochement est mystérieux, confirme les qualités de distance et de retenue des plans. Aussi, l’Algérie est filmée : Allouache ne laisse rien de côté, ni la beauté froide des étendues arides soudain ensoleillées, ni la décrépitude d’une ville de la région des Hauts-Plateaux.
C’est l’histoire récente d’un pays qui côtoie la fiction et son efficacité de transmission. Car si ce scénario pourrait aussi bien être celui d’un thriller, Allouache s’est pourtant servi d’un fait divers pour le construire. Ainsi, le spectateur est au cœur de ce mélange : l’intime et le national, la fiction et une approche documentaire, où s’écrit en creux une souffrance générale. Alors, si la réalité est si proche, le pessimisme du cinéaste a bien le droit de cité. Les personnages, définis en pointillés, sont tous blessés, traumatisés par un passé qu’ils ne communiquent jamais. Le réalisateur dit (la cruauté de son scénario l’atteste) combien la repentance de ses personnages est aussi inextricable que celle de son pays ; les hommes resteront lâches, certains paieront pour leur humanisme et les autres demeureront barbares.

Deux scènes culminent dans leur efficacité dramatique. Deux scènes de mouvements, d’action, les seules avec la course du début du film. D’abord une tentative de meurtre au couteau dans laquelle on rentre par deux plans, l’un bref en amorce de l’assaillant, l’autre en gros plan sur le visage de la victime, Rachid. On réalise à ce moment-là combien la sécheresse de la mise en scène est frontale, au plus près des gestes de Rachid, de sa peur animale qui surgit dans cette scène, à moins que ce ne soit le souvenir d’un entraînement. La scène est froide, peu chorégraphiée, il y a là une volonté de capter un acte de vengeance dans son dénuement le plus rude, son assouvissement le plus aléatoire, primaire. Yeux fuyants, regard hébété, le jeune homme attaqué semblerait presque naïf ; en creux, c’est l’enfant algérien des années 1990, inéduqué et malléable, qui répond à la violence par la violence.
L’autre scène survient à l’épilogue du film. Un tour de force, l’enfermement dans l’habitacle d’une voiture où se règle les comptes d’années de frustrations et d’un marché inhumain, dont on ne dira rien ici. Trois personnages collés dans le plan pendant quinze minutes, forcés de faire route ensemble. De dialogues en cris, la tension dramatique monte, jusqu’à une apothéose complètement mélodramatique. D’aucuns diront trop, même si la retenue de toute la mise en scène, ses va-et-vient patients préfiguraient évidemment cette déflagration dramatique.
Cela dit, plus encore, le plan final du Repenti réglera son compte à ce « foutu humanisme » qui a perdu un des personnages. La conclusion du film est en soi un acte politique, la signature très sombre d’un cinéaste au pessimisme étranglant. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:44
Hors-la-loi

Un film de Rachid Bouchareb
Avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila
Une fresque sur l'engagement militant en France de trois frères pour l'indépendance de l'Algérie. Du film "Hors-la-loi" de Rachid Bouchareb, on retiendra surtout le devoir de mémoire.
Article de Falila Gbadamassi

Un bout de terre sec dans la campagne algérienne. Une expropriation qui demeurera à jamais gravée dans la mémoire de trois petits garçons d'une dizaine d'années : Abdelkader (Sami Bouajila), Messaoud (Roshdy Zem) et SaÑ—d (Jamel Debbouze). A Sétif, où ils grandissent, Abdelkader et SaÑ—d sont les témoins d'un drame : les massacres de Sétif du 8 mai 1945. Au premier, partisan actif de l'indépendance, cela vaudra l'emprisonnement. Le second, passionné de boxe, est définitivement traumatisé par la mort de son père et d'une partie de sa fratrie, tués lors des évènements, et par l'indicible chagrin de sa mère. Bientôt, SaÑ—d propose à cette dernière de rejoindre son frère en France où il purge sa peine. Abdelkader y affine ses idées politiques et, à sa sortie, devient un membre actif du Front de libération national (FLN), le mouvement algérien qui portera le pays vers l'indépendance. L'aîné de la famille, Messaoud, vétéran de la guerre d'Indochine, s'allie très vite à la cause de son cadet, au détriment du benjamin SaÑ—d, qui a choisi la réussite à tout prix et par tous les moyens, notamment les plus répréhensibles.
Après London River (2009), qui s'appuyait sur la désolation de deux parents sans nouvelle de leurs enfants après les attentats de Londres, Rachid Bouchareb choisit de faire dans la fresque avec Hors-la-loi. Il examine sur 40 ans les choix politiques, ou non, de trois hommes qui partagent une communauté de destin, bien que chacun d'eux croit être maître du sien. Messaoud, homme de main de son frère Abdelkader devenu un des grands responsables du FLN en France, foule au pied le serment qu'il s'est fait à son retour de la guerre d'Indochine : ne plus tuer. La grande cause qu'il défend vaut bien ce renoncement. Il en sera de même pour SaÑ—d, dont la grande passion, la boxe, est vécue comme une trahison par Abdelkader qui ne se prive pas de prélever l'impôt révolutionnaire sur les activités illicites de son benjamin, un homme qui compte dans les bouges de Pigalle. Hors-la-loi est une reconstitution du mode de fonctionnement d'un mouvement indépendantiste : le FLN. Ses méthodes de recrutement dans la masse ouvrière que constitue les Algériens installés en métropole, son idéologie qui misera sur la répression dont il est victime pour trouver des alliés à sa cause et qui privilégie la violence pour obtenir gain de cause, sa lutte fratricide avec le Mouvement national algérien (MNA) qu'il finira pas supplanter et "les porteurs de valise" qui alimentent les caisses du parti. Le film de Rachid Bouchareb montre également qu'être membre du FLN s'apparente à un sacerdoce. Abdelkader sacrifie sa vie personnelle et familiale au mouvement qui en réclame toujours plus. La polémique qui entoure la sortie de ce film, accusé de ne présenter qu'une vision de l'histoire – celle de la France, une puissance colonisatrice, qui massacrera les Algériens pour maintenir leur pays dans son empire – se fait alors vaine. Car Hors-la-loi est une fiction qui s'appuie sur des faits réels dont certains nourrissent sa dramaturgie. Le long métrage de Bouchareb raconte bien la petite histoire de jeunes Algériens embarqués dans la grande histoire de l'indépendance de l'Algérie, jusqu'à la veille de sa proclamation le 5 juillet 1962.
En même temps, il perd souvent de vue sa louable ambition première : s'intéresser avant tout à des hommes pris dans le tourbillon d'une époque dont le combat fait écho à leur déchirement d'enfants, d'adultes et de citoyens. Si l'on comprend intuitivement les motivations d'Abdelkader, personnage central qui embarque toute sa famille dans la lutte, on se serait attendu à ce qu'elles soient solidement répertoriées à l'écran. Malheureusement, le spectateur doit se contenter d'une exécution sommaire de prisonniers que l'on suppose militants, des encouragements d'une mère demandant à son fils d'être un homme ou encore d'un recruteur du FLN lui donnant consignes et conseils pour constituer une section à sa libération. On regrette qu'il ne soit jamais fait état de sa construction idéologique. Le constat est d'autant plus aisé quand on pense, toutes proportions gardées, aux héros libérateurs de The Patriot, le chemin de la liberté de Roland Emmerich (2000) ou du biopic Malcom X de Spike Lee (1992). Le constat vaut également pour le personnage de Messaoud. Celui de SaÑ—d reste de ce point de vue le plus chanceux. Son intérêt pour la boxe ne fait jamais figure de pièce rapportée dans l'intrigue.
Par ailleurs, les décors, fidèlement reconstitués dans les studios tunisiens de Tarak Ben Ammar, confèrent une certaine rigidité à l'ensemble. Sensation renforcée par l'impression récurrente que certaines scènes n'existent que pour servir d'illustration, faisant deviner, sans aucune subtilité, les intentions du scénario. Plaquées, elles se succèdent de façon logique mais n'ont aucune vie propre . L'exécution d'un leader du MNA, après une parodie de procès et à la suite d'une altercation, ou l'aveu soudain des crimes qu'il a commis par Messaoud à sa mère en sont quelques unes. Le récit se déroule sans jamais provoquer une adhésion totale.
Pour autant, les intentions du cinéaste franco-algérien Rachid Bouchareb sont claires : rappeler à ses compatriotes une histoire commune faite de tragédies qui ne les empêchent en rien de vivre ensemble. Cependant, remuer le passé quand il s'agit de l'Algérie et de la France est un exercice périlleux, surtout si la cinématographie s'en mêle.Hors-la-loi doit être donc pris pour ce qu'il est, à savoir un devoir de mémoire accompli. Tout comme le fut en son temps Indigènes, hommage fort utile ( il a contribué à accélérer le processus de décristallisation de leurs pensions militaires) à tous ces ressortissants des colonies françaises qui ont participé à la libération de la France sur tous les fronts où elle fut engagée durant cette période. Car ceux qui ne savaient pas en sa votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 4 Septembre 2013 à 17:42
Gabbla (Inland)

Un film de Tariq Teguia
Avec Kader Affak, Ahmed Benaissa, Ines Rose Djakou
Inland...Gabbla. Dans les terres. Lesquelles ? Celles qui forcent sans doute le respect, qui nous poussent à toujours découvrir l’Autre, qui émeuvent et remplissent nos oripeaux de ce je-ne-sais-quoi qui atteint le sublime. Inland, dernier film de Tariq Teguia, un cinéaste universel qui redéfinit le sublime !
Article de Samir Ardjoum

Le beau est-il une affaire de morale ? Interrogation qui soulève toujours des zones d’ombres, devenue la thématique essentielle de ce début d’année 2009. 35 rhums de Claire Denis, Un lac de Philippe Grandrieux, 24 city de Jia Zhang-Ke et bientôt A l’aventure du ténébreux Jean-Claude Brisseau. Quelques films assez personnels qui traduisent un sentiment de découverte, de croisement dans les sphères assez souples du cinéma. Toujours sympathique de faire des parallèles, surtout si elles sont légitimes. Ces cinéastes ont cette particularité de se démarquer d’un système très complexe où les financements ne sont pas toujours à la hauteur, où la recherche formelle a du mal à se concilier avec celle du fond et où le résultat frise souvent une débâcle conséquente. On l’oublie trop souvent, mais les évadés des salles obscures n’attendent qu’une chose : qu’on les déboussole pour les noyer sous de nouvelles vagues originales. Malheureusement, le dénigrement est assez régulier, et ce contrairement aux apparences.
Tariq Teguia est un homme qui erre entre Paris, la ville lumière et Alger, la ville blanche. Découvert pour beaucoup avec Rome plutôt que vous, subtile réflexion sur la violence des mots dans une Algérie d’après-guerre (celle des années 90 et du terrorisme), Teguia est un cinéaste touche-à-tout qui ne bricole pas, il cadre le Temps, celui d’un présent familier. Sa filmographie est empreinte d’une volonté de dessiner une nouvelle carte d’une Algérie en reconstruction permanente. Les immeubles, les architectures et les routes sont remodelés, déclassés et pour la plupart reconstruits. Alger, par exemple, est devenue un chantier gigantesque qui n’en finit pas d’être détruit, repris en main et finalement renouvelé. Dans Rome plutôt que vous, ce sont des constructions à peine achevées, des endroits-fantômes et des zones réputées pour leur tourisme qui y sont présentés sous un jour plus réaliste (la Madrague, Alger judicieusement filmé de dos, le quotidien de Kamel et de Zina). Dans Inland, Teguia va plus loin en quittant l’urbanisme pour aller fureter du côté de la Porte du Soleil, celle qui libère les touaregs de leur cliché, qui ramène le vent des sables et qui réveille Dame Nature pour une confrontation ultime : l’humain face à la brillance du paysage.


 Inland est une œuvre qui se perçoit. Caressant le doux sentiment de l’âme, Teguia va indubitablement laisser parler son ressenti, pour l’échanger avec le spectateur. Son histoire, celle qui s’éparpille dans Inland, est celle qui ne se comprend pas, mais intrigue. Malek, personnage longiligne, dépassé par les évènements (familiaux ? Sociaux ? Politiques ?) et topographe de métier, traine inlassablement une carcasse dont le regard porte une signification quasi mystique. Malek vit au jour le jour, boit son café, fume quelques clopes et regarde le paysage qui s’étale devant lui tel une destinée qu’il ne peut contrôler (le veut-il réellement ?). Sa vie se situe quelque part entre deux rives, un clivage privé raté, même si son divorce s’avère un peu houleux, et une conscience professionnelle qui le ramène – parfois – à la vie. L’un de ses employeurs et amis (Ahmed Benaïssa, voix et prestance rocailleuses) lui donne une mission : préparer le terrain d’un coin perdu pour une éventuelle mise en place d'un système electrique. Un coin où, quelques années plus tôt, deux topographes français se firent égorger. Inland peut commencer !
Inland est une œuvre qui se perçoit. Caressant le doux sentiment de l’âme, Teguia va indubitablement laisser parler son ressenti, pour l’échanger avec le spectateur. Son histoire, celle qui s’éparpille dans Inland, est celle qui ne se comprend pas, mais intrigue. Malek, personnage longiligne, dépassé par les évènements (familiaux ? Sociaux ? Politiques ?) et topographe de métier, traine inlassablement une carcasse dont le regard porte une signification quasi mystique. Malek vit au jour le jour, boit son café, fume quelques clopes et regarde le paysage qui s’étale devant lui tel une destinée qu’il ne peut contrôler (le veut-il réellement ?). Sa vie se situe quelque part entre deux rives, un clivage privé raté, même si son divorce s’avère un peu houleux, et une conscience professionnelle qui le ramène – parfois – à la vie. L’un de ses employeurs et amis (Ahmed Benaïssa, voix et prestance rocailleuses) lui donne une mission : préparer le terrain d’un coin perdu pour une éventuelle mise en place d'un système electrique. Un coin où, quelques années plus tôt, deux topographes français se firent égorger. Inland peut commencer ! votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien





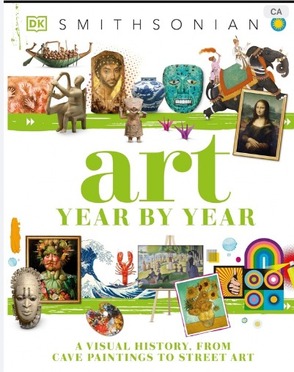




















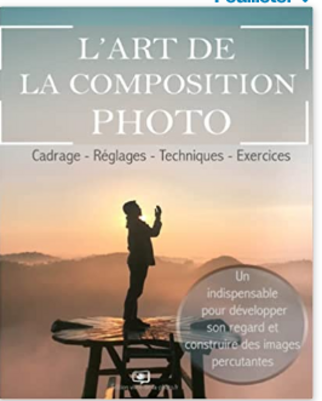







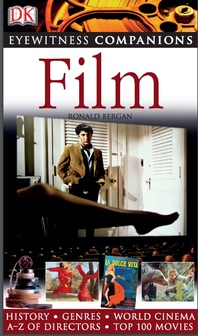





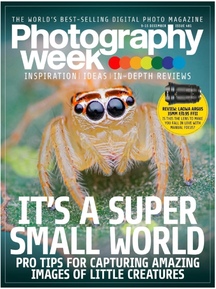



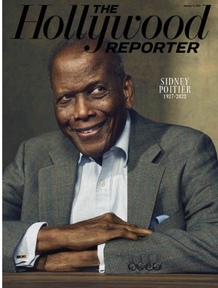








































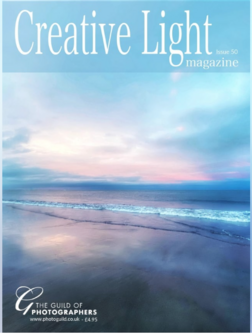

















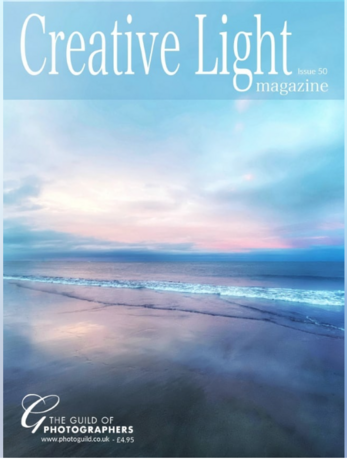


















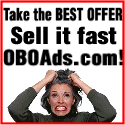
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot







