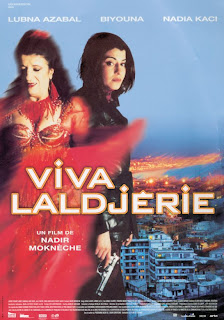-
Par hechache2 le 1 Novembre 2013 à 14:37
Le film Tarzan, Don Quichotte et Nous (Algérie-France, 2013, 18’) de Hassen Ferhani, a été sélectionné en compétition internationale du court métrage à Visions du Réel, le Festival international du cinéma de Nyon (Suisse), qui se tient à partir d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 26 avril.
Seul représentant de l’Algérie à ce rendez-vous de premier plan du film documentaire, ce film concourt dans une section comprenant 18 courts métrages provenant de seize pays, tous présentés en première mondiale ou internationale. En partant de sa participation au web-documentaire Un été à Alger (2012), Hassen Ferhani a réalisé ce nouveau court métrage qui mêle réalité et fiction, une approche qu’il affectionne particulièrement.
Du Jardin d’Essai à la grotte Cervantès, à travers le quartier du Hamma, c’est une balade inédite à la recherche de personnages attachés à la mémoire de ces lieux. On y rencontre Tarzan dont des scènes du film de Van Dyke furent tournées en 1932. On y croise Don Quichotte de la Manche, conçu lors de la captivité à Alger de son auteur. On trouve, dans un fast-food dédié au Chevalier à la Triste Figure, les réalisateurs Orson Welles et Terry Guilliam qui se sont efforcés de le faire revivre. On y découvre surtout les habitants attachants de cette partie de la ville pour lesquels l’adversité côtoie toujours le rêve. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 29 Octobre 2013 à 22:57
Commençons par le cinéma algérien qui naît, essentiellement, après l'indépendance des années 1960. Pendant la guerre, par l'absence d'image du côté des Algériens, comparée à celle des images officielles de l'armée française, est significative du déséquilibre du conflit entre les armées régulières d'un Etat puissant, et des maquisards. Les films militants, tournés du côté algérien, de René Vautier (L'Algérie en flemme) ou Yann Le Masson (J'ai 8 ans) sont soumis à la censure officielle et ne sont pas distribués en salles. Après l'indépendance de 1962, se voulant en rupture avec le cinéma colonial pour qui « l'indigène » apparaissait comme un être muet, évoluant dans des décors et des situations « exotiques », le cinéma algérien témoigne d'abord d'une volonté d'existence de l'Etatnation. Les nouvelles images correspondent au désir d'affirmation d'une identité nouvelle. Elles se déploient d'abord dans le registre de la propagande, puis, progressivement, dévoilent des « sujets » de société.
A l'origine du cinéma algérien, il y a cette question des films « vrais », « authentiques », celle de l'équilibre fragile entre la nécessité de raconter la vraie vie du colonisé et le besoin de s'échapper du ghetto identitaire construit par l'histoire coloniale. Entre sentimentalisme exacerbé et discours politiques, les premières histoires ont le mérite de rendre compte que les gens ne sont pas seulement en guerre contre un ordre ou soumis à lui, mais aussi se parlent et même se racontent des histoires personnelles. Dans les années 1970, Mohamed Lakhdar Hamina s'empare du thème avec Le Vent des Aurès, tourné en 1965, l'histoire d'un jeune qui ravitaille des maquisards, se fait arrêter, et que sa mère recherche désespérément dans les casernes, les bureaux, les camps d'internement. Décembre, sorti en salles en 1972, montre la capture de Si Ahmed et « interrogé » par les parachutistes français. Chronique des années de braise (palme d'or au festival de Cannes 1975) qui ne traite pas directement de la guerre d'indépendance, son récit s'arrêtant à novembre 1954, alternent les scènes de genre (la misère de la vie paysanne) et recherche d'émotion portées par des personnages fragilisés (une famille emportée dans la tourmente de la vie coloniale). Patrouille à l'Est d'Amar Laskri, (1972), Zone interdite d'Ahmed Lallem, (1972) ou L'Opium et le bâton, d'Ahmed Rachedi, sont autant de titres programmes qui, sur le front des images, dessinent le rapport que les autorités algériennes veulent entretenir avec le « peuple en marche ». Le cinéma algérien examine, fouille alors dans le passé proche, mais il n'y a pas d'image première de référence. Tout est à reconstruire à partir de rien. Quelque chose relève ici de l'insolence des pionniers, ceux pour qui tout n'est que (re)commencement. Cette image sans passé (il n'y a rien sur les figures anciennes du nationalisme algérien, de Messali Hadj à Ferhat Abbas, ou de Abane Ramdane à Amirouche) cache peut être aussi la hantise de se voir dévoré par des ancêtres jugés archaïques. Ce cinéma décomplexé vis-à-vis d'aînés peut donc avancer rapidement, et la production première de films sur la guerre d'indépendance est importante. L'absence de mélancolie apparaît comme une différence centrale avec les films français sur l'Algérie et la guerre, travaillés quelquefois par les remords, et la sensation permanente d'oubli.... Car il existe une perpétuelle sensation d'absence de films français de cinéma de fiction sur la guerre d'Algérie.
Pendant longtemps, chaque sortie en France d'un film sur la guerre d'Algérie était l'occasion d'un cliché journalistique obsédant, faisant retour de manière obsédante, perpétuelle : la non-existence de films de fiction traitant de cette séquence. Pourtant, pendant la période de la guerre elle-même, des cinéastes, et pas n'importe lesquels, ont essayé de fabriquer des films sur la guerre d'indépendance algérienne. Citons Alain Resnais, Alain Cavalier, Jacques Rozier et Jean-Luc Godard (Le Petit Soldat). Après les « événements » de mai juin 1968, d'autres cinéastes se sont lancés à l'assaut de ce morceau d'histoire très proche (cinq ans seulement séparent la fin de la guerre d'Algérie de 1968...) en essayant de montrer quelque chose. On citera René Vautier (Avoir 20 ans dons les Aurès), Yves Boisset (RAS), ou Laurent Heynemann (Le Question, une adaptation du célèbre livre d'Henri Alleg). Même Claude Berri s'est essayé à cette histoire avec Le Pistonné. Les années 80 et 90 sont également l'occasion d'une tentative de déploiement mémoriel par l'image avec les films de Philippe Garel, Pierre Schoendorffer, Alexandre Arcady, Gérard Mordillat, Gilles Béhat, Serge Moati et Pierre Delerive. Emerge à ce moment-là de façon remarquable un cinéma de femmes sur cette guerre avec les films de Brigitte Rouen (Outre-mer), de Dominique Cabréra (De l'autre côté de la mer) et de Rachida Krim (Sous les pieds des femmes).
De son côté, le cinéma algérien s'avance vers plus de complexité. Dans Les Sacrifiés, d'Okacha Touita, (1982), on voit la condition misérable des immigrés algériens en France, et, surtout, les terribles règlements de compte entre militants du FLN et du MNA. Avec Les Folles années du twist, de Mahmoud Zemmouri, (1985), le spectateur découvre l'insouciance d'une jeunesse algérienne dans la fin de guerre (le film se passe au moment de la signature des accords d'Evian de mars 1962), et les combattants de la « vingt-cinquième heure » qui s'apprêtent à rejoindre le camp des vainqueurs. Ces deux films, dans des registres très différents, adoptent un comportement de rupture avec l'unanimisme nationaliste qui régnait jusque là. Ils annoncent, sur le mode tragique ou humoristique, les « événements » d'octobre 1988, qui voient la jeunesse algérienne ébranler le système du parti unique. Ahmed Rachedi, dans C'était la guerre en 1993, n'hésitera plus à évoquer la violence interne du mouvement nationaliste (liquidations physiques dans les maquis). Mais la terrible tragédie qui secoue l'Algérie dans ces années 1990 va interrompre le tournage de films en Algérie. Le cinéma français, à ce moment, se « réveille » sur des questions touchant à l'histoire tragique vécue par les Algériens, avec deux films : Nuit noire, d'Alain Tasma, (2005) qui montre les massacres d'immigrés à Paris dans la nuit du 17 octobre 1961 ; et La Trahison, de Philippe Faucon, (2006), plongée dans les profondeurs de l'Algérie rurale. Avec la vie quotidienne de soldats sous l'autorité de jeunes officiers français, apparaissent des villageois algériens déplacés brutalement, éclatent les accrochages et les « interrogatoires », et circulent les sentiments de quatre « Français de souche nord-africaine », selon l'expression de l'époque. Ce beau film montre des soldats trop jeunes confrontés à choix difficiles, tragiques. votre commentaire
votre commentaire
-
Par hechache2 le 23 Octobre 2013 à 11:56
ALGÉRIE : TROIS CINÉASTES RACONTENT OCTOBRE 88
lun, 07/10/2013 - 17:42 Rafika GHERBI
Peu ou pas assez de choses ont été dites sur octobre 1988. Les Algériens, certains d’entre eux, n’ont d’ailleurs gardé qu’une certaine forme de nostalgie. Pour le combat de la jeunesse, on repasse, vingt-cinq ans après, par la case départ. Mais au cinéma, qu’en était-il ? Qui de ces hommes de culture avait osé braver les interdits infligés par les intégristes ou toute autre entité qui activait fortement pour l’effondrement d’une nation qui se complaisait dans son score de 1962 ?
D’Alger ou d’Algérie, les images qui nous sont parvenues depuis les événements d’octobre 1988 sont très rares. Aussi rares que le nombre de cinéastes qui ont fait abstraction de la peur et de la mort pour livrer au peuple un petit morceau de mémoire de cette tragédie au cinéma. Vingt-cinq ans après, un petit flashback s’impose du côté du 7e art ! Au nom du militantisme et de l’engagement de tous ceux qui ont raconté dans une quasi-clandestinité le drame algérien, au moment où le sabre barbare du terrorisme s’abattait sur les Algériens ou des hommes et des femmes payaient le prix fort de leur intérêt pour la culture. Retour sur trois productions cinématographiques qui ont marqué leur temps et le cinéma algérien.
Automne, octobre à Alger de Malik Lakhdar HaminaMalik Lakhdar Hamina a 30 ans lorsqu’il décide de tourner Automne, octobre à Alger. C’était en 1992. Une comédie dramatique en couleurs de 93 minutes qui reste à ce jour interdite de projection en Algérie ou du moins dans le cercle officiel de l’Etat. Dans le pitch, le réalisateur raconte le parcours ordinaire d’une famille vivant dans une misère sociale. La mère, Lala Kheira, veille au grain sur toute la tribu. Grâce aux prestations de son groupe de musique, Djihad, l’aîné de la fratrie, parvient à nourrir la famille. Sa femme, Amel, est animatrice à la radio. Son quotidien est un véritable combat pour améliorer la condition de la femme. Hakim, le frère barbu, son quotidien tangue entre la mosquée et la maison. Il ne sait qu’infliger des interdits à tout venant. Son épouse, Saïda, est plutôt du genre soumise. Elle lui obéit au doigt et à l’œil. Tout ce beau monde est entouré d’autres personnages, en particulier Momo, jeune « trabendiste » amoureux de Nawal (la cadette de la tribu), Zombretto, le clochard pour qui le rêve de l’indépendante tourne à la nostalgie et au cauchemar, et Ramsès, le frère du commissaire, qui fait la loi dans le milieu.
Dehors, l’écho de l’intégrisme et de l’intolérance se fait entendre. Le peuple n’en peut plus et c’est tous les symboles d’un Etat corrompu, despotique, arbitraire… qui volent en éclats.
Le 5 octobre 1988 éclate ! Les jeunes sortent dans la rue. Malik Lakhdar Hamina est présent. Sa caméra tourne les images d’une guerre qui ne dit pas encore son nom. La révolte populaire qui s’annonce est loin de tout ce que l’on pouvait imaginer à cette époque. Automne, octobre à Alger de Malik Lakhdar Hamina obtient, entre autres, le prix du Grand public au Festival méditerranéen de Montpellier (1992), le prix de la Communication interculturelle au Festival de Montréal (1993) et le prix de la Première œuvre au Festival de Carthage (1992).
Le Démon au féminin de Hafsa Zinaî KoudilUne femme au cinéma ! Fallait le faire à l’époque où les militants du FIS épousaient toutes les prostitués d’Alger pour les sortir de la rue. La femme devait rejoindre impérativement un quatre murs bien à l’abri du regard masculin et du reste du monde. Seulement voilà, toutes les époques ont leur revers et celle du FIS est bien celle d’avoir goûté à la force inébranlable d’une réalisatrice algérienne. Hafsa Zinaî Koudil voulait dénoncer elle aussi l’intolérance de l’intégrisme musulman. Et de cet engagement pour la femme est né son premier long métrage, Le Démon au féminin. Une production qui a été tournée entre 1992 et 1993 et qui retrace le destin d’une jeune enseignante, Salima, prise dans la tourmente des nouveaux idéaux de mari militant activiste du FIS. De cette nouvelle façon de penser, Salima n’en a cure, elle décide d’affronter la folie de son époux. Du coup, c’est toute la famille, y compris celle du parti politique, qui s’y met pour l’exorciser. La jeune femme serait possédée par le démon ! Le film montre l’obscurantisme dans toute la splendeur de sa forme « traditionnelle ». Le spectateur se transforme alors en témoin du cinéma de Koudil. Un cinéma actif, militant jusqu’au bout de ses principes, d’abord en tant que cinéaste et ensuite en tant que femme. De son film,
Hafsa Zinaî Koudil dira : « J’ai fait Le Démon au féminin pour attirer l’attention de la situation sur la femme en Algérie, voulue par les intégristes comme par certains qui se disent démocrates et progressistes. Je voulais dénoncer le fait que les femmes servent de boucs émissaires, parce qu’elles sont un pilier fondamental de la résistance, ce que les intégristes ont fort bien compris. » En janvier 1995, Le Démon au féminin obtient le Grand prix du public au Festival d’Amiens.
Bab El Oued City de Merzak AllouacheEté 1993, Merzak Allouache tourne presque clandestinement Bab El Oued City. Pendant ce temps-là, les assassinats d’intellectuels et d’hommes de culture font rage, en particulier dans la capitale. C’est là que le cinéaste algérien a décidé de planter son décor avec les moyens de bord. Bab El Oued City raconte sans équivoque l’intolérance portée par un islamisme extrémiste. Des Algériens confrontés à des Algériens. Une vraie malédiction ! De ce film, beaucoup retiendront la séquence du démontage du haut parleur de la mosquée. Une séquence qui a donné le ton à l’œuvre d’Allouache et qui représentera une symbolique très forte pour le cinéaste égyptien Youssef Chahine. Il confiera à Merzak Allouache : « Dans ton film, toute cette histoire de haut-parleur, c’est très fort. Quand j’ai vu ça, je me suis dit que tu avais trouvé un symbole incroyable. Car c’est vrai : ils nous imposent leur parole grâce au haut-parleur. L’appel du muezzin, autrefois, c’était quelque chose de beau. On savait si on était plus ou moins loin de la mosquée. Aujourd’hui, avec ces haut-parleurs, nous sommes tous à la même distance, tous réduits à ne plus répliquer. » En mai 1994, le film de Merzak Allouache, Bab El Oued City, reçoit le prix de la Critique internationale au Festival de Cannes.
Trois films, trois chapitres d’une histoire commune construite au lendemain des événements d’octobre 1988. Une date ô combien précieuse à l’évolution des mentalités et de la jeunesse algérienne ! Qu’avons-nous fait depuis ? Que s’est-il passé pour que l’histoire officielle reprenne le dessus et décide d’effacer des mémoires le sang versé par tous ces militants, femmes et hommes, engagés jusqu’au bout de leur vie pour que la liberté d’expression jaillisse et que la démocratie soit un jour en Algérie ?- See more at: http://www.mediaterranee.com/0712013-algerie-trois-cineastes-racontent-octobre-88.html#.UmeqHXBg_ag
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par hechache2 le 12 Septembre 2013 à 17:28
Cinéma colonial / désir illusoire
Par Soumeya MERAD
Il est vrai que nous pouvons véritablement définir le champ d’une littérature coloniale constituée à partir des différents récits de voyage sur l’Algérie, ou encore souvent évoquée dans les romans engagés, il n’en est moins pour le « cinéma colonial »
Le concept de cinéma colonial prend un aspect plus large plus complexe à travers l’Histoire, car la majorité des films durant les années trente retracent des aspects de la guerre d’Algérie mais dans lesquels l’Algérie colonisée reste absente.
Aujourd’hui nous abordons cet aspect du cinéma colonial avec tout ce qu’il peut engendrer comme embarras identitaires mais aussi ethnographiques.
Notre vision est loin d’être réductrice par rapport au cinéma bien au contraire si le roman relate la guerre par le biais d’images imaginaires et la mémoire individuelle, le cinéma lui nous offre ces images et réanime en nous cette mémoire collective, mais ce serait intéressent pour nous c’est de voir comment cette image est véhiculée, comment s’offre-t-elle aux spectateurs. Pendant, juste et après la guerre de libération et de nos jours.
Nous abordons aujourd’hui la notion de mémoire collective car il est évident que nous ne pouvons extraire la notion de film colonial, de la mémoire collective ; liée à son Histoire, le cinéma algérien a toujours emprunté le même parcours que la littérature des années 50, une relation presque inextricable et parfois indispensable par rapport à une mémoire individuelle mais collective du peuple algérien qui proscrit l’idée de l’oubli.
Revenons au cinéma colonial, il est clair que les cinéastes ont toujours œuvré dans un triptyque indispensable : il s’agit d’un cercle une sorte de machine cybernétique[1] qui lie le cinéma à l’Histoire et à la mémoire.
Inconsciente ou recherchée, l’Histoire de l’Algérie est omniprésente dans les romans, les nouvelles sur les écrans pour dire transmettre ou juste faire rappeler un événement. Nous voudrions justement à travers cette contribution réfléchir sur le lien inévitable existant entre cinéma/ Histoire colonial / pour ainsi dire cinéma français /cinéma algérien.
C’est pourquoi notre intervention interrogera les lieux dits du cinéma colonial, à commencer par Pépé le Moko et bien d'autres films qui ont accompagné la colonisation. Quel regard portent-ils sur la société autochtone? Comment mettent-ils en scène les images de personnages "indigènes"? Comment justifient-ils la colonisation? C'est autour de ces questionnements que s'articulera notre texte qui fera aussi la relation du cinéma avec le roman colonial et les enjeux fondateurs de cette expérience cinématographique. D'autres interrogations se dégageront de notre problématique qui investira les contours définitionnels du cinéma colonial tout en insistant sur l'impact de ces images sur le cinéma d'aujourd'hui. Ainsi, prendra-t-on également un des points d'illustration le film, L'ennemi intime.
Le cinéma colonial révolution française et société autochtone /Abdelkader Benali[2] définit le cinéma colonial non pas comme un mode d'appréhension d'une réalité objectivement perçue mais comme un mode d'appropriation de celle-ci.
Nous partageons cet énoncé définitionnel de Abdelkader Benali, d’abord parce que le cinéma colonial s’est réellement approprié une réalité subjectivement parlant en en créant l’illusion du rêve exotique. Et ce, nonobstant les différentes intrigues des films qui s’inspiraient des romans coloniaux, qui n’influent aucunement sur l’imagination des cinéastes bien au contraire l’aspect des populations et les décors, était purement inspiré par le désert. Et tout cela dans un but de créer l’engouement des spectateurs. ce fait cette attirance envers ces films devint tel que les producteurs français se tournaient vers cette attraction cinématographique mettant à profit leur expérience précédente. Ils passèrent dans l’urgence du film documentaire au film colonial ; ce qui nous pousse à constater que le « cinéma colonial », depuis ses débuts, imbrique inéluctablement divertissement, intérêt scientifique mais surtout propagande.
Il est à souligner ainsi que faire un film sur des environnements sociaux et culturels nommées et étiquetés d’ « exotiques »[3] entraîne inévitablement un traitement de l’image asservi à la domination c’est ce qui nous renvoie d’ailleurs à la notion définitionnelle de Abdelkader Benali énoncée au début de notre intervention.
La part prise par le cinéma français des années 30 dans la vision que les colons se forgeaient de leurs propres colonies fut si remarquable, que les images remplissaient déjà toutes les têtes : la photographie influençait la littérature et la presse, elle suscitait des débats passionnés, qui favorisaient et applaudissaient la puissance de l’idée de la colonisation et sa légitimité, car placée sous le signe de « la mission civilisatrice »[4], cette vision était si bien fonctionnalisée et dominée donc maitrisée qu’elle emportait l’adhésion réduisant ainsi l’histoire d’une guerre à celle d’une révolution justifiée. Le cinéma était donc ici vécu comme une sorte de légitimation de la colonisation.
I-1 la propagande des images
L’image prend de ce fait la part du lion et ce dans un souci visant à nier l’histoire et la culture algérienne. Cette perspective est doublement marquée par le désir de surpasser l’indigène dans les domaines où il excelle : l’héroïsme avorté, la réputation de dévouement familial des femmes algériennes présentées comme soumises.
Ce tableau nous donne à voir que les films consacrés à la colonisation n’ont bénéficié que d’un traitement marginal qui les a conduit pourtant à les inclure dans l’histoire générale du nouvel art. C’est ainsi que ces films ont continué, malgré un long mutisme, à agiter les imaginations et à conserver une grande puissance de suggestion alors même que le colonialisme a perdu sa position d’autorité. Cette image de propagande était si bien conçue qu’on ne parlait plus d’image proche du réel mais d’image réel[5]
En effet si le domaine de l’écrit, la littérature, compte pour beaucoup dans la fabrication des imaginaires. L’image cinématographique à elle seule nous offre ce rapport presque concret au réel.
La technique était celle de polariser la caméra sur le colon français en tant que révolutionnaire positif, le regard est dès lors centré sur le héros français et efface de ce fait toute tentative de valorisation des combattants algériens[6] produisant ainsi chez le spectateur ce sentiment de sécurité, permettant d’éviter l’anarchie et le désordre. Cette expansion de la domination coloniale provoque d’emblée l’envie d’aller à la découverte de terrains de plus en plus lointains et offre aux cinéastes l’occasion d’assouvir leur curiosité tenace envers ces peuples d’indigènes. Donnant ainsi l’impression au premier concerné le spectateur, la glorification de cette révolution.
Tous ces films durant les années 30 offraient une multitude d’images qui acquiert une importance primordiale et une fin en soi qui vise néanmoins à effacer toute idéologie et toute valeur morale. Pour devenir en catimini une arme de propagande dont la fonction consiste à animer la ferveur « nationale » et à soutenir les efforts de la mobilisation française.
Il est à constater que devant cette seule alternative qui s’offrait à lui , Le cinéma colonial français procède, par surcharge ; il multiplie les péripéties et fait le choix d’appuyer le jeu des acteurs dans l’idée de dresser des portraits psychologiques à travers l’apparence physique de cet autre (indigène) .
Pourtant, devant cette insistance de ces films de propagande , nous enregistrons des films qui sont plus ou moins de l’autre côté de la propagande : citons à titre d’exemple ces films pendant la guerre, qu’on pourrait qualifier de cinéma militant ; il s’agit en outre d’un cinéma militant qui lutte contre le refoulement de l’oubli , au moment même où l’acte de révolution touche à sa fin. Allant de l’allusion à de Louis Malle dans 'Ascenseur pour l'échafaud' (1958) à l’afirmation dans 'Adieu Philippine'(1960) de Jacques Rozier, 'Le Petit Soldat'(1960) de Jean-Luc Godardet 'Le Combat dans l'île'(1961) d'Alain Cavalier.
Nous constatons ici et là un arrêt, une sorte de halte qui permet de voir cette révolution autrement loin du cliché de « mission civilisatrice » , un effacement presque total de l’ image positiviste de la révolution .
Godard faisait partie de la sphère de cinéastes différents et humanistes, soutenu par cette nouvelle vague de cinéastes, Godard dans Le petit soldat affiche sa détermination à dénoncer les actes de torture dont témoignent les soldats qui ont déserté, offusqués par la réalité du réel. Nous remarquons ici une folle envie de la part du réalisateur d’aller au-delà de la fausse réalité tant enjolivée par les discours bien-pensant de journaux, mais surtout des publicités qui survenaient, rappelons- le , à la fin de chaque film dans les salles de cinéma à l’époque.
Mais comme nous l’avions souligné peu avant, il s’agit ici d’un effacement presque total, ce qui explique d’ailleurs l’arrêt de ces films. Rozier et Godard, deux grands cinéastes, très courageux, anticonformistes, ont vu la sortie de leur film retardée de trois ans.
Dans le même registre, mais exprimant un peu plus les désarroi d’une jeunesse non convaincu par cette dite révolution , Agnès Varda Dans 'Cléo de 5 à 7'(1962) montre cette jeunesse française figée dans la peur d'être enrôlée dans un conflit dont elle se sent étrangère. Le film d'Alain Resnais'Muriel' (1963) quant à lui tente courageusement et un peu timidement d'éveiller l'opinion sur les traitements infligés aux jeunes filles. De son côté, Jacques Demy nous montre un personnage qui revient d'une Algérie meurtrie et ensanglantée dans 'Les Parapluies de Cherbourg'.
C’est ainsi et ce n’est qu’après la fin de la guerre qu’on commence alors à véritablement prendre conscience des réalités guerrières, des enjeux politiques et de la colonisation .
Essayons d’expliquer le pourquoi de cet effacement voulu mais non exhaussé des cinéastes , nous l’avons bien vu que même face à ce cinéma militant , la censure étatique était inévitable , ne pouvant le dire clairement , la France trouva alors une façon de régner ; c’est sous le prétexte de la protection de l’enfance que ces films ont été ou bien interdis ou alors censuré . À l’époque il fallait trouver n’importe quel moyen pour faire face au soulèvement de ces films dit militant.
C’est alors que les films de Rozier, Cavalier, Resnais et Godard furent interdits et ne sont sortis qu’après 1962. L’image de la propagande a duré grâce à l’effacement de la guerre pendant la guerre elle-même.
En fait, la France voulait avec ces interdictions, l’explosion de l’autocensure , de peur de ne pas voir leurs films sur les écrans, les cinéastes ne pouvaient que revoir leurs images de guerre à la baisse ; mais une absence d’images ne fait qu’amalgamer l’opinion publique et ne suffira jamais à tout expliquer.
Comment s’est faite cette autocensure ? Il s’avère que tous les films existants ne montrent pas vraiment la guerre d’Algérie. Les cinéastes évoquent ce qui se passe avant et après, mais jamais pendant la guerre. Les soldats partent pour le conflit ou reviennent de ce territoire traversés par la tragédie. Ils portent en eux un traumatisme qui ne dit pas son nom, une blessure intérieure très forte . Ce mouvement de feed-back laisse apparaitre ou deviner une guerre souvent traumatisante pour ces soldats. Les films de cette première période ainsi que ceux des périodes suivantes, qui exprimeront sans cesse cette fissure. Il disent une guerre interdite[7] sur le mode de la blessure personnelle, intime, à cause d’une censure et d’une autocensure forcée . ces cinéastes ne parvenaient pas à s’exprimer dans un espace public plus large. Leurs films apparaissent comme des films intimistes[8].
Nous l’avons compris ; le cinéma de la période 1958-1968 montre des situations de refus de guerre. Et il participe à la reconstruction mythologique du refus massif de la guerre coloniale.
Ce refus de la guerre est accompagné par le refus de celui-qui fait cette guerre ; revenons un peu à cet « indigène », l’Algérien est absent. Absence remarquée par l’absence même de l’espace-lieu dans l’Algérie réelle, car les décors reconstitués de ces films ont été réalisés au Maroc et en Tunisie. L’absence d’Algérie participe massivement dans cette déréalisation[9] de la guerre montrée .
Les villes algériennes sont absentes ; elles n’apparaissent pas. La caméra est souvent posée dans des lieux désertiques. « Le cinéma est dès lors pas seulement affrontement idéologique possible autour de la conduite de la guerre, mais il est aussi affaire de passions, d’espaces authentiques, de paysages vrais »[10].
Comme nous l’avions souligné sous le signe de la censure pour la protection de l’enfance, l’image ou plutôt l’absence du corps, des cadavres est perceptible. Le spectateur ne voit pas le « cadavre » de la guerre d’Algérie. Les cinéastes ne font pas corps avec la guerre (processus différent au 21è siècle avec l’ennemi intime, nous y reviendrons). Avant d’aborder les films du vingt et unième siècle, essayons de revoir ce qui est arrivé au cinéma français cinq ans après l’indépendance.
En 1968, les blessures de la guerre sont toujours présentes ; d’autres cinéastes se sont lancés à l’assaut de ce morceau d’histoire très proche. Mais cette fois en dénonçant l’entreprise coloniale. Une panoplie de films ; toute une décennie de dénonciation, comme assoiffés , les cinéastes se retournent , réalisent et scénarisent ce qui leur été interdit pendant la guerre . Les cinéastes osent et interpellent des images tant attendues pour dire une parole enfouie et humaniste.
Mais obtenir gain de cause pour ces défenseurs du réel reste inaccecible ; car autoriser ces films remettrait en question toute l’entreprise coloniale . de ce fait « Avoir 20 ans dans les Aurès » (1972) de René Vautier, n’obtiendra son visa d’exploitation qu'au prix d'une grève de la faim, tandis que R.A.S d'Yves Boisset fut interdit aux moins de 16 ans lors de sa sortie en salle. Mais Boisset a dû faire face à tout un de son tournage par ses financements bloqués.
Laurent Heynemann et Michel Drac ont eux aussi essayé de faire voir la réalité de la guerre dans leur cinéma militant avec respectivement (La Question 1977, une adaptation du célèbre livre d’Henri Alleg). De Même Claude Berri s’est essayé à cette histoire avec Le Pistonné.
Ainsi le cinéma populaire français était à la veille de connaître son âge d’or grâce à la guerre des images ; qui ne justifie plus cette pénétration coloniale qui se présentait comme nécessaire.
Pépé le moko ce désir illusoire
Nous avons mis l’accent sur ce film qui, durant le période de la colonisation, a essayé de démontrer d’une manière subversive la réalité de la vie en Algérie. Familier de l’Afrique du Nord, Julien Duvivier change alors de palette. Il abandonne le bled pour la ville et la caserne pour la Casbah d’Alger où il situe son histoire policière : Pépé le Moko (1937) qui « entra dans la légende ».
Pourquoi avons-nous choisi Pépé le Moko (1937) ? ce film est assurément un film qui opère une rupture, toute relative, avec l’idéologie qui domine le cinéma colonial même si les jeux ne sont pas dits clairement ; articulant sa double démarche sur tantôt « l’œuvre bienfaitrice » de la colonisation, tantôt sur la nécessité de « civiliser les indigènes »[11] et inévitablement implanter la religion catholique dans les colonies.
Ce film investit du terrain : ce qui reste remarquable et nous pousse à voir de plus près ce film, c’est incontestablement le changement du cadre spatio-temporel, toujours est-il et comme nous l’avions annoncé il opère d’une manière subversive, car on ne s’est réellement si ce film est le début d’une prise de conscience, ou juste d’un hyperbole qui fait vendre ?
Cependant revenons aux changements remarqués dans cette œuvre cinématographique pour pouvoir établir et mettre en relief la différences des images mais surtout de l’espace voyons comment le « film colonial » opéré jusque là, en effet les différents films qui obéissait aux louanges de l’entreprise coloniale obéissaient à trois principes directeurs : (l’absence de l’image du colonisé ; l’amplification de l’image du désert et la quasi-absence de temps diégétique ) ces trois principes fonctionnent comme suit :
- Le fonctionnement du vide.
- la sanctification de l'espace colonial par un enracinement dans une culture latine ou mythologique ayant pour fonction de légitimer historiquement et culturellement la présence du colon, l'installation du Maghreb dans une dimension historique décalée par rapport à l'Occident.
- La vision du désert, exclusive de tout repère architectural, peut se concevoir comme le premier signe définissant le territoire colonial.
- Le temps et l'espace sont réunis dans une même approche épistémologique du vide.
- Le vide fonctionne dans les films coloniaux sur des registres aussi bien esthétiques que dramatique, symbolique et politique. le vide est ce qui ne contient rien de perceptible, qui est sans occupant.
Le spectateur est ainsi introduit, accompagné en cela par le colon, le militaire ou le missionnaire, figures diégétiques, « dans l'essence propre de l'acte colonial en tant qu'appel plutôt qu'intrusion volontaire »[12]
D'un lieu immobile et mystérieux, le désert acquiert les caractères d'un espace de projection dans lequel le héros colonial justifiera sa condition en dépassant ses propres limites.
Tandis que dans pépé le moko, l’espace a changé le contrat relatif au vide est rompu . Slimane et Pépé sont deux figures inséparables, complémentaires. Dans l'ouvrage précité, les auteurs ont apporté la démonstration de ce que Slimane « cristallise la perturbation provoquée par la Casbah »[13] Slimane porte sur lui « une étrangeté raciale dérangeante, contredite par sa place et ses fonctions dans le monde européen » [14]Quant à Pépé le Moko, son nom même à connotation étrangère, marque sa marginalité et justifie dans une certaine mesure son inscription dans l'espace de la Casbah.Face à cette occultation de l’histoire et la séparation, entre l’Algérie la France dans l’espace et dans le temps et de ce fait idéologiquement parlant ; Pépé le Moko offre une approche plus subtile où le va-et-vient entre le monde européen et le monde arabe ponctue le récit. Interlocuteur privilégié de Pépé, Slimane est peu à peu contaminé et provoque l'incursion métaphorique du Double. Ainsi la phrase suivante prononcée par Slimane à l'adresse de Pépé qui, par dérision, l'invitait à lui passer les menottes alors qu'il était au café : « Non, Pépé. Je t'arrêterai seul, à mains nues, sans accessoire. C'est déjà écrit » s'inscrit dans cette lecture d’adhésion et d’accord entre les deux personnages.
Revenons à la vision de Abdelkader Benali concernant l’image de l’indigène : la relation des deux personnages pourrait être envisagée « sous une lumière proprement coloniale, en effet ces deux personnages pourraient éventuellement être des images du colon et du colonisé »[15] et voir l’acharnement de Slimane contre Pépé ; Le combat qu'il mène contre Pépé s'inscrit dans un jeu emblématique qui consiste à piéger ce dernier.
Le personnage de Pépé quant à lui est englouti dans la matrice identitaire de l'occupant assiégé par l'occupé. Il suffit de se référer à la séquence finale où la Casbah, présentée comme lieu d'enfermement, se trouve métaphorisée par des barreaux, ceux de la grille du port ouvrant sur la liberté.
Slimane, pour sa part, ne cesse de s'extraire du groupe des policiers. Slimane est bien la figure renversée de Pépé, tous deux unis dans la même absence de fondation ; entre Pépé, le Blanc et Slimane, le bâtard.
Pépé le Mokoaborde cette dichotomie : dominants/dominés. Si bien qu’il s'inscrit difficilement dans le filon des « films coloniaux » Et ce devant l'échec de la politique coloniale française sous-jacente qu’il véhicule.
Ce film fut immédiatement comparé à Scarface d’Howard Hawks dont il a la virtuosité dans l’enchaînement des plans et peut-être aussi un même rapport aux lieux clos. Mais ce qui différencie cette œuvre qui connaît un « succès prodigieux » de la précédente c’est qu’elle néglige l’anecdote au bénéfice d’une esthétique singulière où l’usage de l’obscurité transfigure un quartier paisible, la Casbah. Aussi la typologie contrastée offerte ici et là dans les ruelles lugubres et sombres de la haute ville et les immeubles imposants de la ville européenne dont la blancheur ce qui nous conduit involontairement à constater cette disjonction spatiale qui s’est installée subitement à Alger. Enfin, la distribution des personnages utilisés à contre-emploi qui explose en plein écran.
Même si ce film fait l’exception, toujours est-il que majoritairement parlant, les films consacrés à la colonisation durant les années trente œuvraient et évoluaient dans le sens d’un « durcissement de l’image[16]. Au point que la majorité de la population — les indigènes — a perdu son pouvoir symbolique pour finir par disparaître des écrans ou, dans le meilleur des cas, subir une « vision bloquée » qui les nie.
Hormis l’objectif de promouvoir l’entreprise coloniale, l’autre objectif de ces films était celui de créer un espace fictionnel permanent et stable dans lequel les personnages auront à se mouvoir avec l'espoir de s'en échapper.
Abdelkader Benali démontre que le lieu maghrébin n'existe que « dans un système de représentation que le Français est le seul à détenir »[17]
Le cinéma français : le retour
Le début de la fin de la propagande
Après des années, Le cinéma français, à ce moment, se « réveille » sur des questions touchant à l’histoire tragique vécue par les Algériens, c’est le début de la fin d’une propagande, avec La Trahison de Philippe Faucon (2005-2006). En effet le décor change le désir de décrire cette réalité semble être le souci primordial des cinéastes français. Avec La trahison : Des soldats sous l’autorité de jeunes officiers français sont plongés dans les profondeurs de l’Algérie rurale : apparaissent des villageois déplacés brutalement ; éclatent les accrochages et les « interrogatoires ». Ce film de Philippe Faucon montre des soldats trop jeunes confrontés à des choix difficiles, tragiques le processus de la prise de conscience semble être engagé , l’absence du vide est absente pour ainsi dire .
La représentation des colonisés a changé ,il ne s’agit plus d’indigènes mais d’Algérien musulmans , qui d’ailleurs apparaissent comme des acteurs à part entière de cette Histoire, des êtres humains, mais surtout qui souffrent, qui sont trahis, qui doutent et qui se battent. La vraie rupture se situe là, dans cette émergence de la figure du colonisé[18] (Benali, 1998).
Les plans de ce film évoquent les photographies prises par Marc Garanger en 1960, alors soldat du contingent. Philippe Faucon montre dans son film la misère des populations rurales déplacées et filme les cadavres, les hommes de l’ALN abattus par l’armée française au cours d’un accrochage ; un aspect qui jusque là n’a jamais été évoqué dans le cinéma français et ce même si Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad (1964). L’ont décrit, il s’agit de la vraie Histoire de l’Algérie, un déplacement de près de deux millions de ruraux qui se termine tragiquement dans un bain de sang.
La guerre est bien là, terriblement présente aussi, et surtout dans les campagnes. La vérité des postures, des gestes des jeunes soldats et des paysans doit sûrement beaucoup au coscénariste du film, Claude Sales, qui fut jeune lieutenant dans le djebel avant de devenir un grand journaliste (Sales, 1999).
Un autre film, celui de Laurent Herbiet, Mon colonel, raconte, également l’histoire d’un jeune soldat pris dans la tourmente algérienne en 1957. Année terrible de la « bataille d’Alger », du passage à l’action urbaine pour le FLN, de la généralisation de la torture et de la crise profonde de la gauche au pouvoir. Le film montre tout cela avec force, à partir du présent : une jeune femme soldat mène l’enquête sur l’assassinat d’un colonel en retraite qui a dirigé une unité dans le Constantinois. Les scènes de guerre, les débats de l’époque au sein de l’armée ou l’attitude du pouvoir politique sont montrés de manière remarquable.
Dans la même optique le film de Mehdi Charef, Cartouches gauloises, sorti en salles en août 2007 est de ceux qui ne vous quittent plus, longtemps après la projection, avec les visages des acteurs qui reviennent sans cesse et les situations qui vous emportent dans une puissante émotion. Algérie, printemps 1962. La fin de la guerre d’Algérie est terrible. Les Français d’Algérie, les « pieds-noirs », commencent à quitter le pays. Les maisons se vident. Ali, 11 ans, fils d’un responsable de l’ALN, et son copain Nico assistent aux prémices de l’indépendance. La violence est terrible et omniprésente, leur amitié est condamnée…
Violence aussi, et même hyperviolence, dans L’Ennemi intime de Florent-Emilio Siri…Musique grave et paysages grandioses, bruit sourd des hélicoptères qui emportent des blessés et longue file de soldats épuisés dans le djebel, foules villageoises martyrisées… On se dit que cette fois, avec L’Ennemi intime, le cinéma français a pris à bras le corps le sujet « guerre d’Algérie ». Nous nous trouvons là dans un univers où se déploie en permanence une extrême brutalité. Le film met l’accent sur la tromperie de la colonisation, la cruauté des hommes, dévoile les désirs inconscients des personnages, sur des actes de barbarie insoutenables, en une langue cinématographique très charnelle, « physique », proche des films américains sur la guerre du Vietnam dans les années 1980 ou des films de Quentin Tarantino dans les années 1990…
L’action du film de Florent-Emilio Siri se situe en 1959 en Kabylie, l’année des grandes opérations de l’armée française contre les maquis algériens (le plan Challe). En Algérie, en 1959, un lieutenant idéaliste se retrouve affecté en Kabylie. Au fil des semaines, témoin et acteur de la guerre, il va lentement changer.
En Algérie, en 1959, en Kabylie, les opérations menées par l'armée françaises'intensifient au fil des mois. Le jeune lieutenant Terrien arrive de la métropolepour prendre le commandement d'une section basée dans le secteur. Il y fait la connaissance du sergent Dougnac, soldat de métier désabusé qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de ce jeune homme idéaliste. Les diverses missions et les pénibles conditions de vie au camp exacerbent les différences entre les deux militaires. Au fil des semaines, pris dans une guerre qui ne dit pas son nom, témoin d'exactions et de massacres. Le film aborde de nombreux aspects de la guerre d'Algérie, notamment l'emploi de la tortureet l'utilisation du napalmpar l'armée française, les exactions commises envers les civils au nom de l'exemple ou par mesure de répression, le rôle des vétérans algériens de la Seconde Guerre mondiale décriés par leurs compatriotes indépendantistes, les exécutions sommaires de combattants algériens maquillées en tentatives d'évasion, la désertion et le doute chez les militaires français dont certains ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils se comportent comme l'occupant allemand qu'ils ont précédemment combattu[19].
On y voit l’affrontement entre deux hommes, un lieutenant idéaliste joué par Benoît Magimel et un sergent désabusé incarné par Albert Dupontel, adoptant la nonchalance de celui qui a tout vu et qui n’en peut plus. Il porte sur lui-même, avec d’autres officiers, les marques de son humanité et de sa monstruosité. Enchaînant sans répit des séquences trop violentes, le montage affaiblit le propos. Toutes ces abominations mises bout à bout donnent une idée absolument terrifiante de la guerre d’Algérie.
DeLa Trahison à L’Ennemi intime, s’ouvre l’ère d’un questionnement plus mûr sur la l’Histoire de l’Algérie : s’agit-il d’une guerre ou de révolution ? Comment représenter cet événement sans en faire un spectacle dénué de sens ? Comment sortir des faux documentaires, et de la propagande implantée dans la mémoire des spectateurs ? Comment représenter une « guerre » sans la reconnaitre officiellement ?
Force est de constater qu’avec le temps, l’événement « guerre d’Algérie » commence à s’imposer. Devant ces changements la guerre de libération se donne à découvrir.
Il y a forcément un manque à combler, tout n’a pas encore été dit sauf par le biais des personnes ayant vécu les atrocités de la colonisation, si de leur côté les cinéastes algériens ont essayé de répondre au cinéma colonial, il est cependant nécessaire de souligner que de nombreux français, jeunes et moins jeunes, attendent de voir d’autres images, des images proches du réel, des images vraies authentiques.
 Bibliographie : œuvres et articles :
Bibliographie : œuvres et articles :· ABDELKADER BENALI, Le cinéma colonial au Maghreb. Eddu Cerf, Paris, février 1998.
· Abdelkébir Khatibi, Maghreb pluriel, Paris, Denoël, 1983.
· Abdou Benziane « Alger au cinéma, de Pépé le Moko à Bab-el-Oued City », La pensée de midi 1/2001 (N° 4).
· Abdelghani Megherbi, Les Algériens au miroir du cinéma colonial, édition SNED, Alger, 1982
· Ahmed LANASRI : LA LITTERATURE ALGERIENNE DE L'ENTRE-DEUX GUERRES: GENESE ET FONCTIONNEMENT Extrait de la revue Itinéraires et contacts de cultures, Paris, L'Harmattan et Université Paris 13, n° 10, 1° semestre 1990.
· Ahmed Cheniki, « Le cinéma, les béquille et le futur antérieur », in le quotidien L’Expression, Alger ,10 décembre 2006.
· Abdou Benziane : Le cinéma algérien : de l’Etat tutélaire à l’état de moribond en ligne
· André Picciola,Missionnaires en Afrique : 1840/1940, Denoël, Paris1987.
· Benjamin stora la guerre d’algérie dans les médias « l’exemple du cinéma » in Hermes 52, 2007
· Guy Hennebelle in « Algérie de la lutte de libération nationale à la révolution agraire » in Les cinémas nationaux contre Hollywood, Cerf-Colet, Paris, 2004
· Jacques Choukroun « Le Cinéma depuis l’Indépendance » in Les cahiers de la cinémathèque, Algérie d'hier et d'aujourd'hui, Perpignan,Ed. Institut Jean Vigo, n-76, Juillet 2004
· Jeanne Baumberger « la permanence berbère » in CinémAction, Cinémas du Maghreb : quelques échos du front, Paris, Ed.Corlet-Télérama, n-111, 2ème trimestre 2004
· Lotfi Maherzi, Le cinema algerien : institutions, imaginaire, ideologie / Alger : Societe nationale d'edition et de diffusion, [1980]
· Merzak Allouache, interview in African Conversations (Londres : BFI, 1995
· Mouny Berrah, « Algerian Cinema and National Identity », in Alia Arasoughy (dir.), Screen of Life: Critical Writing from the Arab World (Québec: World Heritage Press, 1996):
· Moumen Smihi, interview, in Mouny Berrah, Victor Bachy, Mohand Ben Salama & Ferid Boughedir (dir.), Cinémas du Maghreb, Paris: Cinéma /Action n-14, 1981
· Rachid Boudjedra, Naissance du cinéma algérien, Paris: François Maspero, 1971.
· Youssef Ishaghpour « la réalité de l’image à l’image de la réalité, Le cinéma, Paris, Flammarion, 1996.
· Youssef Ishaghpour, Le Cinéma, Histoire Et Théorie, ED Farrago2006
· Yves Monnier, L’Afrique dans l’imaginaire français (fin du XIXe - début du XXe siècle), L’Harmattan, Paris 1991.
.
[1] Roland Barthes
[2] Abdelkader Benali, Le cinéma colonial au Maghreb. L'imaginaire en trompe-l’œil (Ed. du Cerf,1998)
[3]Benjamin stora la guerre d’Algérie dans les médias « l’exemple du cinéma » in Hermes 52, 2007
[4]Jules Ferry invoque dans un discours demeuré célèbre la mission civilisatrice de l’hexagone, affirmant que « les races supérieures » ont « le devoir de civiliser les races inférieures »
[5] « la réalité de l’image à l’image de la réalité Youssef Ishagpour, Le cinéma, Paris, Flammarion, 1996....
[6] Un fellaga ou fellagha est un combattant tunisien (1952-1956) ou algérien (1954-1962) entré en lutte pour l'indépendance de son pays alors sous domination française
[7] Car pour la France il s’agissait d’une mission et non d’une guerre
[8] Benjamin Stora Inalco et Université Paris VIILA GUERRE D’ALGÉRIE DANS LES MÉDIAS :L’EXEMPLE DU CINÉMA
[9]Ibid stora
[10]Ibid stora
[11] Les missions chrétiennes ont très tôt tenté de s’implanter en Afrique. Les missionnaires furent d’ailleurs parfois les premiers Européens à pénétrer dans certaines régions de ce continent. Dès la fin du XVIIIe siècle, des sociétés de missionnaires protestants commencèrent à voir le jour en Angleterre, tandis qu’en France les premières institutions missionnaires catholiques furent créées à partir de 1820. Leur objectif affiché était de lutter contre l’esclavage et la traite, ainsi que de former des églises locales en Afrique. Mais c’est surtout à partir du milieu du XIXe siècle que se développèrent les principales sociétés missionnaires telles que les missions africaines de Lyon, ou plus tard celle des Pères Blancs, en 1868. Tandis que jusque-là les tentatives d’évangélisation des missionnaires s’étaient globalement révélées infructueuses, la course engagée par les pays européens pour la conquête coloniale permit aux missions de se développer.( source/ article : la mission civilisatrice ou la construction d’une certaine image de l’Afrique sur fond d’idéologie coloniale source /LDH-Toulon)
[12]Abdelkader Benali, op cit p 96
[13]Abdelkder benali op cit P1610 La page 168
[14]idem
[15] Ibid
[16] François Chevaldonné,op cit
[17] idem
[18] Abdelkader Benali : Ibid
[19] Synopsis et thématique du film source : l’encyclopédie Wikipédia
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Cinema Algerien




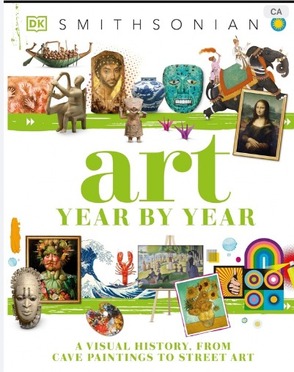




















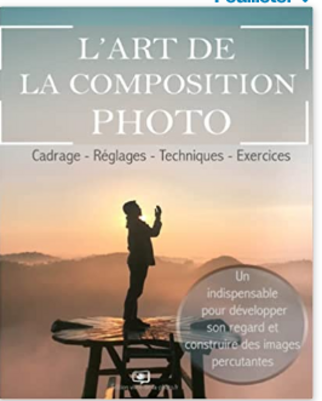







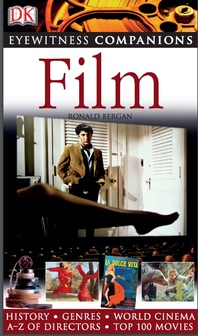





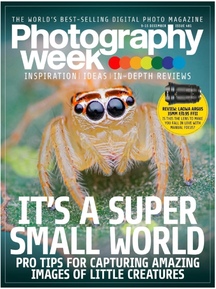



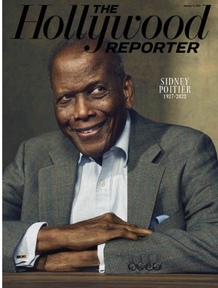








































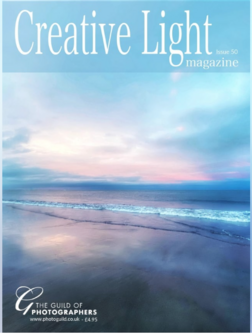

















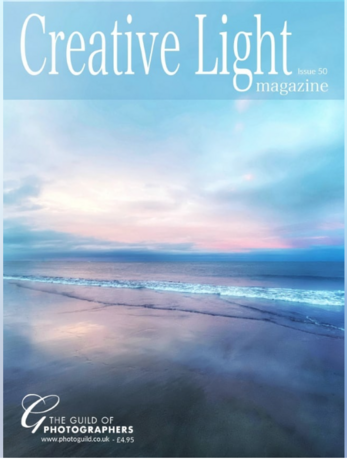


















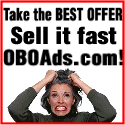
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot