-
10ÈME COUP DE PROJECTEUR EN KABYLIE
10ÈME COUP DE PROJECTEUR EN KABYLIE
10èmes Rencontres cinématographiques de Béjaïa
du 9 au 15 juin 2012
Festivals-Expos > 26 juin 2012
Les Rencontres cinématographiques de Béjaïa, organisées par l’association Project’heure, ont dix ans cette année. Dix ans qu’une équipe de bénévoles formidable travaille d’arrache-pied pour inviter le cinéma en Kabylie où, comme dans le reste du pays, ce dernier ne fait plus partie du quotidien de la majorité des gens. Depuis la décennie noire des années 1990, les salles, les ciné-clubs se comptent sur les doigts de la main, l’enseignement du cinéma fait cruellement défaut et les critiques cinéphiles sont rares. Qu’elle est précieuse, donc, cette opportunité créée en 2003 par Project’heure et son président Abdenour Hochiche ! Il n’est pas étonnant que, sur la place du 1er Novembre 1954 sur laquelle se trouve, en sous-sol, la Cinémathèque de la ville, certains Bougiottes (les habitants de Béjaïa), qui y passent de longues heures, au café ou à regarder le port depuis la balustrade, ignorent qu’un festival de films est en train d’avoir lieu. L’un des enjeux pour les acteurs culturels algériens consiste bien à inviter les gens à (re)faire l’expérience de la salle obscure à laquelle, lors des Rencontres, l’accès est gratuit (tout au long de l’année, Project’heure anime un ciné-club pour lequel une contribution symbolique est demandée, et qui revient intégralement à la Cinémathèque).
Pour ce faire, l’équipe de Project’heure ne lésine sur aucun effort. Certains de ses membres sont cinéphiles, d’autres ne le sont pas. Ce qui leur importe, à tous, est de créer un espace de sociabilité constructif, plein de joie et de bonne humeur, dans le partage. Aucun ne conteste leur bénévolat, la rémunération ne leur étant pas nécessaire, disent-ils, ni financièrement ni moralement. Au contraire même, elle pourrait ternir quelque chose. De l’argent, il en faut tout de même pour que la manifestation perdure. Un travail de terrain permet d’en recevoir de l’APC (la mairie), qui donne de plus en plus, de l’Ambassade de France, de l’entreprise Cévital...
C’est avec un enthousiasme extraordinaire que les membres de l’association prennent soin des invités. Jamais en France nous n’avons vu pareil accueil, une telle bienveillance. C’est tous ensemble que l’on passe les six jours du festival, de projections en débats, de repas partagés au restaurant Le Palmier au retour à l’hôtel par un bus collectif. Les Rencontres de Béjaïa ne sont pas uniquement des expériences cinéphiliques, elles sont aussi de précieuses expériences humaines. Et quand se fait sentir le besoin d’un moment de solitude, de recueillement, entre deux projections, alors on tourne le regard vers le port que l’on surplombe depuis la place, et l’on se laisse bercer par le rythme envoûtant d’un cargo qui décharge, par le tracé d’un autre qui s’éloigne dans la mer.
Cette année (qui fête aussi la réouverture de la Cinémathèque fermée depuis quatre ans pour travaux), la programmation a été concoctée par le président Abdenour Hochiche, le critique Samir Ardjoum et la jeune étudiante Lilia Choulak. Un programme duquel se dégage, au fil des courts et longs métrages, de fictions et documentaires, venus d’Algérie et de France (à deux exceptions tunisiennes près), une cohérence thématique (l’Algérie contemporaine, la migration, l’immigration, le début de l’année 2011 au Maghreb). La quasi-intégralité des cinéastes étaient présents pour présenter leurs films, les organisateurs des Rencontres tenant à ce que ces derniers ouvrent à la discussion, après les projections et lors de ciné-cafés plus intimes le lendemain matin, au théâtre de la ville.
L’Algérie
La Chine est encore loin
Le festival s’est ouvert avec la projection de La Chine est encore loin, documentaire de Malek Bensmaïl (situé dans les Aurès et traitant de l’éducation, du début de la guerre d’indépendance, de la langue) que l’on a beaucoup vu programmé ici et ailleurs dans le monde. Mais pas en Algérie, outre une projection confidentielle en 2008 ici même à Béjaïa. Parce qu’il n’y a presque plus de salles dans le pays et parce que le film était, depuis deux ans, en attente d’un visa qu’il vient tout juste d’obtenir. Pourquoi une telle attente ? Malek Bensmaïl raconte que les gens du ministère de la Culture avaient aimé le film mais qu’ils se sont dits gênés par certains éléments, par exemple la poussière que l’on aperçoit dans une école coranique. Le film avait reçu de l’argent algérien mais il a mis bien trop longtemps à arriver. Un cas symptomatique du flou, voire de l’aberration, entourant les décisions du ministère de la Culture. Malek Bensmaïl dit ne pas se soucier du regard que lui portent les autorités algériennes. Il lui importe trop d’enregistrer une mémoire pour perdre temps et énergie à cela. Pour le directeur artistique des Rencontres, Samir Ardjoum, projeter La Chine est encore loin en ouverture du festival est une sorte de pied de nez au Ministère, qui se concentre actuellement sur la préparation de la célébration du cinquantenaire de la fin de la guerre de libération, pour laquelle il soutient, dit-on, sans transparence, un cinéma officiel sans valeur artistique ni prise de risques formels et thématiques. La salle était bien pleine lors de cette ouverture, le débat après le film a duré plus d’une heure, le café-ciné du lendemain, plus de deux. L’intérêt des Algériens pour des films racontant leur histoire semble évident.
Merzak Allouache

Salle pleine également lors des projections des deux derniers films de Merzak Allouache, Normal ! (sorti de façon confidentielle en France le 21 mars dernier et projeté deux fois en Algérie – à Oran et Alger) et Le Repenti (sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs cette année). Le réalisateur d’Omar Gatlato (un grand succès en Algérie à sa sortie en 1976), installé en France depuis des années, était visiblement attendu.
C’est avec une défiance palpable que le cinéaste a abordé les débats suivant les projections. Il faut dire que Merzak Allouache est souvent attaqué dans son pays natal (sur l’ENTV, la chaîne nationale, les films qu’il a tournés depuis vingt ans n’ont jamais été diffusés). Au dernier Festival d’Oran, où Normal ! était présenté, lui et ses comédiens ont reçu un accueil cinglant de la part de la presse. Pourquoi ? À voir le film, qui n’apparaît pas particulièrement polémique, il est difficile de comprendre en quoi il peut susciter l’ire. Le cinéaste ne l’explique pas, si ce n’est par l’incompétence de journalistes qui se retrouvent parachutés à la Culture sans en avoir ni le désir ni l’aptitude, et auxquels on donne des consignes en amont des projections. Merzak Allouache le dit et le répète, il est usé que son travail soit systématiquement objet de suspicions et que son nom soit publiquement sali. À Béjaïa, Normal ! n’a pas suscité de réactions violentes. En revanche, le débat qui suivit la projection du Repenti (qui traite de la loi de concorde civile ayant permis aux terroristes de la décennie noire de revenir à la vie civile) commença avec l’intervention d’un spectateur qui fustigea Merzak Allouache. Pour se faire de l’argent avec un film offrant une vision exotique du terrorisme, pour être resté à l’abri, en France, pendant que l’Algérie souffrait, pour revenir au pays avec un film financé par l’étranger. Les réactions dans la salle furent houleuses, l’intervenant, hué, quitta la salle. Ça n’est qu’après son départ que Merzak Allouache répondit à ses attaques, avant que le débat reprenne pacifiquement. Sur la place de la Cinémathèque toutefois, la harangue de l’intervenant continua un bon moment. On imagine mal une telle violence en France suite à un film. L’épisode permet de sentir que les plaies du récent passé de l’Algérie sont encore vives, que la tension demeure entre les habitants de ce pays, soupape toujours prête à exploser.
Normal ! et Le Repenti (tous deux tournés sans argent algérien) marquent une rupture dans le cinéma de Merzak Allouache. Après avoir travaillé, dans les années 1970, pour le cinéma d’État en Algérie (qui, aux dire du cinéaste, était meilleur alors qu’aujourd’hui car les gens étaient mieux formés et plus cinéphiles), ce dernier a tourné, depuis la France, des films aux budgets conséquents (Bab El Oued City, Salut cousin !, Chouchou, Bab El Web, le médiocre Harragas...), des téléfilms (dont La Baie d’Alger, stupéfiant de médiocrité). Se disant fatigué par la lourdeur des grosses productions, Allouache se tourne maintenant vers un cinéma plus léger, moins cher, plus libre. Avec cette donne pour point commun,Normal ! et Le Repenti sont des films fort différents. Le premier est touffu, on y parle beaucoup, il compte de nombreux personnages, la caméra est mobile, le montage dynamique, de multiples sujets sont abordés. Le film est dense, on en ressort un peu déboussolé par sa complexité formelle et thématique. Le Repenti est plus posé : les plans sont longs et fixes, l’attention se concentre sur trois personnages, les actions sont minimes, on y parle peu, et l’histoire est plus simple. Ces deux films donnent ainsi l’impression réjouissante que Merzak Allouache explore formellement quelque chose.
Normal !, situé pendant les manifestations de janvier 2011 à Alger, interroge l’engagement. Pour le protagoniste Fouzid, réalisateur (qui, par ses hésitations, ses peurs, représente bien sa génération, la jeunesse perdue et déboussolée), ce dernier passe par la création. Il veut finir son film. Sa femme (Adila Bendimard) estime que ça n’est pas le moment, qu’il faut sortir protester dans la rue. Le film de Fouzid, dont il montre un premier montage aux comédiens, raconte l’histoire d’un metteur en scène qui se voit refuser par le ministère de la Culture toute aide pour son projet. Normal ! parle moins de la censure que de l’autocensure, plus grave et plus complexe car plus tortueuse (le film évoque par exemple celle des comédiens algériens – certains, dans Normal !, n’arrivant pas à tourner une scène de baiser). Au café-ciné le jour suivant la projection, la comédienne engagée Adila Bendimerad (qui s’est faite insulter après Normal ! et qui dit avoir pris des risques en interprétant une victime du terrorisme dans Le Repenti) revient sur ce problème qu’elle dit cuisant, sur les difficultés qui se posent toujours un peu plus aux auteurs déposant des dossiers toujours plus compliqués au ministère de la Culture. Merzak Allouache invite les aspirants réalisateurs algériens à passer outre les blocages et à tourner, envers et contre tout, puisqu’il est aujourd’hui possible de le faire avec des budgets dérisoires. Normal ! évoque aussi le Festival Panafricain de 2009, auquel Allouache voulait consacrer un documentaire (Welcome Africa) qui en aurait critiqué la grandiloquence, le souci du paraître. Grandiloquence qui va dans le même sens que celle des événements culturels commandités par l’État, comme cette année la célébration du cinquantenaire de la libération. Abandonnant ce projet, il en a gardé des images dansNormal !, qui tient peut-être son énergie, sa liberté, du souffle permis par le documentaire. Ainsi que du travail collectif qui fut mené avec les comédiens, qui ont participé à l’écriture du film et à la construction des personnages. Normal ! est un laboratoire, un film qui tourne en rond (les scènes et les conversations se répètent, on est plus dans le balbutiement, la parole et la pensée qui se cherchent, que dans l’expression d’idées claires) et qui par là nous interpelle. Un film aussi qui, peut-être, par le personnage de Lamia, jeune femme qui prend des risques et qui est libre, offre une représentation de ce que l’on pourrait attendre de l’Algérie – une sortie de l’inertie.
Tourné dans la hâte et juste après la réception catastrophique de Normal ! à Oran, qui aurait donné envie à Merzak Allouache de faire un autre film, Le Repenti, en abordant l’histoire récente et douloureuse des Algériens, offre une opportunité pour ouvrir une discussion, raviver la mémoire et, peut-être, faire la paix avec l’Histoire. C’est hors de l’Algérie que Merzak Allouache a trouvé l’argent pour faire son film. On en apprécie la facture formelle (cf. l’article écrit suite à la projection cannoise) et le fait que l’ex-terroriste ne soit pas décrit comme un monstre mais comme un être humain, perdu. Pour autant, l’approche de ce dernier reste simplificatrice. Nous aurions envie qu’on nous montre la complexité d’un être devenu terroriste. Où sont les films qui parlent de ça ? On les attend.
Merzak Allouache dit cerner très rapidement où en est l’Algérie lorsqu’il y revient. Certains considèrent au contraire que ses films n’en offrent pas un portrait juste. Quoi qu’il en soit, l’existence de films algériens traitant de l’Algérie apparaît être nécessaire. Mais s’ils existent, où peuvent-ils être diffusés ? L’Algérie ne compte plus que quelques salles et les gens ont perdu toute habitude d’aller au cinéma. Merzak Allouache et ses comédiens rappellent la nécessité de rhabiter l’espace public autour d’événements culturels, qui permettront peut-être à la nation de construire quelque chose, d’aller de l’avant et de soulager les tensions palpables entre ses membres.
Intégrale Rabah Ameur-Zaïmeche

Rabah Ameur-Zaïmeche, d’origine algérienne, est né et vit en France. C’est là qu’il a tourné, avec sa troupe de comédiens d’origine maghrébine, trois de ses quatre films magistraux, inclassables, que les Rencontres nous ont offert le bonheur de revoir : Wesh Wesh qu’est-ce qui se passe, Dernier Maquis et Les Chants de Mandrin, qui posent chacun d’eux sur notre monde un regard lucide, terrible, plein d’une révolte sourde. Bled Number One, tourné en Algérie en 2005, était bien prévu au programme mais, hélas, hélas !, l’état de la copie fournie par le distributeur a rendue impossible sa projection. En tant que cinéphiles, en tant qu’individus inscrits dans une société et une époque, on reçoit de plein fouet les films de cet auteur, qui sont des expériences très fortes. Les débats suivants ces dernières, animés par l’habile Luc Chollet, alias Omar Zelig (présentateur radio sur la Chaîne 3 algérienne) nous ont fait découvrir un cinéaste quasi mutique, qui ne semble vouloir ajouter aucun mot aux images, aux récits, qu’il a construits.
Bir d’Eau, a Walkmovie – Portrait d’une rue d’Alger, de Djamil Beloucif

Il est difficile de savoir à quoi l’on a affaire en découvrant les premières images de Bir d’eau. Le travelling d’ouverture est une entrée en matière brute. Le diaphragme bave au grès des sources de lumière, le cadre cahote au rythme de la marche, il semblerait que Djamil Beloucif nous propose bel et bien, ainsi que l’annonce le titre, un film-promenade, pour lequel la caméra ne sera que nonchalamment portée. Une promenade que l’on entame dans les hauteurs d’Alger pour ne plus faire que descendre.
Mais quel est le statut réel de cette promenade cinématographique ? S’agit-il d’un documentaire, comme pourrait le suggérer le sous-titre « portrait d’une rue d’Alger » ? De l’expérience artistique d’un vidéaste ? Ou bien est-ce une fiction dont les héros seraient deux hommes mutiques, un caméraman et un perchman, qui décident d’accompagner la caméra en la faisant descendre le long de la rue Burdeau ?
Cet étrange objet cinématographique est tout cela à la fois et Djamil Beloucif a l’art de brouiller les frontières entre les genres. Au spectateur de démêler le vrai du faux, le fruit du hasard des séquences mises en scène, les véritables habitants du quartier Burdeau des acteurs complices du réalisateur. Si l’identité du film est difficile à cerner (ce qui affaiblit parfois sa pertinence), son propos semble plus accessible. En effet, depuis les hauteurs presque sauvages, chemins de terre et buissons, jusqu’à la rue Didouche Mourad, artère traversante du bas-Alger, la caméra glisse sur la rue Burdeau comme glisserait un bateau de papier sur un ruisseau, et les personnages croisés, qui sont autant d’obstacles savoureux dans le ruisseau, apportent chacun quelque chose de l’Algérie contemporaine. En cela, le film dresse plus que le portrait d’une seule rue. Il parvient, sans en avoir l’air, à poser les bases de réflexions importantes sur des sujets de société variés.
Ainsi, par exemple, d’une discussion entre un urbaniste et un architecte à propos d’un terrain sur les hauteurs de Burdeau, il interroge l’ambition algéroise en ce qui concerne le bâti et l’architecture en général.
Un vieux bonhomme, croisé ensuite, se plaignant de la difficulté administrative pour pouvoir faire renouveler ses papiers, permet d’évoquer l’arabisation de l’administration, en cours depuis 1962, et les difficultés pratiques que cela peut provoquer pour certains Algériens qui maîtrisent le dardja dialectal, le berbère ou le français, mais pas l’arabe littéral. Plus tard, l’arrivée à hauteur du bâtiment-pont de Telemly est l’occasion de confronter le film à la dépression de la population algérienne, pour qui un pont est forcément synonyme de suicide.
Par ailleurs, très souvent, la caméra, intrusive, suscite des réactions à vif qui, en creux, révèlent que l’image, en Algérie, n’est pas à prendre à la légère (à deux reprises la présence du filmeur est prise pour une "embrouille", elle est a priorisuspecte). « L’Algérie se filme toujours en hors-champ », dit l’un des personnages questionnant l’attitude de cette caméra qui le filme sans préavis. Le passage de la caméra que l’on cache dans le sac à proximité du commissariat démontre quant à lui quelque chose de la rigidité de l’État vis-à-vis de la liberté laissée aux cinéastes. Dans la rue Burdeau, quand on aperçoit une caméra, on pense qu’elle appartient aux journalistes, à la télévision. Jamais l’on n’imagine qu’elle puisse servir le cinéma.Mais il reste que ces sujets, graves, sont abordés avec la légèreté que permet le dispositif de la promenade, et la vivacité gourmande des dialogues et des situations donne en contrepoint une vision tout à fait enthousiasmante de ces algérois à la lucidité, certes empreinte de cynisme, mais extrêmement lyrique et poétique. En témoigne la dernière rencontre du film, celle d’un facteur poète, qui profite de la fin de son service et de la présence d’une caméra muette pour déployer son art du proverbe de circonstance et l’acuité poétique de sa langue.
(Sylvain Baldus)
Deux courts-métrages des ateliers Béjaïa Doc
Uzzu et J’ai habité l’absence deux fois, respectivement de Sonia Ahnou et Drifa Mezeneer, ont été réalisés dans le cadre des ateliers Bejaïa Doc, fondés en 2007 par l’association algérienne Cinéma et Mémoire, en partenariat avec l’association française Kaïna Cinéma. Chaque année, six à huit stagiaires sont encadrés, de la phase d’écriture à la finalisation, pour concrétiser leurs projets qui se doivent de traiter un sujet qui leur est proche. On leur apprend notamment à mettre leur subjectivité au cœur de leurs documentaires. Cette dernière est en effet prégnante dans les six films de la promotion 2011, qui ont pour autre point commun de tous traiter d’une problématique proprement algérienne (l’aménagement de l’espace urbain depuis l’indépendance – Block House, de Tarek Mokhnache, la désinvolture avec laquelle est géré l’espace commun à Constantine – Et si ça changeait, de Nabil Chaouch Teyra, l’héritage de Frantz Fanon dans l’hôpital où il a exercé – Où est Fanon, de Yacine Hirèche...).
Dans Uzzu, Sonia Ahnou fait parler de jeunes Kabyles qu’elle connaît bien au sujet de l’amour. La cinéaste s’implique, en apparaissant parfois dans le cadre ou en posant quelques questions. En réunissant les jeunes gens dans un champ de fleurs pour les faire échanger (sur le couple, la virginité, les sentiments, le regard des autres, les conventions, la différence entre hommes et femmes...), en recueillant les confidences d’une jeune fille seule sous un arbre et face caméra, elle laisse la part belle à la parole des autres. Qu’on ne se trompe pas, il ne s’agit pas là de dresser un portrait de la façon particulière d’envisager l’amour en Kabylie. Pas de généralisation ici mais un portrait d’individus, dont les confessions, les confrontations de points de vue, n’engagent qu’eux seuls. En nous montrant les jeunes gens qui se filment en train de discuter, en faisant apparaître une perche dans le cadre, la cinéaste signale qu’elle enregistre le processus d’apparition de la parole, et non qu’elle tente de faire surgir une quelconque vérité. Ainsi, ce qui n’est pas dit, ce qui est suggéré par les mots et qu’il nous appartient de deviner, est aussi important que ce qui est dit. La subjectivité, de ceux qui s’expriment et de celle qui fait surgir les expressions, est bien au cœur de ce documentaire qui nous offre un portrait de quelques êtres, un éclairage possible sur la façon de parler de l’amour en Kabylie.
Dans J’ai habité l’absence deux fois, Drifa Mezeneer filme sa famille, qu’elle interroge aussi, et son quartier d’Alger, Kouba. Que l’un de ses frères a quitté pour l’Angleterre d’où il n’est jamais revenu. En off, la cinéaste raconte le temps passé depuis le terrorisme et la vie à Kouba, aujourd’hui et hier. Un quartier plein de vie, de sensations rendues palpables par les images et le récit, un quartier qui a aussi connu le mortifère et qui en est sans doute encore marqué. Drifa parle de et à son frère, le grand absent de cette famille vivant dans un pays où, peut-être, les gens sont absents à eux-mêmes. Dans le jardin familial, la difficulté du père à répondre aux questions de sa fille concernant l’Algérie contemporaine (« quand la colère m’aura quitté, je te raconterai » dit-il), son regard qui la fuit, font sentir les blessures qu’a laissé en lui les deux guerres que sa génération a subies. Le silence de la mère rend poignante la douleur qu’est la sienne en l’absence de son fils. Les propos du grand frère apportent un éclairage subjectif, pertinent, parfois ironique, sur ce qu’il en est de la vie à Alger aujourd’hui, un appel à une renaissance qu’il sait difficile. Ce film, formellement maîtrisé, aux cadres et au son travaillés, au montage habile, est un portrait pluriel. Celui d’une famille, de chacun de ses membres, d’un quartier, d’un pays, d’une époque, d’une cinéaste qui parle à la première personne. Un portrait émouvant et beau, un film prometteur.

Si Samir Ardjoum n’était pas venu la chercher, Sarah Tikanouine aurait probablement laissé son film dans un tiroir, et ça aurait été bien dommage. À quoi rêvent les fennecs, moyen métrage documentaire, s’intéresse à un sujet original, l’équipe de football féminine algérienne (dont les membres sont nommées « fennecs »). Et sans en avoir l’air, en toute modestie, il soulève des questions cruciales concernant l’Algérie. La cinéaste s’attache à montrer le quotidien des footballeuses, d’entraînements en matchs, de vestiaires en bus et chambres d’hôtel. Elle recueille aussi et surtout leur parole ainsi que celle des gens qui gravitent autour d’elles – entraîneur, staff technique, kiné... Une ex-championne charismatique devenue entraîneur, Naïma Laouadi, présente à Béjaïa pour accompagner le film, raconte face caméra le combat qu’elle mène depuis les années 1990 pour que le football féminin existe en Algérie. On le devine, en pays musulman il est difficile d’accepter qu’une femme vive une passion, qu’elle se donne à fond, qu’elle s’exprime. L’équipe est accueillie royalement dans un hôtel d’Alger où elle va concourir. On est fier d’elle, on prend soin d’elle. Mais si de jeunes employés d’un magasin d’équipements sportifs trouvent que des filles qui jouent au foot, « c’est très bien », à la question « accepteriez-vous que votre sœur choisisse une telle carrière ? », ils répondent « non ». Ainsi se donne à lire toute la complexité de la mentalité algérienne. Les jeunes filles à l’image, dont certaines se disent soutenues par leurs familles, se réjouissent du métier qu’elles font. Elles sont fières, de servir leur pays, de faire vibrer les autres. Heureuses aussi de voyager, rare opportunité que le sport leur offre. Elles sont conscientes des différents regards que les hommes leur portent. Les uns sont fascinés, les autres les rejettent. Elles, elles se sentent féminines. Pour leur entraîneur (pour qui elles sont « mi-hommes mi-femmes »), le foot est la chance de leur vie car, dit-il, ces filles viennent de milieux modestes et n’ont pas fait d’études, que pouvaient-elles attendre alors ? Le regard de Naïma Laouadi est plus critique. Pour elle, l’accès à la reconnaissance des joueuses est toujours un combat à mener. Parce que les médias parlent à peine de leurs matchs, que l’État ne semble pas leur faire confiance ni les encourager. Contrairement au Maroc et à la Tunisie, l’Algérie n’aurait pas évolué sur ce point. Pourtant, aucune des jeunes filles ne parle jamais de quitter son pays pour aller jouer ailleurs. Au contraire, l’une d’elle, née en France où elle a grandi, dit sa fierté, sa joie, d’avoir rejoint l’équipe algérienne. La question « quels sont vos rêves ? », posée discrètement par la cinéaste, reçoit des réponses différentes. Si certaines espèrent pouvoir participer à une grande manifestation et continuer à servir leur pays, il en est pour qui les rêves sont derrière. Parce que l’âge avance et qu’il va falloir se marier. Inéluctablement, et fonder une famille. Le foot, ça ne sera plus qu’un loisir, et ça n’est pas beaucoup. En effet, la question du devenir de ces sportives reste problématique. Que faire à 35 ans quand on n’a ni enfant ni mari ni métier ? Pour Naïma Louadi, il y a des solutions, il suffit d’y réfléchir ensemble, et bien. Ainsi on pourra aller loin.
Octobre à Paris qui, après une histoire mouvementée, a pu sortir en France le 19 octobre dernier (de façon concomitante avec Ici on noie les algériens, traitant du même sujet), a visiblement fort touché le public bougiotte qui est longuement intervenu après la projection. L’événement tragique qu’il évoque, le 17 octobre 1961 (jour de la répression sanglante par la police de Paris aux ordres de Maurice Papon d’une manifestation d’Algériens organisée par le FLN pour protester contre le couvre-feu qui leur était imposé), reste un tabou qu’il est grand temps de porter à la lumière du jour. Juste après le massacre, un Français, biologiste et chercheur au CNRS, Jacques Panijel, a reconstitué la préparation de la manifestation et a fait témoigner des Algériens sur ses conséquences tragiques. Tout a été tourné dans la clandestinité et le film, rapidement connu, a été interdit, renié, pendant bon nombre d’années – cela n’a pas empêché sa circulation dans l’illégalité (Jean-Paul Sartre, Yves Montand, Simone Signoret, René Vautier... en auraient acquis des copies). Par la suite, c’est Panijel lui-même qui a refusé sa sortie. C’est presque par hasard qu’après sa mort le négatif fut retrouvé par Gérard Vaugeois, distributeur du film en France venu à Béjaïa raconter cette histoire. On peut être gênés par la reconstitution et par les témoignages pour lesquels mise en scène, écriture du texte et direction des personnes à l’écran éloignent d’une authenticité que l’on aurait pu préférer. Peu importe. L’existence de ce film est salutaire, elle offre l’opportunité de raviver les plaies, de rouvrir le dialogue et, peut-être, de faire un pas vers une réconciliation entre la France et l’Algérie.
Migration, immigration

La guerre est proche (présenté au Réel cette année), de la plasticienne française Claire Angelini qui l’a tourné, monté et produit seule, est une proposition de cinéma étonnante. Dans des plans fixes qui durent, elle nous montre les ruines du camp de Rivesaltes, un très grand camp situé dans le sud de la France et qui fut opérant de 1938 à 1997, peuplé successivement d’Espagnols, de juifs, de soldats allemands, de harkis... Un lieu garant d’une mémoire d’enfermement. Sur ces images, quatre personnes s’expriment l’une après l’autre, dans les quatre parties qui composent le film présenté comme un oratorio.
La première (la plus longue) est la plus intrigante, la plus forte. C’est par les propos d’un architecte (dont le texte, lu par Boris Lehman, résulte d’une réécriture effectuée par la cinéaste après avoir recueilli la parole de divers architectes) que nous faisons connaissance avec ce qui reste du camp. Pendant un long moment, il nous explique techniquement le processus de la ruine. La parole, dont nous suivons d’abord le sens, devient parfois une musique par laquelle on se laisse bercer sans plus chercher à la comprendre, avant de revenir nous raccrocher au cœur de ce qu’elle nous raconte. Parce que nous savons que les pierres que l’on voit constituaient un camp, nous faisons de nous-mêmes le lien entre la ruine du matériau et celle des vies humaines. C’est toute la force et l’originalité du film d’approcher les êtres par la matière, de parler de l’Histoire en expliquant l’architecture. En cela, le film aurait pu s’en tenir à cette première partie, déjà bien assez forte. Les trois suivantes n’en sont pas moins fort légitimes.
À l’impersonnalité de la parole de l’architecte succèdent des premières personnes du singulier : un Espagnol, puis une harki, racontent leur passage dans le camp. Nous n’apercevons d’eux que furtivement de rares fragments de corps – à l’exception d’un plan sur le visage de la harki. C’est par leur seule voix qu’ils existent et cela rend prégnante la matérialité de cette dernière. Le bégaiement de la harki, sa difficulté à parler distinctement, racontent à eux seuls le traumatisme qu’elle a subi dans le camp. Accompagnées par ces récits, les pierres de l’image deviennent des fragments de scènes, d’histoires, que nous recomposons en imagination. C’est ainsi par les images mentales que l’enfermement nous est représenté. Le son, c’est aussi celui généré par les éoliennes entourant le camp, au rythme lancinant, qui peut renvoyer à l’angoisse due à l’emprisonnement. Et celui des cigales qui, accompagnant la verdure de la campagne et le ciel bleu immaculé, nous donnent aussi une impression de paix qui contraste avec ce qui est narré.
Riches sont ainsi les sensations que le dispositif de La guerre est proche déploie. Et riche est le voyage spatio-temporel auquel il nous convie, à travers l’espace ouvert perçu et l’espace claustrophobe raconté, le temps présent de l’image et le passé qu’il convoque. Dans la dernière partie, nous revenons à une approche moins personnelle de Rivesaltes, puisque c’est une « militante », qui n’y a pas vécu, qui raconte les camps de rétention contemporains. Le film se clôt sur l’inscription à l’écran d’une loi datant de 1938 et disant la nécessité de rejeter certains migrants indésirables et nuisibles. Ainsi le voyage dans le temps s’achève-t-il sur notre effrayante actualité, ainsi la guerre est-elle proche.
Nuit sur la mer de Marc Scialom

Qu’est-ce que la nuit sur la mer ? Un horizon éteint ? Des côtes inatteignables ? Un retour impossible ? Cette Nuit sur la mer-là, celle de Marc Scialom, échafaude progressivement le fantasme d’un Ulysse, exilé volontaire et débarrassé de la nécessité du retour. Un voyageur apatride, heureux parmi les apatrides, parce qu’il n’y aurait plus de patrie.
Nuit sur la mer est un film à l’image de ce vœu d’odyssée sans retour. Les différentes dimensions narratives qui le structurent sont autant de territoires cinématographiques entre lesquels les frontières semblent abolies. De multiples couloirs sont tracés entre fiction et réalité, entre passé et présent, entre ce qui aurait pu être et ce qui n’a pas été. Dans la fiction, Marc Scialom est un vieux réalisateur juif tunisien qui doit faire un film sur l’exil sans son acteur principal tout juste décédé.
Dans la réalité, celle qui a présidée à la réalisation de Nuit sur la mer, Marc et Chloé Scialom, père et fille, ont dû réécrire le film à quelques jours du tournage pour pallier la disparition précoce et soudaine de Mohamed, l’ami qui aurait dû en être le héros. Mohamed était devenu un sans-papier volontaire après avoir longtemps soutenu la cause des sans-papiers. Sa mort, bien réelle, a changé le cours du tournage de Nuit sur la mer mais elle est devenue aussi, pudiquement, élément de la fiction.
L’écran d’un moniteur de montage, cadre dans le cadre, symbolise le passage d’une dimension à une autre. Il s’agit de celui sur lequel le personnage réalisateur regarde ses rushes et, indécis, réfléchit à ce film en train de se faire. Il hésite, il se sent vieux. Ses collaborateurs peinent à lui venir en aide.
Car au départ, il y avait le projet d’un autre film, Le Citronnier, court métrage racontant la rencontre de deux exilés à Marseille, l’une Tunisienne juive et l’autre Marocain musulman. Des images de ce premier film furent tournées, celles notamment, grandiloquentes et oniriques, où elle, Tunisienne, pénètre dans le magasin de son voisin Marocain. Depuis Marseille, la Méditerranée est franchie, tous deux se retrouvent en terre fraternelle mais malgré l’exil commun, se dresse une autre frontière mentale. C’est cette frontière là que le vieux réalisateur peine à représenter.
Le Citronnier était un projet de Marc Scialom, réalisateur de Lettre à la prison (film tourné en 1969, mais oublié pendant quarante ans avant sa sortie en salle en 2009). Dans Nuit sur la mer, Le Citronnier est désormais le film inachevé et parfois symboliquement douteux de l’autre Marc Scialom, homonyme fictif, qui voulait interroger la relation conflictuelle entre Arabes et Juifs.
Mais c’est dans le passé commun des deux Marc Scialom, celui de la fiction et celui de la réalité, réunis devant les tombes délabrées du cimetière juif de Tunis où reposent d’autres Scialom, que réside peut-être l’essence de ce beau film. Ce passé où un jeune homme de Tunis, militant marxiste ayant pour camarades des militants arabes, est devenu, après les bombardements français de Bizerte puis après le déclenchement de la guerre des Six Jours par Israël, coupable d’être français et coupable d’être juif.
Dès lors, l’exil ne saurait être un royaume tant que tous les exilés ne s’appelleront pas Ulysse.
(Sylvain Baldus)

Traitant des harragas, le court-métrage français Brûleurs part d’une idée forte. Le cinéaste, Farid Bentoumi, a voulu proposer autre chose que ce que l’on raconte le plus souvent à ce sujet, à savoir les difficultés, l’horreur, de la traversée de la mer et de l’arrivée sur une terre qui ne veut pas accueillir les migrants. Frappé par une vidéo découverte sur YouTube, qui montrait la joie de jeunes gens sur le bateau les emmenant loin de leur pays natal, il a imaginé une histoire semblable, la préparation du voyage, tant il semble incroyable que l’on puisse s’apprêter à vivre les risques avec tant d’enthousiasme. Le film est entièrement tourné en caméra subjective et nous met à la place des futurs migrants (aux interprètes desquels le cinéaste a demandé d’improviser) qui enregistrent tout ce qu’ils aiment de la terre qu’ils vont abandonner, en l’occurrence Oran – une pizzeria, les cigarettes Rym qu’on ne trouve pas en France, une petite amie (qui ôte pour l’occasion son foulard dans un très joli plan), des photos du passé. Les raisons pour lesquelles ils s’en vont nous sont instinctivement connues, le cinéaste a la finesse de ne pas revenir là-dessus. Garant de la force du film, ce parti pris initial de ne montrer que l’énergie et la joie, est malheureusement abandonné lorsque les jeunes gens embarquent. Car alors, le film nous plonge dans un drame que nous avons vu plusieurs fois au cinéma, la noyade, la panique nocturne en pleine mer. Il n’est pas étonnant que Brûleurs ait été sélectionné dans bon nombre de festivals internationaux, tant l’Occident est friand des représentations misérabilistes du sort des harragas. On regrette ainsi que le film de Farid Bentoumi ne s’en soit pas tenu à son idée initiale qui, moins vendeuse, était bien plus originale.

Sur la route du paradis, moyen métrage français d’Uda Benyamina, explore quant à lui le devenir des migrants une fois arrivés en terre d’accueil, en l’occurrence Paris. Cette fois, nous retrouvons bien la représentation de la galère absolue attendue pour un tel sujet. Mais c’est avec élégance que l’histoire, solidement construite et portée par des comédiens convaincants (notamment les enfants), est racontée. Leila et ses deux enfants survivent dans un bidonville, en attendant d’avoir suffisamment d’argent pour rejoindre le père exilé à Londres. Pour le gagner, Leila danse dans un cabaret sordide. L’espoir et la complicité qu’elle entretient avec un ami travesti qui partage sa condition lui permettent sans doute de tenir le coup. Mais lorsque ses enfants doivent quitter l’école parce que la police recherche les clandestins, lorsqu’elle les met sur le trottoir pour faire la manche, puis qu’elle comprend que son mari a fondé une autre famille en Angleterre, alors l’édifice se fissure, avant de s’effondrer complètement à la fin avec l’apparition de nouveaux désastres. Sur la route du paradis ne marque pas par son originalité, ni formelle ni narrative, mais il demeure un récit fort bien fait, dont on retiendra, notamment, une noirceur visuelle prégnante et cohérente avec son sujet.
Qu’ils reposent en révolte (Des figures de guerre I) (France, 2010), de Sylvain George, s’attarde sur le moment intermédiaire, entre la préparation du voyage de Brûleurs et la vie d’exilés installés en terre d’accueil de Sur la route du paradis : l’attente, à Calais, de migrants de divers pays tentant de rejoindre l’Angleterre. Nous avons déjà dit ici le bien que nous avions pensé du film lors de sa présentation au FID en 2010. Sa projection à Béjaïa est une première sur le sol africain.
Début 2011 au Maghreb
On le sait, d’innombrables vidéos ont été tournées avec des téléphones portables et postées sur Internet lors des Printemps arabes. La plupart sont des captations, nées d’une urgence de témoigner du temps présent, de l’enregistrer pour en conserver la mémoire. Avec Vibrations, la Tunisienne Farad Khadar, anthropologue vivant en France, a nourri ce dessein. Revenant trois semaines après le 14 janvier 2011 dans son pays natal qu’elle n’a plus reconnu, elle dit avoir voulu chercher à comprendre et « pousser un cri ». Son film, de 7 minutes, alterne images de manifestations, cartons racontant leur chronologie et images de vagues. Ce travail de montage permet à Vibrations d’être un vrai film et non une captation. Le tout est efficace, élégant, voire poétique (grâce aux vagues et aux symboles qu’elles convoquent). Si l’on peut regretter que le film ne raconte pas grand-chose de plus que ce que nous avons vu tant de fois, qu’il ne problématise pas ce qui se passe, il demeure un joli objet, un joli témoignage d’une actualité désormais révolue.
Une autre forme très courte et un autre film tourné dans l’actualité orageuse de début 2011, Petites empreintes de lutte(composé de deux films de 3 minutes), d’Amal Kateb, auteur du remarquable On ne mourra pas. Après ce dernier, porté pendant dix ans et résultant d’une profonde nécessité de faire un film sur les années noires, l’auteur ne voulait plus tourner. C’est la Révolution tunisienne et l’espoir en miroir d’une potentielle évolution de l’Algérie qu’elle a véhiculé qui lui en ont redonné l’envie. Meeting autorisé commence le 15 mars et s’achève le 23 avril 2011, nous indiquent des cartons. Ce que l’on voit, ce sont des militants de la CNCD (Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie) à Oran qui organisent une campagne d’affichage. Ce que les cartons nous apprennent, c’est que cet affichage a été interdit par la police, qu’Ahmed Kerroumi, l’un des actifs, a disparu dans des circonstances troubles, que son cadavre a été retrouvé dans le local du parti. Cette empreinte est des plus efficaces. Le choix de raconter l’avant des manifestations est d’une originalité réjouissante. Amal Kateb nous épargne toute discussion sur le fond des problèmes qui ont mené les gens dans la rue (un simple plan d’une affiche suffit à nous rappeler, s’il en était besoin, les maux dont souffre l’Algérie). C’est l’affichage comme acte concret qui est au centre – comment on écrit sur une affiche, comment on la colle. Le reste demeure hors champ, ouvert à notre libre appréhension. Ainsi délestés de toute insistance sur le fond du sujet, nous sommes pleinement réceptifs à l’information cinglante qui nous est donnée à la fin. Cet homme, Ahmed Kerroumi, a été tué très probablement pour son action politique, et le mouvement impulsé par la CNCD en a été mis à mal. Le film nous laisse là, seuls avec ça. Et l’événement coupe l’élan de la cinéaste qui projetait de tourner d’autres empreintes. En racontant l’histoire d’une ébauche de mouvement stoppée nette au profit d’un retour à l’inertie, Meeting autorisé pose aujourd’hui une question glaciale à l’Algérie.
Ehi échirettes/Allez les filles ! se passe également à Oran en 2011. Dans une voiture qui roule, des jeunes filles s’interrogent sur ce qu’elles vont faire de leur soirée : s’amuser ou participer à une manifestation ? Après être passée devant un commissariat, filmé, évidemment, en catimini, la conductrice entonne une chanson disant les blessures, les blocages, les maux passés et actuels de l’Algérie.
Ces deux empreintes nous laissent un sentiment de frustration car on aurait envie de les voir inscrites dans une fresque plus large, que chacune d’elles soient une pièce d’un puzzle composant un portrait complexe de l’Algérie contemporaine. Dans l’espoir qu’Amal Kateb puisse poursuivre en ce sens son travail...

De façon plus lointaine, la Révolution tunisienne est aussi présente dans La Nuit de Badr, court-métrage tunisien de Mehdi Hmili (qui présenta l’an dernier aux Rencontres Le Dernier Minuit). Badr est un vieux poète tunisien, il vit confortablement en France et a un jeune amant français, Philippe. Au moment de la Révolution, le gouvernement lui demande de revenir dans son pays natal. Il accepte, et fait ses adieux à Philippe. Pourtant, Badr déteste la Tunisie. Pourquoi dès lors choisir d’aller y finir ses jours ? C’est cette question qui sous-tend le récit et c’est elle qui intéresse. La relation entre le vieil homme et le jeune amant captive moins. Dans la grande maison luxueuse du poète a lieu leur face à face mélancolique et poétique (en noir et blanc et scandé par les poèmes de Badr récités). Philippe arrive avec sa valise, tout excité. Il veut partir avec Badr, profiter de l’opportunité pour quitter ses études de médecine et vivre l’aventure aux quatre coins du monde. Sans Badr, ici, il n’est plus rien. Le vieil homme, lui, ne l’entend pas de cette façon. Un charisme indéniable se dégage de ce personnage, une aura intrigante. Philippe, le personnage et l’acteur qui l’incarne, est bien moins convaincant, plus fade, et sa naïveté, sa fraîcheur, peuvent même agacer. On peut ainsi rester à distance du drame qui le frappe à la fin. La Nuit de Badr laisse au spectateur le choix d’être sensible à plusieurs dimensions selon la lecture qu’on en fait : le couple fait de deux êtres très différents, l’abandon, le rapport à la terre d’origine, la poésie. Si l’homosexualité est présente, elle n’est pas le sujet du film. Les deux amants sont tous les deux des hommes, c’est un fait, mais il aurait pu en être autrement. Il n’empêche qu’à cause de cette donne-là, Mehdi Mhili devra attendre un peu avant de présenter son film en Tunisie (il n’y eu qu’une projection pour la presse), où les salafistes ont détruit, la veille de la projection bougiotte, une exposition d’artistes.
Nouvelle Toile

Rue des cités, de Hakim Zouhani et Carine May, présenté à l’ACID l’an dernier, est assurément l’un des films français les plus enthousiasmants de ces dernières années. C’est avec joie que l’on a pu revoir ce portrait sensible, drôle et élégant d’Aubervilliers et de certains de ses habitants. La sortie du film est prévue en France pour novembre prochain, c’est à ne pas rater !
Pour exploiter ce film, ses auteurs ont fondé une maison de production, Nouvelle Toile, qui porte maintenant aussi des projets d’autres auteurs. Parmi eux, Yassine Qnia, qui travailla sur Rue des cités et qui a écrit, avec Carine, Hakim et Mourad Boudaoud, le court-métrage Fais croquer (qui a déjà commencé une belle tournée en festivals et remportait, presque au moment de la projection aux Rencontres, le Prix du Public à Pantin). Le film, également situé à Aubervilliers et partant de l’expérience vécue par son auteur, raconte les déboires de Yassine voulant tourner un court-métrage amateur. C’est drôle, très drôle, c’est émouvant, rythmé, bien construit, sans temps mort. C’est plein de vie, modeste, personnel. C’est une nouvelle pépite venue d’Aubervilliers qui conforte toutes les attentes que l’on a de Nouvelle Toile. Vivement le prochain !
D’une rive à l’autre de la Méditerranée

Au petit matin, une adolescente rentre dans la maison familiale bourgeoise après avoir passé la nuit dehors. Elle est blessée. Ainsi s’ouvre M khobbi fi Kobba (Soubresauts), film de fin d’études de la Fémis de la Tunisienne Leyla Bouzid. Que s’est-il passé cette nuit-là pour la jeune fille ? C’est l’enquête menée par la mère que le film raconte. Non pas son résultat, l’élucidation du mystère, mais les réactions successives qu’engendrent les hypothèses et les variations de la relation de la mère à sa fille (la colère, la protection, la complicité, l’amour...). L’événement lui-même semble moins important que ce que l’on en fait. La préoccupation de la mère, une fois qu’elle a deviné que sa fille n’est sans doute plus vierge, est de sauver les apparences, de le cacher. Le père, lui, est quasi absent, simple apparition à qui l’on fait croire que sa fille est tombée et qui s’en tient à ça. Quant au frère, que l’on devine fortement impliqué dans la blessure de sa sœur mais qui n’en dira rien, il surveille les femmes de la maison, veille à freiner leurs mouvements d’émancipation. La mère semble aller dans son sens en cachant ce qui est arrivé à sa fille. Mais, lorsqu’elle se met à danser sensuellement, le corps à moitié nu, lors d’une fête, ne revendique-t-elle pas elle aussi une certaine liberté ? La complexité, l’ambiguïté, d’une certaine bourgeoisie tunisienne oscillant entre conservatisme et ouverture, sont pertinemment explorées par ce film, en outre formellement maîtrisé.
La Mémoire et la mer (France) est le journal filmé d’un jeune cinéaste, Jean Boiron-Lajous qui, avec son frère et l’amie de ce dernier, prépare puis entreprend un voyage à Alger d’où leurs parents étaient originaires. Une quête des racines, ce film est aussi une interrogation sur la façon de rendre compte d’un voyage à l’étranger, de faire partager au spectateur une expérience très personnelle. Comment filmer une terre qu’on découvre en échappant aux représentations clichées ? Arrivé à Alger, Jean n’a d’autre option que de filmer en caméra cachée. Et ce que l’on voit, ce sont bien des stéréotypes, mais c’est aussi ce que nous pouvons vivre dans les rues de la ville. Jean repart d’Algérie avec un sentiment de frustration. En off, il nous dit que, peut-être, il aurait dû faire autrement. Trop préoccupé par sa caméra, il est peut-être passé à côté de ce que les situations lui proposaient de vivre. Si l’on peut rester à distance de son récit, les questions qu’il évoque interpellent : comment rendre universelle une expérience intime ? Quelle légitimité a donc un film "carnet de bord" ? Peut-on rendre compte de la complexité d’un pays en même temps qu’on en fait connaissance ? Ne faut-il pas du temps entre la découverte et la mise en images ? Le recul est-il nécessaire pour être juste ? Parce qu’il nous dit ses doutes, ses craintes et ses regrets, qu’il les assume, Jean Boiron-Lajous signe là un film honnête. Maladroit, sans doute, mais qui, par sa modestie, nous invite à porter sur lui un regard clément.
À ton vieux cul de nègre, d’Aurélien Bodinaux, est une comédie belge bien ficelée, bien écrite, qui questionne et métaphorise la colonisation. Dans une maison de repos, un Congolais reçoit la visite d’un ami belge. Autour d’une bonne bouteille, au fil d’une conversation tantôt directe, littérale, tantôt retorse et ironique, ils règlent leurs comptes de colonisateurs et de colonisés. Personne n’est épargné, ni « le colon », le champion du déni, ni le colonisé, qui n’hésite pas à rendre unique responsable de ses maux actuels l’ex-présence coloniale. Mais c’est dans la sympathie et avec humour qu’a lieu l’échange. Avons-nous là une invitation à risquer le dialogue ? Comme il était venu chez le Congolais, le Belge s’en va, ce mouvement pouvant figurer ce qui s’est joué en terre colonisée, où le départ et le vide laissé furent lourds et bien remplis.

Aux rêveurs tous les atouts dans votre jeu, film français de Mehdi Benallal, repose sur un dispositif simple qui ouvre les portes au foisonnement de l’imagination et de l’interprétation. Ponctué de plans fixes d’un pont, du ciel et des nuages qui le surplombent, il est une succession de quatre tableaux dans lesquels une personne, filmée à l’intérieur, dans un élégant plan fixe minutieusement composé et simple, raconte un des rêves qu’elle a fait en dormant. En faisant durer les plans et les récits, Mehdi Benallal fait confiance en la capacité de son spectateur à investir des images dans lesquelles l’événement est infime (subtiles variations de lumière, expression du visage d’un personnage), et à se saisir des paroles pour se projeter dans le champ immense des images mentales. Le récit des rêves peut se prêter à la spéculation analytique mais il ne semble pas là pour ça, apparaissant plutôt comme une invitation à construire par nous-mêmes des paysages et des histoires. La respiration permise par les plans d’extérieur vidés d’êtres humains semble prolonger ce qui se joue dans les espaces clos car elle invite, par le ciel qu’elle nous montre, à lever la tête vers le haut, à nous perdre dans nos rêves.
Après Le Naufragé l’an dernier, moyen métrage français de Guillaume Brac, c’est le nouvel opus du cinéaste que les Rencontres ont programmé, Un monde sans femmes – sorti en France en diptyque avec le premier et qui fut un joli succès. De part et d’autre de la Méditerranée, ce film sensible et tendre, aux acteurs épatants (Laure Calamy, Constance Rousseau et Vincent Macaigne), a conquis le public. Laure Calamy, plusieurs fois récompensée pour sa partition, était là pour le présenter. L’occasion de faire vivre un peu plus le personnage qu’elle interprète, tant il semble proche de ce qu’elle est, un véritable et réjouissant spectacle.
Nada a Ver, de Florence Bresson et Elisabeth Goncalves

On connaît la mauvaise réputation de l’univers carcéral brésilien. Les reportages à sensation sur le sujet sont légion à la télévision. La violence sans nom des favelas, d’autant plus exacerbée dans l’enceinte de la prison où les guerres de gangs font rage, a toujours été une bonne recette pour l’audimat. Alors, il n’y aurait qu’à laisser tourner la caméra, en ajoutant au montage cut une nappe musicale angoissante pour créer en deux temps trois mouvements une bonne dose de frissons pour le téléspectateur avide de férocité exotique.
« Rien à voir » de tout cela dans Nada a Ver de Florence Bresson et Elisabeth Goncalves, car si le film est entièrement tourné à l’intérieur d’une prison de l’État du Paraná au Brésil, il ne fait en aucun cas commerce de sensationnalisme. Il est au contraire le fruit d’un long travail entamé en 2004 par Elisabeth Goncalves, metteuse en scène de théâtre. Invitée initialement par le Festival International de Théâtre de Londrina, et souhaitant monter un spectacle avec des comédiens amateurs locaux, c’est presque par malentendu qu’elle se retrouva à concevoir une création théâtrale avec les détenus au sein même de la prison de Londrina. Elisabeth Goncalves soutient avec ferveur que son action dans la prison en aucun cas n’a consisté à animer un atelier de thérapie par le théâtre mais bien à accompagner l’acte de création de comédiens amateurs, ayant pour particularité sociologique d’être condamnés à de lourdes peines de prison.
À cette première expérience qui fut, à plusieurs égards, une grande réussite, succéda l’année suivante une autre pour laquelle Elisabeth Goncalves invita Florence Bresson. La création sera cette fois-ci cinématographique. Florence Bresson et Elisabeth Goncalves se veulent co-réalisatrices de ce film étrange à mi-chemin entre réalisme documentaire et onirisme surréaliste. Aux détenus, déjà comédiens dans le premier spectacle de théâtre, se greffent aussi dans Nada a Ver certains de leurs gardiens. La magie de ce petit film, aux contours incertains, est de réussir à annuler la frontière très concrète qui les sépare. Parce que s’entremêlent des séquences documentaires où, sobrement, quelques tranches de vie quotidienne de la prison sont révélées, et des scénettes de fictions, souvent franchement folles, les repères censément manichéens d’un lieu où certains hommes sont privés de liberté et où d’autres leur opposent surveillance et autorité, disparaissent. En tant qu’expérience, le travail accompli par Florence Bresson et Elisabeth Goncalves a été un bouleversement pour la prison de Londrina. Ceux, prisonniers et gardiens, qui s’y sont prêtés, ont dû faire preuve pour cela de courage, car il n’est pas aisé de transgresser les codes et les lois de la prison. L’objet cinématographique qui en découle est une zone intemporelle de liberté, où fondent les barreaux des cellules au profit d’un espace mental sans limite. Le temps d’un film. Hormis cela, cet immense cela, rien à voir !
(Sylvain Baldus)
Ivresse d’une oasis, de Hachimiya Ahamada
Pour point de départ d’Ivresse d’une oasis, le désir de Hachimiya Ahamada de se rendre aux Comores, où ses parents sont nés et où elle n’est jamais allée, de comprendre d’où elle vient. Et d’explorer la maison que son père y a construite avant de partir pour la France. Les maisons abandonnées sont au cœur d’autres films de la cinéaste (La Résidence Ylang-Ylang). Ici, elle se demande pourquoi les Comoriens sacrifient leur vie à l’édification d’une maison qu’ils abandonnent parfois ensuite. Hachimiya raconte en off son voyage aux Comores, à la première personne. Et elle parle à son père. Ce film, c’est une lettre filmée qu’elle lui adresse. La quête commence dans le village des parents de Hachimiya. Elle filme la maison et les gens du village dans leur quotidien. Surpris d’être pour la première fois objets d’attention, ils vaquent à leurs occupations devant une caméra attentive (elle s’attarde parfois sur des détails et prend le temps de nous montrer). Ils échangent aussi, face caméra, avec la cinéaste. Cette dernière finit par quitter le village pour explorer d’autres contrées, notamment l’île d’Anjouan. Le film, alors, prend une dimension sociale et politique. Les habitants de l’île racontent la crise qu’elle traverse depuis qu’elle a été séparée de Mayotte, abandonnée par la France, et ils lancent un appel à l’aide. Dans la première partie d’Ivresse d’une oasis, on s’interroge, comme devant La Mémoire et la mer, sur la possibilité pour un cinéaste de nous intéresser à son histoire intime.
Pour ce programme, cette organisation et cet accueil, pour cette chaleur, merci à toute l’équipe de Project’heure !
Marion Pasquier, avec la précieuse collaboration de Sylvain Baldus
-
Commentaires
Cinema Algerien





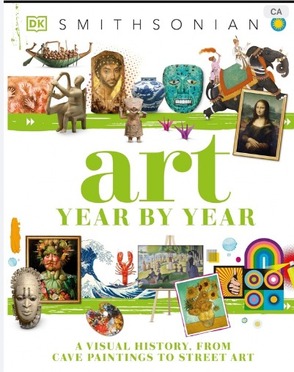




















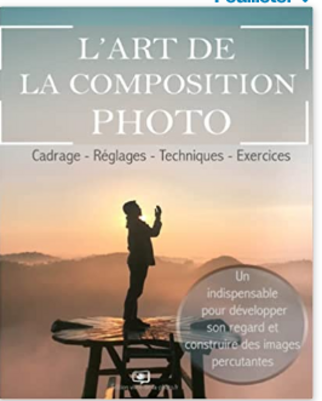







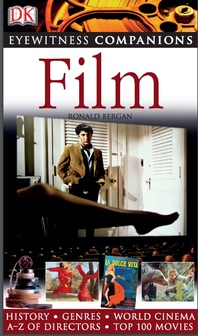





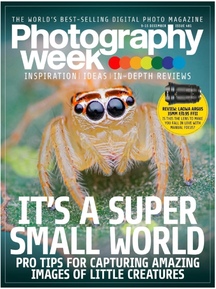



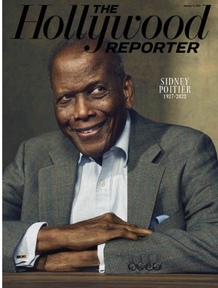








































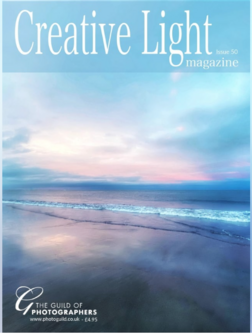

















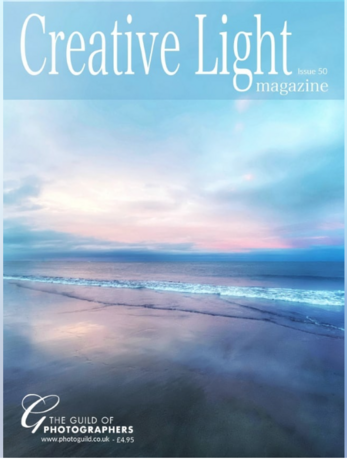


















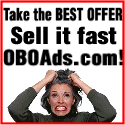
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot


