-
Alger au cinéma, de Pépé le Moko à Bab-el-Oued City
Alger au cinéma, de Pépé le Moko à Bab-el-Oued City
Abdou B est un passage obligé pour comprendre le parcours, l’évolution et les différentes tendances du cinéma en Algérie. Un grand Monsieur de la critique cinématographique. Il propose ici une lecture singulière de l’image d’Alger dans le cinéma.
Par Abdou B.
Abdou Benziane (Abdou B.), journaliste, a été rédacteur en chef adjoint à la revue El-Djeich (1967-1977), fondateur et directeur de la revue Les Deux Ecrans (1977-1985), rédacteur en chef de l’hebdomadaire Révolution africaine (culture, médias et société, 1985-1989) ; ainsi que conseiller auprès du directeur général de la télévision algérienne (1989-1990) et auprès du ministre gouverneur d’Alger (1998-2000). Il a également été directeur général de la télévision algérienne (1990-1991 et 1993-1994) dont il a démissionné en 1994. Il prépare actuellement aux éditions Casbah un essai sur la culture et la communication.
Alger ne pouvait laisser indifférents les cinéastes, tant elle a du caractère et le talent nécessaire pour jouer de beaux rôles. Film après film, voici l’occasion de retrouver les regards singuliers qu’Alger a inspirés aux réalisateurs.
Une ville, jadis blanche, qui dégringole vers la mer, en saccades qui sont autant de vestiges de tous les envahisseurs qui se sont succédé. La ville a fini par rejoindre les eaux, à qui elle a longtemps tourné le dos, dans une des plus belles baies du monde. Image d’Epinal ou nostalgie impuissante ? Richesse d’un passé dilapidé par l’impérialisme du béton, ou simplement l’âge d’une dame qui était rayonnante et aujourd’hui avachie par l’aveuglement des gouvernants hermétiques au beau et aux vertus d’un urbanisme intelligent qui aurait pu concilier un riche passé et les exigences du troisième millénaire ? El-Djezaïr est au carrefour de tant de contradictions, qu’elle en offre une parfaite synthèse. Mais, heureusement, il y a l’entêtement de ceux qui entretiennent, vaille que vaille, un terroir où se côtoient les restes dégradés de la porte sublime, de l’architecture coloniale, les villas-bunkers de la nomenklatura qui ne sait plus où nicher ses ghettos, et les rez-de-chaussée-garages des nouveaux riches de l’import-export.
Alger la blanche ne pouvait laisser indifférents les cinéastes, tant elle a du caractère et le talent nécessaire pour jouer de beaux rôles dans des fictions "coloniales", et après l’indépendance dans des œuvres alternant le meilleur et le pire. La ville originelle classée patrimoine universel par l’unesco, la Casbah cité "indigène" ou "arabe" selon les labels coloniaux, a offert très tôt son décor original aux créateurs. Ruelles en escaliers, portes dérobées et terrasses-yeux sur la mer, s’imposent à des réalisateurs venus d’horizons divers.
En 1922, Louis Mercanton et René Hervil tournent à Alger Sarati le Terrible, d’après un roman de Jean Vignaud. Les recherches effectuées par le sociologue Abdelghani Megherbi montrent qu’il s’agit là de l’apologie du colonialisme et de l’affirmation que "les Arabes admirent la force et la craignent". Plus tard, en 1937, un réalisateur natif d’Alger, André Hugon, tournera un remake qui perd toute "saveur coloniale" puisque la majorité des séquences seront tournées dans des studios parisiens. On notera aussi, en 1925, Betty gagne les 100 000 francs, film sans aucune prétention artistique qui fut réalisé à Alger.
Ne serait-ce que pour ajouter une note d’exotisme, censée plaire aux spectateurs, l’Algérie et Alger attirent les cinéastes, même si ce n’est que pour quelques plans. En 1926, d’après la nouvelle de Bernard Frank, Jacques Robert tourne En plongée, une histoire d’espionnage censée avoir pour cadre la Bretagne.
L’attrait de la capitale et de ses environs sera "consacré" à partir de 1934 avec l’arrivée d’un réalisateur qui allait tout au long de sa carrière marquer le cinéma français. Julien Duvivier débarque avec une pléiade d’acteurs et de grands moyens pour tourner Golgotha. Un décor représentant une Jérusalem sortie de la Bible est construit pour permettre à Jean Gabin, Robert Le Vigan, Harry Baur et Edwige Feuillère d’évoluer dans une évocation d’une partie de la vie de Jésus, à la gloire du christianisme. Mais pourquoi aller en terre d’islam pour faire un film "chrétien" ? Qualifiée par son propre réalisateur d’"obscur crime politique", l’œuvre n’est sans doute, dans la large panoplie de l’époque, qu’un argument de plus pour marteler la "chrétienté" de l’Algérie. Le propos s’éclaire un peu plus lorsqu’on apprend que le scénario est écrit par le chanoine Joseph Raymond, qui créa le Comité catholique du cinéma. C’est durant son séjour à Alger pour Golgotha que, sans doute, Julien Duvivier a l’idée de Pépé le Moko, après avoir repéré les lieux et les bordels de la Casbah.
Célébré et inscrit dans l’histoire du cinéma, Pépé le Moko (1937) est assurément un film qui opère une rupture, toute relative, avec l’idéologie qui domine le cinéma colonial articulant sa démarche sur "l’œuvre bienfaitrice" de la colonisation, sur la nécessité de "civiliser les indigènes" et, accessoirement, d’implanter la religion catholique. Après La Bandera réalisé au Maroc (1935) avec le même Jean Gabin, Julien Duvivier tient à se démarquer du film d’inspiration religieuse qu’est Golgotha.
L’intérêt de Pépé le Moko réside dans ce "reflet du réel", celui qui met ce film dans la lignée du cinéma "réaliste", plus que dans une impossible dénonciation, ou une description du phénomène colonial. Premier film de la veine "policière" à être tourné à Alger, Pépé le Moko étudie sans prendre de gants la descente vers la mort d’un gangster français qui se réfugie à Alger ; à partir d’une histoire conventionnelle, celle d’un truand trahi par une "indigène" jalouse, prostituée de profession, et par un "mauvais" flic arabe. Avec ce film, Alger, essentiellement la Casbah, à travers ses quartiers mal famés, ceux des trafics et de la prostitution, fait irruption dans la fiction cinématographique par une architecture à nulle autre pareille et surtout par un "climat" que retrouveront beaucoup plus tard Pontecorvo et Merzak Allouache. Jean Gabin et la Casbah sont sûrement pour beaucoup dans une œuvre qui propulsa Duvivier dans le trio gagnant du cinéma français de l’époque, avec Renoir et Carné. Sans oublier la musique composée par Mohamed Iguerbouchen.
Alger revient, la durée de quelques plans, dans un film américain sans importance. John Cromwell y tourne Algiers avec Charles Boyer, Hedy Lamarr, et encore pour la partition musicale, Iguerbouchen. Une grande production remet de nouveau Alger à l’honneur, sans pour autant tirer le voile sur la colonisation à quelques encablures de la grande déflagration de 1954 qui ébranlera, dans ses fondements, l’architecture du colonialisme. En 1949, Jean Dreville arrive à Alger pour y réaliser Le Grand Rendez-vous.
Etant donné le thème même de l’œuvre, le débarquement américain à Alger, d’importants moyens et une impressionnante logistique sont mis à la disposition de la production. Le scénario est écrit par Jacques Remy, officier des services secrets du général de Gaulle. Quant aux répliques, elles sont signées par un natif d’Alger, André Tabet. Du côté des Algériens, seuls des plans en extérieur signalaient leur existence. La ville est filmée, privée de ses habitants. Une architecture sans locataires, au seul profit de la fiction et des acteurs européens venus libérer l’Afrique du Nord.
En 1950 Casabianca est tourné à Alger et en Méditerranée. Officier de l’armée française, le réalisateur Georges Pechet rend hommage à la marine de son pays à travers l’épopée d’un sous-marin, le Casabianca, parti d’Alger pour libérer la Corse. Des vues sur le port et sur Alger, qui auraient pu être prises ailleurs, montrent une capitale fort muette, et là aussi, sans habitants.
La Casbah est de retour, en force, dans une fiction tournée par un cinéaste né à Alger. Maria Pilar (au cœur de la Casbah), de Pierre Cardinal, aligne une distribution de qualité avec Viviane Romance, Peter Van Eyck sur une musique de M. Iguerbouchen. Tourné en 1951, Maria Pilar, dans lequel joue un acteur algérien (Himoud Brahimi, dit Momo) que nous retrouverons dans le très beau Tahia ya Didou de Mohamed Zinet, est un mélodrame, une adaptation de Phèdre de Racine dans la vieille Casbah. Hélas, selon l’analyse de A. Megherbi, la médina dans ce film n’est qu’un "monde étrange, maléfique".
Des images fugaces d’Alger sont montrées en 1953 dans un film italo-américain, Aventure à Alger, réalisé par Ray Euright avec Irène Papas, George Raft. Sans ambition et sans lendemain, le film laisse peu de traces.
Le dernier film de la période coloniale, juste avant l’indépendance de l’Algérie, est tourné en 1962 par un Américain, James Blue. Outre le fait d’être le dernier, le film intègre une dizaine d’acteurs algériens. Les Oliviers de la justice, c’est de lui qu’il s’agit, mérite que l’on s’y attarde, pour les lectures qui ont été faites, jusqu’à aujourd’hui, et aussi parce qu’il se situe à un moment de "passation" entre un cinéma fait par la colonisation et un autre qui allait être celui des cinéastes algériens. Il est utile à propos de ce film de revenir aux travaux de A. Megherbi pour en situer la genèse et la filiation. Tout d’abord le commanditaire du film, Georges Deroscles, qui avait déjà produit plus de deux cents courts-métrages au Maghreb destinés à la propagande et à l’intoxication des populations autochtones. De plus, la préparation de ce film débute en… décembre 1960.
15 Donc, selon A. Megherbi, l’œuvre s’inscrit dans la droite ligne de la recherche d’une "troisième voie" en Algérie, qui est une vue de l’esprit. Tiré du roman de Jean Pelegri, le film en question, qui repasse de manière cyclique à Alger, est surestimé par une certaine "élite", elle-même surestimant ses capacités d’analyse et d’influence sur la société.
16 Alger, enfin libérée des parachutistes et des ambiguïtés inévitables propres à des films réalisés par des Européens, va, dès 1962, s’offrir aux réalisateurs pour qu’enfin les œuvres et Alger ne soient plus perçues à travers le prisme de l’idéologie coloniale mais sous la seule responsabilité des créateurs algériens, dont certains n’ont échappé ni au folklore ni au misérabilisme et encore moins à des clichés néocoloniaux.
Dès 1964, dans Une si jeune paix, le réalisateur Jacques Charby filme Alger à travers les cicatrices encore visibles de la guerre, les panneaux routiers et l’architecture de la ville qui renseignent à merveille, comme dans un instantané sur l’état de la capitale. La symbiose est parfaite entre les séquelles physiques et les traumatismes que vivent des enfants de chouhadas qui jouent à la guerre en opposant les locataires de deux centres d’accueil créés pour eux à l’indépendance. Le film reçoit le prix du Jeune Cinéma au festival de Moscou en 1965.
Les villas coloniales, les grands immeubles urbains de ce qui fut "la ville européenne" sont longuement filmés dans La nuit a peur du soleil de Mustapha Badie en 1965. Cette grande fresque qui fut la première grosse production de l’Algérie indépendante retrace la genèse, le déroulement et la fin de la guerre de libération.
1966 permet enfin de voir la Casbah et tout Alger se déployer et jouer les rôles principaux dans une fiction de haute facture. La Bataille d’Alger, produit par Casbah Films d’après le livre de Yacef Saadi, est une "reconstitution" de la fameuse bataille qui a opposé la guérilla urbaine du fln aux parachutistes de Massu et Bigeard. Réalisé par l’Italien Gillo Pontecorvo, cette fiction, qui n’est que le reflet artistique d’une féroce réalité, met en exergue le rôle déterminant joué par la configuration esthétique même de la Casbah, en tant qu’"allié objectif" des combattants du fln. Les vastes maisons collectives de la vieille ville se transforment en autant de sanctuaires, de tribunaux, d’administrations. Dans ces demeures prédestinées, le fln rend la justice, célèbre les mariages et organise la division du travail en temps de guerre. Les puits d’eau, les minuscules alcôves sont transformés en caches indécelables et en passages vers d’autres maisons.
Les terrasses, domaine réservé des femmes et portes béantes sur le grand large, servent d’observatoires et de passerelles, les unes avec les autres. Protectrice de la population et des militants anticolonialistes, la Casbah dans La Bataille d’Alger fait figure d’acteur principal, servie en noir et blanc par une magnifique image signée Marcelle Gatti. En face, il y a l’ennemi, incarné par la "ville française" avec ses beaux immeubles blancs, ses commissariats et ses centres de torture. Encastrée dans le bas, la Casbah est dominée, vue d’en haut, à la jumelle, par les officiers français qui savent que la vieille ville ne livrera jamais tous ses secrets, ni le tracé de ses ruelles-veines qui irriguent tout Alger de ses réseaux clandestins. Le film fut couronné à Venise par le Lion d’or et le grand prix de la Critique internationale, en 1966.
Une autre grosse pointure italienne va planter sa caméra pour tourner le roman si dense et si controversé de l’écrivain Albert Camus. Sa mer, les origines de Camus, sa maison de Belcourt et toute la mythologie qui parfume la relation de Camus avec l’Algérie connotent L’Etranger réalisé par Luchino Visconti en 1968. Le film attire les regards sur Alger, décor évanescent pour une réflexion philosophique qui n’en finit pas de nourrir débats et polémiques. Freddy Buache, critique, historien et l’âme de la Cinémathèque suisse, écrivit qu’ "à l’heure de la guerre du Vietnam et de l’Europe asphyxiant la liberté par l’opulence, on était en droit d’attendre autre chose de la part de l’auteur de La Terra trema, de Rocco et ses frères et du Guépard". Quant au Français Michel Mardore, il assena : "Pour ma part, j’aime L’Etranger parce qu’on y voit Alger, sans plus." Un film par excellence politique aura lui aussi Alger et certaines de ses infrastructures pour cadre, bien méditerranéen, celui d’un assassinat politique. Costa-Gavras, à partir d’un scénario de Jorge Semprun tiré du livre de Vassilis Vassilikos, retrace Z, le meurtre d’un leader grec de gauche, le député Lambrakis. Le film obtiendra le prix spécial du Jury à Cannes (1969), un oscar à Los Angeles, et un oscar à Londres, en 1970.
Dans un film composé de trois volets autonomes, intitulé Histoires de la révolution, un des courts métrages de fiction, La Bombe (1969), de Rabah Laradji, décrit un quartier "européen" et une jeune fille qui doit déposer une bombe dans un bar pour venger son frère, tué par l’oas. Ce film fait suivre au spectateur le trajet qui sépare deux villes et les obstacles qui se dressent entre elles. Arrive alors Tahia ya Didou (1971), le seul film miracle de M. Zinet, un compagnon de Kateb Yacine et de M’hamed Issiakhem. La ville d’Alger ayant passé une commande pour la réalisation d’un documentaire vantant les charmes d’Alger, M. Zinet détourne le projet et en fait une fiction poétique (sans négliger les charmes de la ville) servie par une adaptation et un long poème de Himoud Brahimi (Momo) :
Si j’avais à choisir parmi les étoiles, pour comparerle soleil lui-même ne saurait éclipserla lumière du verbe que tu cachesaucun lieu sacré, ni aucune capitalene saurait réunir ce que chaque matinle lever du jour t’offre comme guirlande
Par ces vers récités sur une jetée par les flots arrosée, Momo annonce une des plus belles promenades dans Alger, à la suite d’un couple de touristes français. Il est utile de faire un synopsis du film pour mieux comprendre l’hommage rendu à Alger. Au hasard des promenades et des rencontres un couple de touristes français découvre Alger, évoquée par Momo, le chantre de la Casbah. Simon, accompagné de sa femme, reconnaît dans un bistrot un Algérien qu’il a autrefois torturé. L’homme le fixe. Pris de panique, Simon s’enfuit. Mohamed reste à sa table. Immobile, il est aveugle. C’est sans doute dans ce film où le verbe est réduit au minimum que la baie d’Alger, les entrailles de la cité et chaque rue de la Casbah reçoivent l’hommage, par l’image, du plus sensible des cinéastes.
En 1976, un autre coup de tonnerre perturbe le ciel du cinéma algérien. Avec Omar Gatlato, Merzak Allouache, enfant de la ville, fait évoluer ses personnages dans le centre-ville, au stade, à "Climat de France", sur les hauteurs. L’enfermement des femmes, l’habitude des hommes à vivre en groupe, les petites combines dans les rues d’Alger, tout en donnant au cinéma un film de qualité, font redécouvrir une ville où s’annoncent déjà les signes de la dégradation physique, qui précèdent les plus grands désordres.
Après des années d’éclipse, le cinéma algérien, pris entre "l’économie de marché", la raréfaction des finances publiques, le terrorisme et les exils, va donner épisodiquement quelques œuvres où Alger revient à l’écran. La vague fondamentaliste, les lois d’exception et le mode de production vont définitivement peser sur les œuvres comme ils ont modifié le paysage urbain. Un film tente de retracer, à travers la fiction, les événements sanglants d’octobre 1988.
Signé par Malik Lakhdar-Hamina, Automne, octobre à Alger décrit Alger prise dans un cycle de violences dont les traces sont encore visibles. Pour un premier film, le réalisateur fait preuve d’une bonne maîtrise en filmant les endroits et les chocs qui ont fait d’octobre une rupture qui continue d’agiter la société. En 1994, Bab-el-Oued City de M. Allouache met en exergue un "personnage", présent depuis toujours et qui introduit la menace dans la cité. La mosquée, havre de paix et de sérénité, fait irruption comme acteur politique. Bab-el-Oued, siège de la contestation fondamentaliste, est filmé par un enfant du cru. Minarets hostiles, boulangeries miteuses, rues mal éclairées, révèlent des zones d’Alger jusque-là connues par leurs seuls habitants. Le film est annonciateur de la profondeur d’une tragédie qui perdure.
Abdou Benziane « Alger au cinéma, de Pépé le Moko à Bab-el-Oued City », La pensée de midi 1/2001 (N° 4), p. 90-97.
« Entretien avec Mehdi CharefPar Belkacem AHCENE-DJABALLAH spécialistes de la communication et de l?information »
-
Commentaires
Cinema Algerien









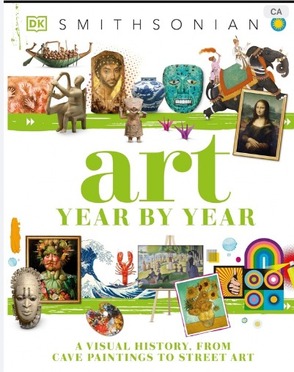




















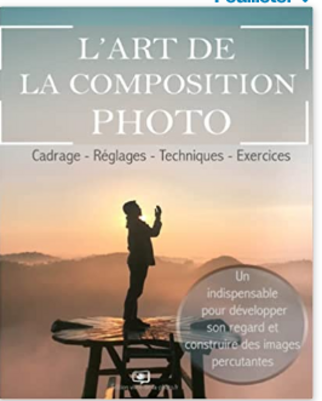







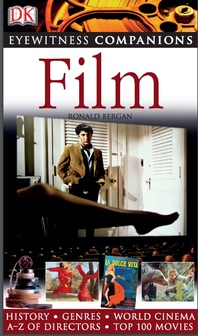





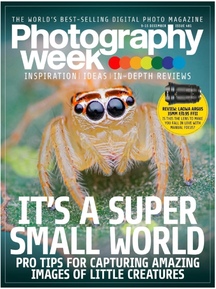



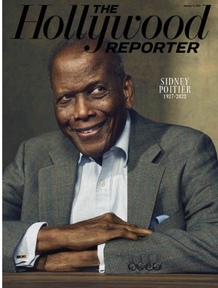
















































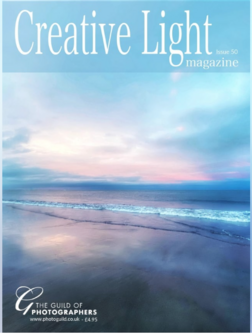

















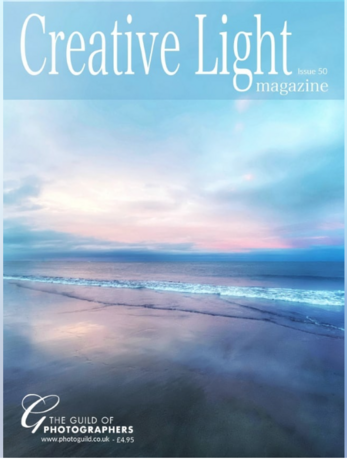


















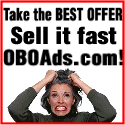
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)











 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot



