-
Steven Spielberg
Menu principalToujours a l'afficheAnalyses & textes.------- Partenaires ------- SPLENDEUR DE LA CATASTROPHE
La Guerre des mondes
réalisé par Steven Spielberg
Gros Plans > 14 février 2012

À sa sortie en 2005, La Guerre des mondes suscita des réactions pour le moins contrastées. Sèchement accueilli par Critikat, il donna lieu à l’une des plus belles émulations de textes de la blogosphère cinéphilique. Apogée de la période la plus passionnante de l’œuvre de Spielberg, le film, bien loin d’être unblockbuster conventionnel, faisait atteindre son summum d’efficacité à l’expression sombre et tendue qui fut celle cinéaste dans les années 2000 (A.I. Intelligence artificielle, Minority Report, Munich). Trouvant un équilibre fragile mais puissant entre « sujets adultes » et sens scandaleux de l’entertainment, vitalité et noirceur, angoisses intimes et vocation universelle, celui-ci portait à incandescence ses contradictions de créateur et donnait un souffle nouveau à ses thèmes de toujours, parfois plombés, lors de la décennie précédente, par l’édification ou la mièvrerie. Retour sur un chef-d’œuvre d’angoisse et d’ambiguïté.
La guerre des arts
Comparer un film avec le roman qu’il adapte, c’est compréhensible, parfois riche d’enseignements. Dans le meilleur cas, c’est rendre justice à leurs beautés respectives. Mais c’est aussi le meilleur moyen de s’enfermer dans la question de la fidélité (« à l’esprit » sinon « à la lettre »), d’être tenté par le jeu des sept erreurs et, partant, d’occulter l’essentiel : l’éventuelle singularité du film, ce qu’il travaille, au-delà de la simple transposition, avec les outils du cinéma. Comparer le film de Spielberg au roman de Wells, ce n’est pas la seule façon de taper sur le réalisateur (certains rédacteurs à Critikat ont d’autres raisons…), mais ce fut l’angle d’attaque de notre collègue lors de la sortie du film, dans une critique lapidairequi nous semblait passer à côté des véritable enjeux, ne voyant que facilités dans la manière dont Spielberg s’approprie sa matière, ne pointant que défauts dans ce qui constitue sa chair même – vive, inquiète, captivante.

La cendre et le sang
Evidemment, au cœur du problème, il y a la famille, noyau de la vision du monde américaine et tel objet de rejet, de la part de certains cinéphiles en France – pour qui la famille se doit d’être un repoussoir, un nid de vipères mesquines –, qu’ils se braquent à sa moindre représentation dans un film hollywoodien, y fustigeant une écœurante propagande par pur réflexe, quand bien même la vision qui en est donnée serait un peu moins simpliste qu’ils veulent le croire. Adjoindre des enfants à un héros immature et égoïste ? Une hérésie, un « fardeau », sûrement pas un sujet digne d’intérêt. Choisir de recentrer son récit sur une de ses éternelles obsessions, la famille décomposée : voilà la faute de Spielberg. Peu importe, dès lors, le beau paradoxe consistant à faire d’un film catastrophe un périple intimiste grisâtre, peu porté sur l’emphase pyrotechnique (malgré des effets d’une beauté inouïe). Peu importe que le film, encadré par un prologue et un épilogue traçant des raccourcis aussi simples que vertigineux, problématise clairement la place de l’homme dans l’univers, perdu entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, tiraillé entre la nécessité du collectif et l’instinct de survie individuel (une hantise très langienne de la foule déchaînée le rend parfois assez éprouvant). Peu importent, enfin, les rapports pour le moins conflictuels des membres de la famille, et la conclusion plutôt cruelle derrière ses faux airs de retrouvailles heureuses. Fiction familiale = le mal est fait.
L’ironie, dans ce jugement à l’emporte-pièce, c’est que c’est bien de cela qu’il s’agit : le mal est fait. Les machines extraterrestres étaient déjà là. L’innocence est perdue. Les liens du sang se sont nécrosés, et le trajet de la famille est une fuite en avant dont elle ne se remettra pas tout à fait. Obsédé par sa promesse, Ray l’a tenue au prix d’actes terrifiants, où l’acculement face à l’adversité se l’est disputé à l’égoïsme, et ne reçoit en retour que des sourires distants et contrits, guère plus flatteurs pour son estime de soi que les reflets de son visage – couvert de cendre, impuissant, désemparé – que lui ont renvoyé les nombreuses surfaces réfléchissantes ponctuant le film.
Voir ou ne pas voir
Discutée et discutable, quoi qu’il serait exagéré d’y voir une apologie de la violence dans les cas où la famille est jugée en danger, la scène du meurtre marque l’acmé de ce faux apprentissage. Le forfait est soigneusement tenu hors champ, alors que les coups de hache portés sur l’œil serpentin (belle et troublante fusion de la machine et de l’organique chez les extraterrestres) éclateront à l’avant-plan, et que le corps flasque du dernier alien se nécrosera plein cadre : les créatures venues d’ailleurs n’ont donc pas droit à la même pudeur que les humains. Il y a souvent, dans les films de Spielberg, une ou deux scènes qui embarrassent, les plus problématiques étant sans doute celle des douches dans La Liste de Schindleret le montage parallèle éjaculatoire de la fin de Munich. Malgré l’incontestable maladresse de ces fautes de goût – voire d’éthique –, il faut voir l’angoisse à l’œuvre dans ces débords qui disent le point de non-retour.
Dans ce film intensément travaillé par la question du regard, l’élimination d’Ogilvy constitue la pire et ultime horreur que Ray tente de dissimuler aux yeux de sa fille (les grands yeux poignants de Dakota Fanning) ; recourir à l’imagination plutôt qu’à la monstration, c’est surtout accompagner Rachel dans ses cécité et surdité forcées pour en éprouver le caractère tragiquement dérisoire : comme à son habitude, elle a besoin de croire plutôt que de voir pour se convaincre que tout va bien et rassurer ses crises d’angoisse, mais il y a fort à parier que, cette fois-ci, elle n’est plus dupe. Voir, à l’inverse, les créatures de l’espace se débattre ou succomber, c’est affronter l’inimaginable, le regarder en face, hébété.

Spectacle et souffrance
Les fameuses Spielberg faces, loin d’être saisies par l’émerveillement ou par la simple crainte, contemplent ici l’horreur, l’ampleur du désastre causé par ces E.T. incompréhensiblement malveillants. Et le pire, c’est que c’est beau. Le cinéaste trouve enfin le moyen, en digérant les traumatismes du XXe siècle et en les recrachant sous forme de saisissantes visions apocalyptiques, de filmer l’extermination de manière plus convaincante que dans La Liste de Schindler, sans pour autant renoncer un instant au spectacle. Au contraire, lesté par un inconscient profond et une anxiété constante, sorte de cauchemar éveillé à la fois très concret et éthéré (entre autres grâce à la photo de Janusz Kaminski, tout en émulsion charbonneuse et rayons laiteux), le film brille par son économie narrative, son découpage imparable se permettant tous les écarts vis-à-vis de la transparence : mouvements fluides ou caméra épaule nerveuse, flares et éclaboussures de sang sur la lentille, vues subjectives, suivi d’une faille se formant sous les pieds de la foule, ample voltige autour d’une voiture filant sur l’autoroute, la caméra entrant et sortant à l’envi de l’habitacle… Autant d’effets mettant en jeu le regard, l’espace et l’intrusion (on y revient), sur lesquels la mise en scène ne se repose jamais, poussée de l’avant par une implacable dynamique du récit.
La confrontation du sadisme spielbergien (retors et arbitraire, moins malicieux et érotique que chez Hitchcock) avec des horreurs plus graves et incarnées qu’un camionneur fantôme ou un aileron de requin produit un paradoxe troublant, mais la puérilité, l’inconséquence voire le cynisme occasionnel d’antan ont fait place à une authentique angoisse, et les suspenses insoutenables qu’elle engendre atteignent ici une force indéniable. A leur origine, le plus souvent : la confusion créée par la nécessité de suivre le mouvement sans céder à la panique ni au refus obstiné d’écouter l’autre. Voir le garagiste désintégré pour n’avoir pas compris l’attitude de Ray, ou la femme qui, en voulant sauver Rachel, menace de l’arracher à son père – lequel tente en vain, quelques pas plus loin, de retenir son fils.
Aliens go home !
Voilà d’ailleurs un autre reproche fait au film : la volonté démonstrative dudit fils de participer à la lutte armée contre l’ennemi. Alerte ! Patriotisme, militarisme, impérialisme ! Que cette envie d’engagement soit montrée à la fois comme un désir sincère de sauver des vies menacées par un envahisseur hostile (rien à voir, donc, avec de vagues adversaires présumés de la Liberté), une conscience patriotique somme toute compréhensible chez un jeune Américain middle-class(dont on ne voit pas bien au nom de quoi le film, du moment qu’il n’en prend pas bêtement le parti, se retiendrait de rendre compte), une provocation adolescente face à un père jugé lâche et un besoin compulsif confinant à la folie furieuse : voilà qui n’aurait aucun poids aux yeux de ces détracteurs pavloviens. Le film étant sorti en plein mandat Bush, ils ont préféré voir dans cet élan belliciste une légitimation de la guerre en Irak, et dans l’évocation de l’occupation de l’Algérie par la France un petit rappel à l’ordre à destination des donneurs de leçon – Villepin venait de donner son fameux discours à l’ONU.
Interprétations à gros sabots, certes confortées par les propos tenus par Spielberg en faveur de l’intervention américaine, mais qui, si l’on s’en tient à ce que montre le film, frisent le contresens total. Non seulement parce qu’aucune analogie avec une situation précise de l’Histoire ne tient totalement la route – bien qu’il soit évident que les vêtements flottant dans les airs rappellent ceux des camps d’extermination et que la carcasse d’avion ravive le souvenir brûlant du 11-Septembre. Mais aussi parce que, d’une écharde que le corps recrachera en temps voulu à la défaite des aliens due à de micro-organismes terriens, se tisse un impressionnant réseau de signes renvoyant à la question de l’immunité, de la résistance à l’intrus, de l’échec des occupations de territoires [1]. Question que le film, certes américano-centré, lie à celle du rapport à l’étranger en portant un regard acéré sur l’attitude yankee vis-à-vis de tout ce qui vient d’ailleurs (la nourriture arabe, le génie technologique japonais, cette vieille Europe un peu suspecte…). Tout en ayant la présence d’esprit d’éviter l’équationétranger = menace en montrant, discrètement mais sûrement, un pays métissé.

Rencontres du 7e art
En parlant de rapport à l’autre, La Guerre des mondes procure un intense plaisir de cinéphile par sa manière de contenir par un instinct génial le cinéma qui l’a précédé et celui qui le suivra. À l’époque de sa sortie, le blogueur Zohiloff avait repéré la parenté qu’entretient la fin du film avec celle de La Prisonnière du désert de John Ford ; Sandrine Marques, quant à elle, relevait sur Contrechamp en quoi ce récit de l’enfance confrontée à l’horreur devait quelque chose à La Nuit du chasseur de Charles Laughton. Assez frappant, par ailleurs, face à ce Mars Attacks ! non-parodique, ce conte horrifique où se dressent des squelettes d’arbres noirs au sommet de collines rougeoyantes, est le dialogue que le film entretient avec l’imaginaire de Burton, dont il donne une version à la fois plus vivace et somptueusement nécrosée.
Au rayon de l’influence sur la nouvelle génération, on ne s’étonnera pas de songer à des cinéastes ne faisant pas mystère de leur admiration pour Spielberg : The Host de Bong Joon-ho, film lui aussi préoccupé (jusque dans son titre) par la notion d’intrus, en apparaît ainsi comme le jumeau coréen – où le coupable, savoureux paradoxe, est clairement désigné : l’ingérence américaine… Phénomènes de M. Night Shyamalan serait quant à lui un cousin animiste et solaire : autre ennemi (invisible, celui-ci), mais même récit du cataclysme à hauteur de famille moyenne forcée à l’exode sur les routes américaines ; même caméra agile et hitchcockienne qui ne craint pas l’effet et même don pour les visions fascinantes venant suspendre le cours d’une narration dynamique. Enfin, Cloverfield de Matt Reeves (et JJ « Super 8 » Abrams à la production) semble trouver son origine dans ce plan où l’attaque est vue à travers l’écran d’un caméscope abandonné sur le bitume, dont il donne une prolongation conceptuelle.
De manière plus inattendue, on se prend à songer également à La France lorsque survient la fameuse scène du meurtre d’Ogilvy, dont on trouve un parfait équivalent, en termes de violent point de bascule du récit, dans le film de Serge Bozon : la scène de la grange du paysan. La comparaison fonctionne au-delà de ce nœud narratif : ces deux films-odyssée (désertion et lente dérive d’un côté, instinct de survie et échappée frénétique de l’autre) partagent également un deus ex machina sous forme d’apparition fantomatique (l’amoureux/le fils) et un plan final dans les étoiles…
The roots of Life
Ce qui nous amène au coup de grâce, au péché ultime pour les détracteurs du film : la voix solennelle du prologue et de l’épilogue louant, au détour d’une phrase, la sagesse de Dieu. Halte là ! Bigoterie ! Certains, n’ayant pas peur du ridicule, ont même hurlé à la propagande scientologique, les croyances et déclarations prosélytes de Tom Cruise étant ce qu’elles sont. Aucune bondieuserie dans le film, pourtant. Tout juste ce texte (extrait tel quel du roman de Wells, soit dit en passant) qui, dans le cadre d’une prise de distance avec l’intrigue qu’elle replace dans un ensemble cosmique, postule l’existence d’une entité supérieure ayant eu la bonne idée de mettre sur Terre… des microbes. Une entité supérieure à laquelle les Américains et leurs billets verts donnent en effet le nom de « God », et à laquelle on est en droit de préférer les termes « Big Bang » et « évolution » sans pour autant balayer d’un revers de main un film d’une telle richesse [2].
Raphaël Lefèvre
« DOSSIER : ?AMOUR À MORT La Chienne réalisé par Jean Renoir DOSSIER :Orson Welles AFFOLÉS PAR LEUR PROPRE SANG La Dame de Shanghai réalisé par Orson Welles »
-
Commentaires
Cinema Algerien




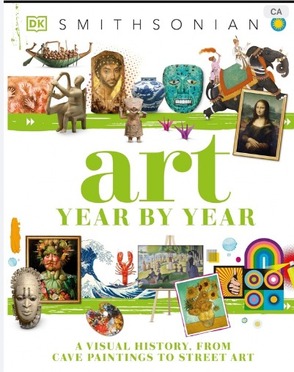




















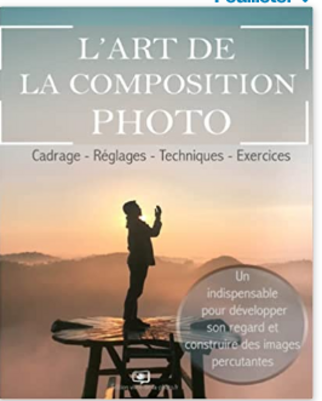







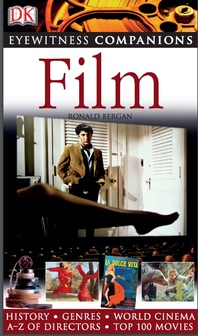





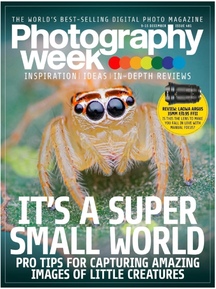



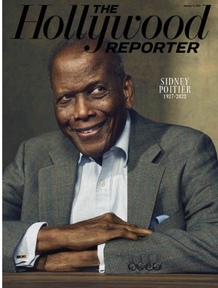








































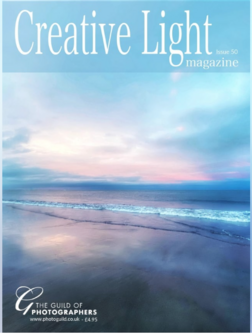

















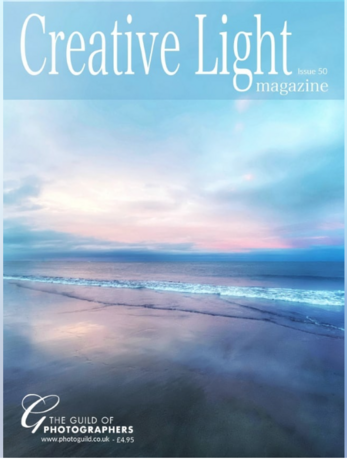


















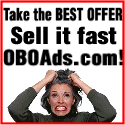
































![Algérie : 15 Films de René Vautier, 1954-1988 [1]](http://ekladata.com/LPugq8i0EZqkJC6-CkF5fVl07m4@199x258.jpg)












 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot












